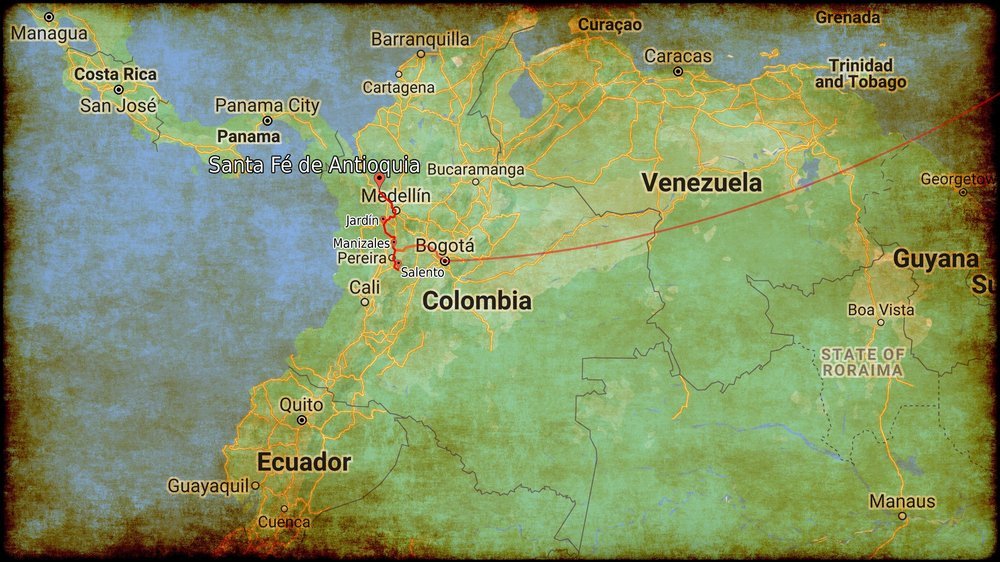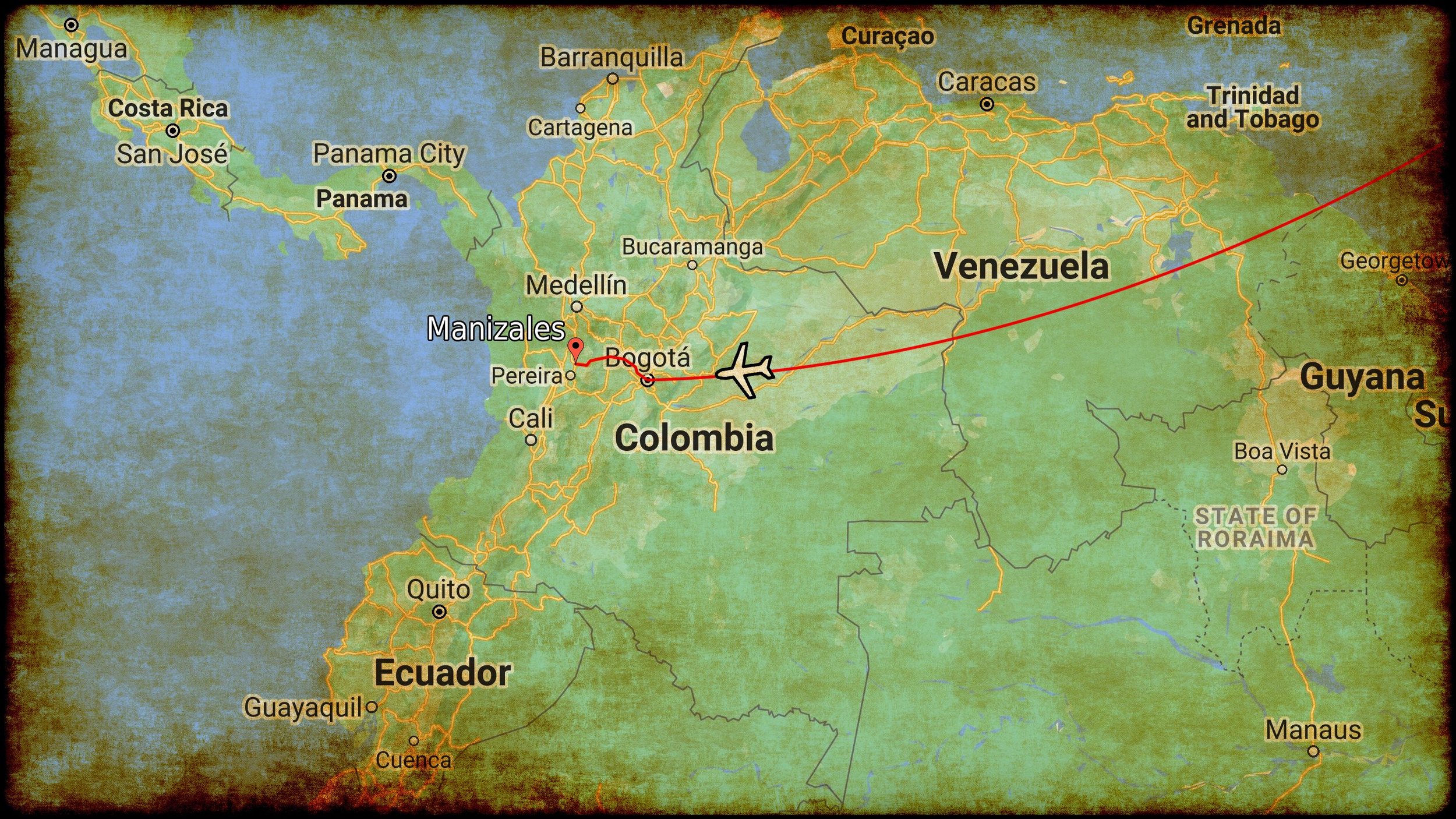El Diario Latino #6 : The End
Les rencontres de malade s’enchaînent. Les évènements explosifs s’accumulent. Les expériences se télescopent si vite les unes après les autres que tout ce que je peux faire est de… suivre. Galoper avec elles, sans reprendre mon souffle. Sans déconner, j’ai l’impression d’être Jim Carrey dans Yes Man ! Vous connaissez le principe ? Dire OUI à tout ce qui se présente, foncer tête baissée dans tout ce que la vie te propose, aussi ouf, dangereux ou stupide que ça paraisse ! Et bordel, mais c’est la meilleure manière de vivre, nom de Dieu !
Iquitos, Pérou : Jour 131
Ceci est le dernier Diario Latino que vous lirez. C’est devenu impossible pour moi de le tenir régulièrement.
Il m’est arrivé trop de choses. Trop de rencontres, trop de bouleversements, trop d’évènements que je me sens incapable de décrire, et que j’ai plus envie de partager. Parce que ça les vide de leur essence et que ça n’appartient qu’à moi. Et puis, il est hors de question de me couper de ce que je vis, ne serait-ce qu’une seconde, pour prendre le temps de le rapporter ici. Sans blague, vous me voyez refuser l’invitation d’un Anglais badass à se déchirer la gueule dans un bar miteux ou encore décliner un tour en bateau pour voir les dauphins au coucher du soleil parce que, nan, désolée, j’ai du retard dans mon carnet de bord, ce soir faut que j’écrive ? J’aimerais bien voir ça, tiens !
Et se raconter à soi-même sa propre histoire alors qu’elle est en train de s’écrire… A quoi bon ?
Depuis un moment, je me disais qu’être connectée freinait l’immersion et l’assimilation de ce voyage. J’en venais à regretter l’époque de mon premier trip, pas loin de 15 ans en arrière, quand mon unique moyen de contact avec le monde extérieur (c’est-à-dire ma mère) était un pauvre téléphone qui me coûtait 3 euros à chaque sms envoyé. Vu qu’en ce temps jadis y avait un nombre limité de caractères par sms (sinon ça en coûtait deux), autant dire que t’avais plutôt intérêt à te restreindre sur le déballage de ta life, ce qui te poussait à aller à l’essentiel. En gros donc : Maman, t’en fais pas, je suis toujours en vie (envoyé toutes les deux semaines).
J’étais complètement seule avec ce que je vivais. Et j’adorais ça, en fait.
Déjà à l’époque, tenir le Carnet de Route me demandait une certaine astreinte, mais j’étais beaucoup moins prolifique au niveau de la fiction, donc ça se résumait plus ou moins à la seule écriture que je m’imposais.
Les choses ont changé aujourd’hui.
Le truc, les gars, c’est que quand t’es capable de transformer une expérience en fiction, y a plus aucun intérêt à la relater telle quelle. Aucun intérêt personnel, du moins. La nouvelle La Passagère a constitué une sorte de révélation, à ce niveau. L’exemple le plus flagrant que je puisse trouver, c’est ces légendes que les indigènes m’ont racontées. Pourquoi les faire transiter par ici alors que je peux direct m’en inspirer pour les transformer en Histoires de l’Autre Monde ?
A partir de maintenant, voilà ce sur quoi je veux travailler. Voilà l’endroit où je veux mettre toute ma putain d’énergie. Et surtout, voilà la seule concession à l’écriture que je suis désormais prête à faire durant ce voyage.
La fiction. Utiliser ce que je vis pour l’incorporer directement à mon œuvre.
Les deux semaines passées dans la jungle colombienne sans wifi ont achevé de me convaincre que la seule vraie manière de vivre ce trip était d’oublier le reste du monde. Celui que j’ai laissé derrière moi. Physiquement, mais aussi sur les réseaux.
Les rencontres de malade s’enchaînent. Les évènements explosifs s’accumulent. Les expériences se télescopent si vite les unes après les autres que tout ce que je peux faire est de… suivre. Galoper avec elles, sans reprendre mon souffle. Sans déconner, j’ai l’impression d’être Jim Carrey dans Yes Man ! Vous connaissez le principe ? Dire OUI à tout ce qui se présente, foncer tête baissée dans tout ce que la vie te propose, aussi ouf, dangereux ou stupide que ça paraisse ! Et bordel, mais c’est la meilleure manière de vivre, nom de Dieu ! Vous voulez des exemples ? No problemo.
En vrac et dans le désordre, ces dernières semaines j’ai repris de l’ayahuasca en Colombie pour la première fois depuis la mort de Wish, j’ai vu des dauphins, des singes, des perroquets libres volant dans le ciel et des serpents mortels, j’ai quitté la Colombie pour le Pérou en naviguant sur l’Amazone, j’ai appris à préparer le rapé (tabac à priser chamanique), je suis tombée amoureuse, j’ai fait le plus beau galop de ma vie sur un cheval nommé Cambalaché, j’ai réalisé le rêve de me rendre sur les lieux du film L’Étreinte du Serpent, j’ai vu une liane d’ayahuasca vieille de 16 générations, j’ai rencontré des Italiens, des Anglais, des Lituaniens, des Polonais, des communautés indigènes de tous bords, des gens complètement fêlés et magnifiques, chacun avec sa folie singulière, qui m’ont filé du grain à moudre pour de futurs personnages, j’ai testé le yopo, graines contenant de la DMT qu’on réduit en poudre pour se l’envoyer dans le nez et c’était tellement violent que j’ai cru que j’allais jamais en revenir, je me suis lavée toute nue dans les rivières, j’ai gerbé mes tripes, je me suis décalqué la gueule à la bière, je me suis sentie seule, je me suis sentie comprise, je me suis sentie aimée, j’ai parlé de mes livres à un nombre de gens effarant, j’ai fait tellement d’heures de bateau dans la jungle que je sais même plus l’effet que ça fait de prendre un bus, je suis restée dans une grotte toute noire en plein silence, que les indigènes considèrent comme le vagin de la déesse de la Terre, la Pachamama, seulement caressée par le frôlement des chauve-souris, et en sortant de cette grotte je suis née à nouveau (selon la légende), et enfin… j’ai trouvé la communauté dans laquelle je vais rester pour faire une diète d’ayahuasca et sans doute d’autres plantes maîtresses, celles que Travis diète dans Borderline.
Là-bas, il y a un tumbo dans lequel je peux m’isoler sans voir personne pendant des semaines en pleine jungle. Et il est aussi question que je prenne de l’ayahuasca toute seule, dans ce tumbo, pour la première fois de ma vie.
Donc après 4 mois et demi de voyage, les priorités ont changé. Le seul truc qui compte à mes yeux à présent, c’est de VIVRE.
Bien sûr, en tant qu’auteure indépendante, je me disais que de maintenir un minimum de présence sur les réseaux, c’était le moins que je pouvais faire pour faire perdurer mon business. C’est bien connu, pas vrai, que si t’existes pas sur les réseaux, t’existes pas tout court.
Putain de conneries.
Bullshit de merde.
La vérité, c’est que beaucoup de gens se contentent de liker mes photos sans avoir la curiosité d’aller voir ce que j’écris. C’est marrant, mais on dirait qu’ils font pas le lien entre ce que je montre de mon voyage et l’inspiration que ça pourrait me procurer. Hey, j’adore le délire de cette meuf, quel beau voyage, dis donc ! Acheter ses livres parce que cette fille-là doit forcément avoir des trucs intéressants à dire ? Tu parles ! A part scroller, j’ai pas le temps pour ça, mon vieux. Pas le temps de lire. Pas le temps de rien.
Bah vous savez quoi ? Fuck off. J’ai plus de temps à perdre avec ça. Si Borderline doit se faire connaître pour de vrai un jour, ça se fera sans moi.
Je posterai encore quelques photos sur Twitter et Instagram, parce que c’est important pour moi de montrer aux autres la beauté du monde et peut-être d’arriver à en inciter certains à se lancer sur la route à leur tour, mais j’en ai fini avec l’étalage de mon vécu à travers ce Diario.
Tout ce qui m’incombe en tant qu’artiste, c’est juste de continuer à écrire. Et bordel m’isoler en pleine jungle avec l’ayahuasca comme guide est le seul et unique putain de truc sensé à faire à l’heure qu’il est. Et puis, ici, les gens s’intéressent vraiment à ce que j’écris. Quand ils voient le jaguar sur la couverture du tome 1, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. S’il existe encore un quelconque marketing en ce qui concerne Borderline, il est à présent dans le rapport direct. Évidemment, la plupart des gens que je croise ne sont pas Français, ce qui limite le nombre de lecteurs que je peux trouver. Mais je m’en cogne, en fait. Rien que de parler de cette saga, qui compte plus que tout à mes yeux depuis plus de la putain de moitié de ma vie, à des gens qui parlent le même langage que moi, suffit à me réjouir !
Donc voilà où on en est. Mes projets ? Demain, je pars pour des semaines de diète d’ayahuasca et de plantes maîtresses dans une microscopique communauté le long d’une rivière au sud d’Iquitos. Je vais m’acheter des cahiers, à l’ancienne, pour écrire le dernier tome de Borderline exactement dans les mêmes conditions que Travis. Eh ouais, là-bas y a pas toujours l’électricité pour charger l’ordi, et je me laverai dans la rivière et je me ferai défoncer par les moustiques, mais qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Je vais retranscrire mes cérémonies pour poursuivre les Carnets d’Ayahuasca. Je vais tout bonnement suivre ma route en silence, celle qui fend en deux le cœur de mon esprit, pour aller y débusquer les dernières flammes dont j’ai besoin pour terminer ma saga en monstrueuse apothéose !
Merci à tous ceux qu’ont suivi ce Diario Latino pendant presque 5 mois. Je veux pas entendre la moindre plainte. Si ce que je fais vous intéresse vraiment, allez acheter mes bouquins et lisez mes nouvelles. Ces journaux de voyage, c’est que de la couille en boite comparé aux étincelles que je suis capable de produire en fiction.
Le fameux “Show, don’t tell”, vous connaissez ? Bah voilà. Personne ne perd au change, et surtout pas moi.
Je suis libre.
Update : Mon incroyable expérience chamanique dans la jungle amazonienne !
© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés
El Diario Latino #5
La nouvelle vague sur laquelle je surfe à présent est celle d’une inspiration immense. Quelque chose s’est débloqué. Il s’agit plus seulement d’utiliser ce que je vis en l’incorporant plus tard à mes écrits. Désormais, au moment même du vécu, je le ressens déjà comme faisant partie de mon œuvre. Y a plus de transition, d’ajustements, de médiation. Tout m’apparaît d’emblée d’une manière littéraire, les idées jaillissent sous leur forme définitive.
Villa de Leyva, Colombie : Jour 77
Métamorphose
Me voilà dans une nouvelle phase du voyage. Le constat est flagrant. La tempête que je sentais monter n’était peut-être rien d’autre que ça. J’imagine que la vie d’un écrivain-voyageur est ponctuée de périodes où le voyage prend le pas sur l’écriture, et inversement.
C’est arrivé dans le désert de la Guajira, quand j’ai réalisé que ce que j’étais en train de vivre ne pourrait pas et ne devait pas être rapporté ici d’une manière qui transformerait une expérience hors du commun en un récit tristement terre à terre. C’est là que ça s’est réveillé. Et puis, la décision de louer cette maison dans ce village paumé y était aussi certainement pour quelque chose, d’autant plus que je m’y préparais, puisque je l’avais trouvée avant même de me rendre dans le désert. Tout en moi me criait : Écriture, écriture, écriture !
La nouvelle vague sur laquelle je surfe à présent est celle d’une inspiration immense. Quelque chose s’est débloqué. Il s’agit plus seulement d’utiliser ce que je vis en l’incorporant plus tard à mes écrits. Désormais, au moment même du vécu, je le ressens déjà comme faisant partie de mon œuvre. Y a plus de transition, d’ajustements, de médiation. Tout m’apparaît d’emblée d’une manière littéraire, les idées jaillissent sous leur forme définitive.
Ça peut sembler malsain, comme une sorte de dédoublement qui m’empêcherait d’être dans le présent. Mais peut-être que c’est le vrai mode de fonctionnement de l’artiste. Quand son vécu et ses visions lui apparaissent direct comme… de l’art.
Plusieurs fois je me suis demandé si tout ça n’était pas qu’un monstrueux fantasme narcissique, une mise en scène de soi-même bouffie d’orgueil et entachée d’ego. Mais je peux pas nier mon ressenti, ni foutre du plomb dans l’aile de ce rêve en train de s’accomplir. J’ai jamais vraiment chercher à comprendre cette phrase qui dit que l’art imite la vie, et la vie l’art, mais bordel, je crois que je suis en plein dedans.
Et en fait, c’est pas la première fois que ça m’arrive. Je me souviens qu’il y a très longtemps, Borderline s’écrivait constamment dans ma tête, au point que parfois ce soit Travis qui passe au premier plan, dans mes actes, dans mes paroles.
Le vécu avait déjà transmuté en art, tout au fond de mon cerveau.
Transformer son voyage en histoire
J’ai quitté Minca, résolue à m’approcher du désert le plus vite possible. Y avait plein de trucs cool entre deux, que j’aurais pu m’arrêter pour voir, mais la crainte de replonger dans le tourbillon de vacanciers m’a incitée à tracer la route. La mer des caraïbes est superbe, c’est pas le problème, mais je commençais à fantasmer sur les petits villages montagnards que je savais devoir trouver plus loin, et l’appel de ce fichu désert rugissait si fort qu’il m’était impossible de le faire patienter quelques jours de plus.
J’ai aucune intention d’expliquer ce qui s’est passé dans la Guajira, et je subodore que ça risque d’arriver de plus en plus fréquemment à travers ce journal. Je sais pas ce que les lecteurs de ce type de carnet sont en droit d’attendre, et pour tout dire, je m’en contrefous. Je sais pas non plus si ce que je m’apprête à faire a déjà été fait, avec plus ou moins de succès.
A partir de maintenant, certains événements de ce voyage ne seront plus rapportés comme un catalogue de faits, mais directement sous la forme qu’ils ont inspirée. Pour le désert, ce sera donc La Passagère, et ceux qui souhaiteraient quelques éclaircissements devront se contenter de sa genèse. Lors de la publication de ce journal, la nouvelle sera incorporée entièrement et il en sera de même si d’autres voient le jour.
N’est-ce pas la meilleure manière de comprendre comment travaille un écrivain ? De passer directement du vécu à la littérature ? Ça m’étonnerait que je sois la première à le tenter…
Ça m’a fait bizarre de retrouver la ville après ça. Passer d’une réalité à l’autre laisse parfois un goût étrange, bien que ce soit le but de tout voyage. La flexibilité mentale et corporelle exigée par la vie nomade est une vraie gymnastique, et une fois qu’on a chopé le coup c’est plutôt facile de s’adapter. Même si parfois l’écart est vraiment énorme.
C’est aussi de cette manière qu’on parvient à identifier le soi véritable. Qu’est-ce qui reste au cœur d’une personne ? Quel est l’élément qui ne change jamais ? Que peut-elle désigner comme “je” envers et contre tout ?
Il me restait quelque chose auquel je pouvais me connecter, et sur le toit de l’hôtel, au coucher du soleil, je l’ai fait. Ce geste, cette posture. Cette chose gravée en moi, à laquelle je pourrai désormais toujours me relier pour faire revivre ce que j’ai connu.
Sur les traces d’un autre écrivain
J’ai débarqué à Valledupar bien trop tôt à mon goût. C’est pas que cette ville soit repoussante mais il faisait une chaleur à crever et le côté non touristique de ce bled faisait que tout le monde me dévisageait et que les mecs étaient tous derrière mon cul. C’est d’ailleurs ce même aspect qui m’a contrainte à payer une pauvre bière en cannette 8000 pesos, plus du double du prix habituel. J’ai fait au barman : T’es sérieux, mec ? Et moi qui suis d’une nature très polie, j’ai balancé le fric sur le comptoir sans même attendre sa réponse et sans même me retourner. Parfois ça fout la rage d’être traitée comme une touriste.
J’étais bien contente de me barrer le lendemain, d’autant plus que je me rendais à Mompox, bled auquel je rêvais depuis un moment. C’est celui qu’a inspiré Gabriel García Marquez pour Cent ans de solitude, bien qu’il ne l’ait jamais présenté ainsi. La chaleur était toujours complètement maboule, mais les abords du fleuve et le charme infini du village la rendait largement supportable. C’est marrant, Mompox a l’air du truc colonial de base, avec ses édifices désuets et colorés, mais les rues poussiéreuses et les rives du Rio Magdalena qui s’animent de chants d’oiseaux exotiques et d’iguanes qui grimpent aux branches lui offrent une identité très personnelle, que j’avais jamais rencontrée ailleurs. Et son cimetière…
Les deux jours que j’ai passés là-bas, j’ai marché et marché encore dans les rues, à toute heure du jour et de la nuit. Il y a parfois des atmosphères dont on éprouve le besoin de s’imprégner encore et encore…
Mais ma maison m’attendait et une longue journée de transport pour m’y rendre aussi.
Flics, capotes et retraite de romancier
J’ai quitté Mompox à 7h du matin, dans un bus vide et très confortable. Les champs d’un vert électrique où paissaient des vaches à l’air indien étaient parfois traversés par le fleuve, si bien que toute cette région donnait l’impression d’un berceau fertile où la vie trouvait à s’épanouir dans toutes les directions.
L’endroit où j’allais était pas mal reculé, j’ai dû changer de bus plusieurs fois. Le premier m’a lâchée au milieu de nulle part où des taxis collectifs attendaient. C’est assez fréquent dans les petits villages. De simples voitures qui attendent d’être pleines avant de décoller. Je me suis glissée au milieu de quatre bonhommes qui semblaient surpris qu’une gringa débarque dans leur monde. Ils étaient pas spécialement hostiles, mais pas vraiment chaleureux non plus.
J’ai appris à me fermer à ce genre de truc. Je suis de toute manière pas très causante moi-même, et à la différence de beaucoup de touristes qui sont enchantés dès qu’ils ont le sentiment d’avoir un “vrai contact avec des locaux”, moi ça me fatigue quand on me parle et je déteste avoir à répéter ma leçon en racontant les étapes de mon voyage au premier qui se pointe. Peut-être bien que je me coupe “d’expériences authentiques” en ayant cette attitude, mais au fond ça fait longtemps que j’ai complètement démonté le mythe du gentil sauvage, et vous m’excuserez mais cette recherche frénétique de contact local n’est selon moi ni plus ni moins que ce principe déguisé.
Chacun sa vie, et je me figure pas d’être en train de réaliser quelque chose d’exceptionnel pour avoir à le raconter au premier venu. Je prends un taxi, c’est tout. Je fais la route. Toi tu vas traire ta vache ? Cool, à la bonne heure !
Mais quand on est étranger et qu’on tombe sur un barrage de flics, bah on est comme qui dirait en ligne de mire. Le keuf nous a fait signe pour qu’on s’arrête et en me repérant il s’est immédiatement attaqué à mon sac dans le coffre. J’ai patienté deux minutes, mais connaissant la manie des flics de foutre le bordel dans tes affaires sans rien ranger derrière, j’ai fait à l’un des types qui me coinçait sur le siège du milieu : Je voudrais sortir. La situation avait l’air de le faire rire, j’ai pas du tout aimé le regard qu’il me faisait, alors j’ai insisté : Tu me laisses sortir, s’te plaît ? Merci. Il s’est écarté et je me suis radinée près du flic pour l’aider à fouiller l’entièreté de mon sac correctement. Il a pas omis une seule poche, l’enculé. La moindre zone de ma trousse de toilette y a eu droit, et j’étais bien contente quand il est tombé sur les rubans de capotes et les a tenus comme un débile devant sa gueule. Son condónes, j’ai fait en levant un sourcil narquois, comme s’il était trop jeune pour savoir à quoi ça servait. Il les a vite rangés et la fouille était finie. Tête de con, va.
Après ça, fallait encore que je me tape un autre bus, et le taxi collectif m’avait laissée un peu n’importe où. J’ai dû prendre un autre taxi pour aller au lieu d’où partaient les colectivos.
Je savais pas vraiment à quoi m’attendre en montant dans le dernier transport. Est-ce que le village que j’avais élu pour y résider une semaine me conviendrait vraiment ?
Au bout d’un quart d’heure de route, j’ai compris que j’étais encore sur un chemin tracé d’avance. On fonçait dans les montagnes rocheuses dont la terre était rouge cuivre, et la pierre montait en formations qui rappelaient celles du désert de l’Ouest américain.
J’avais atteint un nouveau nœud sacré dans l’espace-temps.
La Playa de Belén est un tout petit village. La maison se trouvait au bout d’une rue, au pied des roches, face à un champ de bananiers. Hormis la voisine très discrète, y avait personne.
Et la maison… Bordel, et ça, pour moi toute seule !
Évanouissement des frontières : Quand la vie imite l’art (et inversement)
Une partie de ce qui était né en moi quelques jours plus tôt dans le désert avait déjà fini de germer.
Dès le lendemain de mon arrivée, j’ai prévenu la propriétaire de la maison que je voulais rester deux semaines entières au lieu d’une. Quand un écrivain-voyageur tombe sur un endroit où son inspiration est à son point culminant, qu’il sent que le combustible dont il a farci son moteur durant les deux mois précédents gronde dans les entrailles de son engin pour être utilisé, il faudrait être fou, ou extrêmement stupide ou flemmard pour ne pas tout mettre sur pause et passer ses journées entières à écrire.
C’est ce que j’ai fait. La totalité de l’air que j’inspirais était imprégné d’écriture, les mots me poursuivaient lors de mes quelques sorties au village, j’étais dévorée par l’impatience de retrouver la maison pour les jeter sur l’ordi et me libérer d’eux.
Un autre événement a coïncidé avec la naissance du projet dans lequel je me suis lancée durant ces semaines-là. La nouvelle que j’avais soumise à un appel à texte avait été refusée (il s'agit de Un jour toi aussi…), et je l’avais donc publiée ici.
J’ai réalisé que d’autres nouvelles ne demandaient qu’à exploser.
Cette histoire de désert se devait d’être creusée, à travers différents regards, différentes histoires, les personnages étaient en train d’émerger les uns après les autres, chacun avec son propre chant, sa propre folie, la route de perdition singulière qu’il suivait.
Moi qu’avais jamais écrit de nouvelles, j’ai été effroyablement prolifique ! C’est fou comme l’écriture peut parfois devenir un effort surhumain quand les idées ne sont pas mûres, et à quel point elle peut être aussi furieuse qu’un étalon qui piaffe et danse sur lui-même quand elles sont en train de sortir de terre, affamées de lumière et de vie…
Borderline aussi a eu droit à sa poussée de croissance. Moi qui me croyais incapable de mener plusieurs projets de front, je me retrouve maintenant avec trois bébés sur les bras : Borderline 5, les Chants du Désert, et ce putain de Diario.
La vache, heureusement que je dors à peine depuis que je suis partie.
Le chien guide des cimetières, les aigles gardiens du désert, le gamin chaperon et des légumes secs à tous les repas
Y a quand même quelques événements qui méritent d’être rapportés ici, qui se sont produits durant ces deux furieuses semaines.
Le premier, c’est ma visite du cimetière de La Playa en compagnie du chien. Je passais devant l’église quand un jeune cabot tout maigrichon s’est foutu dans mes jambes en m’adressant un regard aimable avant de s’engager sur sa gauche. Y avait une grille, ouverte, surmontée d’une croix. Sans ce chien, j’y aurais pas vraiment fait attention. Souvent le cimetière du village se trouve près de l’église, mais c’est loin d’être systématique. En voyant la croix, et bien qu’une sorte de sentier pavé semblait monter après la grille, j’ai tout de suite su que c’était ça. Une amoureuse des cimetières latinos comme moi peut pas passer à côté sans y pénétrer. J’ai donc suivi le clébard qui paraissait m’attendre, et c’est bel et bien à une visite guidée que j’ai eu droit !
Ce cimetière est très original, puisqu’il faut d’abord monter une sorte de chemin de croix, ponctué de miradors offrant des points de vue magnifiques sur le village et les montagnes rocheuses alentour, pour y accéder. Le chien semblait avoir à cœur que je loupe aucun de ces points de vue ; il empruntait des petits sentiers cachés pour que je grimpe derrière lui et aille admirer la perspective nouvelle que chacun ouvrait sur la région, si bien qu’au lieu d’une vague demi-heure que m’aurait normalement demandé la visite, je suis restée deux heures à le suivre dans tous les coins.
Parvenus là-haut, l’envoûtement est total, et on peut pas s’empêcher de se demander si la mort est plus douce quand on repose dans un lieu comme celui-là. Les tombes font face à la montagne, tout en hauteur, caressées par un air sec et un soleil mordoré. C’est idiot, mais les mots “repos éternel” louvoyaient dans mon esprit en continu, et pour une fois j’avais l’impression qu’ils voulaient vraiment dire quelque chose.
Le second événement, c’est ma visite des Estoraques, lieu mythique dont je rêvais depuis un moment, et qu’avait largement contribué à ce que je loue cette fichue baraque. Il suffit que je lise “formations rocheuses étranges” ou bien “repère d’aigles et de serpents” pour être prête à me taper trois bus et me rendre à la frontière du Vénézuela dans un bled microscopique où les gens chuchotent sur mon passage tant ils voient peu d’étrangers.
En arrivant à l’entrée, l’un des deux mecs qu’étaient là pour faire payer le droit d’entrée (ouais, c’est un parc national) a tenté de m’entreprendre, mais j’ai déjoué ses plans et découragé ses tentatives foireuses de séduction. Je craignais qu’il se mette dans l’idée de m’accompagner, et déjà que j’évite autant que possible de prendre un guide quand c’est pas absolument nécessaire, c’est pas pour me taper un lourdingue de base dans les bottes.
Bref, c’est finalement seule que je me suis engagée sur le sentier. J’ai pas vu âme qui vive de toute ma visite, ça aurait pas pu être plus parfait. Encore du désert… Un autre, mais avec la même énergie. Ces senteurs de garrigue et d’argile sèche, le silence déchirant des aigles qui traversaient mon ciel pour rejoindre leurs nids, très haut perchés dans le creux des roches aux formes totémiques, le bruissement des herbes jaunes où murmurait le vent et détalaient les lézards à mon approche, la fraîcheur surprenante des grottes, ces arbustes qui croissaient sur les pierres et se tendaient entre les parois pour que leurs feuilles atteignent la lumière…
Qu’y a t-il d’autre à espérer, sinon de se sentir appartenir à un tel monde ?
Les énergies qui s’étaient levées pour moi dans la Guajira ont tendu leurs antennes pour recevoir ce nouveau combustible. Tout était encore vivant, encore très près de la surface, j’ai pas eu d’effort à fournir pour les réanimer. J’écrivais sur le désert depuis deux semaines, le désert vivait en moi de sa vie propre, et voilà que je replongeais en lui comme un embryon dans la matrice.
Un tel niveau de connexion est l’expérience la plus proche de l’extase, la plus jumelle de la transe que je connaisse. Savoir que je peux y accéder par mes propres moyens, disparue au monde dans ma puissante solitude, c’est ça qui me maintient en vie et alimente le feu sacré qui m’incite à continuer, toujours plus loin, aussi loin qu’il le faudra, pour la faire naître encore et encore…
Un autre jour, j’ai aussi marché jusqu’à la forêt de pins et pris les premières photos qui serviront un nouveau projet artistique avec mon ami Bruno Leyval.
Et puis une fois, en cherchant un mirador que j’ai jamais trouvé, j’ai atteint le sommet d’une colline, et j’ai vu le cimetière, juste en face, à la même hauteur. Il était beau depuis ce point de vue aussi.
Et puis il y a eu un autre chien guide, et un gamin aussi, Pedro. J’étais retournée au cimetière et avais repéré un chemin qui partait dans les montagnes. En m’engageant dessus, un petit chien noir m’a suivi, puis c’est un gosse que j’ai récupéré en chemin. Le sentier partait derrière sa maison et il a proposé de m’accompagner. On est retournés jusqu’aux Estoraques en passant par derrière, le chien sur les talons.
On a pas mal papoté tous les deux. Il était très ouvert pour un gamin de 11 ans, et très curieux, empli de questions intelligentes. A la fin, il m’a demandé mon nom, m’a dit le sien, et celui du chien qui nous suivait depuis le début : Niña, une chienne en fait, qui prenait un malin plaisir à guider les touristes dans le secteur (oui, y en avait quand même parfois, bien que j’en aie vu aucun durant mon séjour). Et c’est vrai que le jour de mon départ, en attendant le bus sur la place, j’ai aperçu cette petite chienne qui vivait dans la rue et des gens du coin l’appeler joyeusement par son prénom : Niña, Niña ! Un petit guide local, enjoué et gratuit, que tout le village connaît.
La dernière chose que j’aimerais rapporter ici, c’est l’étrange satisfaction que procure le fait de vivre d’une façon très simple, limite ascétique. C’est con, mais y avait pas de distributeur de fric dans ce bled, et vu que je pensais pas rester si longtemps, j’avais pas prévu d’avoir beaucoup d’espèces sur moi. Il a donc fallu gérer avec le peu que j’avais…
Ça tombait plutôt bien que les rares tiendas du village ressemblaient aux supermarchés de l’ex Union-soviétique : que du basique. Du très basique.
C’est marrant, pour nous qu’avons l’habitude d’avoir le choix entre un nombre parfaitement terrifiant de marques qui vendent pourtant exactement la même merde, de se retrouver face à ça. Tu veux du riz ? Voilà du riz. Des lentilles ? Pas de boites de conserve, prend donc ce petit sachet de lentilles sèches. Des légumes et des fruits ? Arf, y a bien une ou deux carottes qui traînent, et puis regarde, t’as de la chance, aujourd’hui on a eu un arrivage de petits pois frais.
Voyez le délire ? Eh bien, j’ai appris à me satisfaire de très peu, et surtout à cuisiner mes propres arepas, avec la farine de maïs qu’on est au moins sûr de toujours trouver ici ! Ainsi recentrée sur l’essentiel, à manger mes aliments bruts et dédiée à écrire, cette ascèse m’a rappelé ma diète d’ayahuasca, où je bouffais quasiment rien non plus : riz complet, avoine à l’eau, bananes plantain. Je me demande si ce genre de phase n’est pas bénéfique à l’écriture, ou du moins au dévouement à un but plus élevé. Débarrassé du superflu, entièrement dédié à la tâche qui t’incombe, que tu t’es choisie comme prioritaire, le boulot se fait avec une sorte d’urgence, de nécessité absolue.
Mec bourré à 7h du mat, le Seigneur, et une faille dans la Terre
Une très longue journée de bus m’attendait, mais je l’ignorais en quittant ma maison à 6h du mat. Je me suis retournée une dernière fois pour regarder cet endroit où j’avais connu une telle paix, une telle inspiration, et j’ai remercié l’univers d’avoir si bien placé ses pièces sur l’échiquier.
Arrivée à Ocaña, j’ai pris le temps de fumer une clope avant d’enchaîner les transports, et un mec un peu chelou m’a abordé. Jeune, pas menaçant, mais un brin tapé de la cafetière quand même. Il m’a abordée avec une phrase que j’ai pas pigée, j’ai voulu jouer l’idiote qui parle pas la langue, manque de bol ce type baragouinait l’anglais, et c’est donc moitié en anglais moitié en espagnol qu’on a engagé une étrange conversation, pas mal décousue.
Rapidement il m’a appris qu’il était bourré, ce qui expliquait des tas de trucs. Il se demandait ce qu’une Française foutait dans ce bled paumé, et m’a appris que son frère était mort récemment et qu’il restait quelques semaines chez ses parents. Je crois qu’il était gay, et en tant qu’homme capable de se mettre à la place des femmes, il m’a rassurée en me disant qu’il en avait pas après moi, et que ça devait être difficile à gérer parfois, en tant que femme, dans ce pays assez macho. Malgré tout, son flot de paroles de beau matin m’épuisait les neurones et j’ai coupé court en lui disant que je devais prendre mon bus. Il a eu l’air déçu, d’autant plus qu’il tenait de toute force à me payer un chocolat chaud, mais moi je suis le déversoir de personne. Si à une époque j’avais tendance à me montrer trop disponible face à n’importe quelle âme errante, c’est terminé.
Alors que j’attendais mon bus un peu plus loin, il est revenu me tenir la jambe mais le chauffeur m’a sauvée en m’appelant. Pardon, vieux, mais chacun sa route.
C’était encore un micro-bus, à croire qu’y avait que ça dans cette région, mais ça m’allait bien. Pour la pause de midi dans un comedor de bord de route, j’ai papoté avec les deux femmes qui voyageaient à mes côtés sur la banquette arrière. Une Chilienne en vacances et une Colombienne qui rentrait d’une visite à ses petits enfants. Toutes deux étaient folles de nature et une phrase de la Colombienne m’a marquée. Alors qu’on avait repris la route, elle m’a demandé en observant amoureusement le paysage : Comment Dieu a pu imaginer tant de beauté en ce monde ? Comment il a pu créer tout ça ? La partie cynique de mon esprit a répondu : L’évolution, ma bonne dame, tandis que l’autre, la partie spirituelle, lui disait : Moi aussi je me le demande…
Arrivée à Bucaramanga, c’était toujours pas fini, et j’ai donc pris un nouveau colectivo pour mon ultime destination. Je savais qu’on allait passer par le fameux canyon del Chicamocha, et malgré ma fatigue cette idée me réjouissait. J’ai pas pu faire de photos convenables depuis le bus, mais cette faille immense en plein cœur de la Terre était de toute beauté, et la route en elle-même, avec ses cactus sur les côtés et sa terre rouge, incendiée par le soleil en train de se coucher, restera pour moi un brillant souvenir.
Ça faisait longtemps que j’avais pas débarqué de nuit dans une ville sans avoir rien réservé comme hôtel. Ça m’a rappelé un soir au Pérou, pas loin de Tarapoto, quand je me dirigeais vers la frontière de l’Équateur, et que j’étais tombée dans un hôtel de passes. Le genre de bon matos pour un écrivain, et ce passage se trouve d’ailleurs dans Borderline 1. Ouais, j’y peux rien. En fait, j’ai jamais cessé d’écrire, je m’en rends compte de plus en plus…
J’ai trouvé un hôtel sans mal, vraiment pas cher et très clean. La femme qui m’a accueillie semblait toute ravie que je porte le même prénom que sa fille (ce qui est très rare dans ce pays, la plupart des gens n’arrivent même pas à prononcer “Zoë” correctement).
Je me suis douchée (eh merde, encore de l’eau froide) et suis tombée dans le lit sans même bouffer. Mais au fond, j’adore les journées de voyage épuisantes où tu pars de nuit et arrive de même. Putain, c’est tellement excitant !
Le choix de l’écriture ; quand la réalité rejoint la fiction
J’aurais pu faire des tas de trucs de touriste à San Gil, du style canyoning et parapente, mais si je veux que mon voyage dure longtemps, je suis forcée de me restreindre. Et je suis désormais convaincue que ce qui m’intéresse le plus, c’est de vivre sur la route, et d’écrire, alors je suis prête à renoncer à quelques trucs pour me concentrer sur ça. D’ailleurs, depuis la maison, je favorise les hôtels pourvus d’une cuisine à disposition des clients, et putain ça me fait faire de sacrées économies !
C’est ce type d’auberge que j’ai choisi à Barichara, autre village enchanteur mythique sur lequel je fantasmais depuis mon premier séjour en Colombie. Rien à faire, ce genre d’ambiance est favorable à l’écriture, beaucoup plus que celle, torride et endiablée, des caraïbes, et navrée si je défonce le mythe de l’auteur rock n’ roll, mais même cet enfoiré d’Hunter S. Thompson n’a rien pondu de valable à Puerto Rico !
Et puis, ce village abrite la véritable église du tome 1 de Borderline, et rien que pour ça, ça valait le coup. Quand je suis entrée dedans et que j’ai vu ce Christ accroché en face avec ses yeux de souffrance au ciel et sa couronne d’épine sur la tête, j’ai su qu’une fois de plus, ma fiction rejoignait ma réalité. Et si les fans aiment visiter les lieux qui ont inspiré les livres, moi j’adore me balader au sein des miens, et découvrir que ce que j’ai décrit existe quelque part, alors que j’en savais rien en l’imaginant.
Moi j’aime la magie, surtout quand elle concerne la vie de Travis et la mienne.
Et puis cette lumière au coucher du soleil depuis les hauteurs…
Se bourrer la gueule avec une célébrité locale
J’ai continué ma descente vers le sud en me rendant à Guadalupe, connu pour ses rivières aux trous d’eau. J’ai enchaîné les micro-bus et pour finir suis montée dans une sorte de pick-up avec des bancs en bois et une bâche par au-dessus, comme ils ont parfois ici. Y avait seulement un type à l’arrière avec moi, alors on a taillé le bout de gras. Il m’a raconté que depuis la pandémie, il avait quitté Bogotá et sa vie de bureau pour revenir sur les terres de son enfance et reprendre la finca (ferme) familiale, à cultiver des fruits. Avec le soleil et l’eau qu’y avait dans la région, on peut dire que ça marchait plutôt bien, même s’il gagnait moins qu’avant, mais la tranquillité qu’il connaissait ici valait selon lui tout l’or du monde.
Dieu sait que c’est un truc que je peux comprendre. Vivre modestement, mais être… plus heureux ? Lui et moi, on se demandait ce qu’on était censés faire du fric quand on travaillait tellement qu’on avait même pas le temps d’en profiter, attaqué par le stress de ce genre d’existence qui bouffe sur pied l’essence même de la vie.
Ces quelques jours dans ce bled ont été sacrément cool, l’écriture marchait toujours, et avec ces splendides rivières à quelques kilomètres de marche du village, la récompense après le boulot était instantanée. Entre-deux, j’ai quand même trouvé le moyen de me faire interviewer depuis la France pour une émission de radio, et m’empilonner la gueule avec le mec le plus connu de Guadalupe !
Il m’avait fourgué sa carte à mon arrivée, alors que j’étais encore dans le pick-up (on l’avait croisé pour déposer le bureaucrate reconverti en fermier, et, repérant la gringa, il avait fait ni une ni deux), et puis quand il m’avait trouvée devant la porte de mon auberge, il s’était proposé d’appeler la proprio pour l’avertir de mon arrivée. Je savais qui était ce type rapport à mon guide Lonely Planet, qui le présentait comme le premier à avoir développé le tourisme dans la région, en offrant ses services de guide.
Du coup, quand l’envie de faire un tour de cheval s’est fait sentir (j’ai oublié de signaler que ce village était un haut lieu de cowboyerie, les hommes portaient fièrement le sombrero et on pouvait les voir, sur leurs chevaux, réunir les vaches dans les champs), j’ai ressorti sa carte de visite et lui ai envoyé un message. Il avait pas de plan pour louer un cheval, mais en revanche il m’a proposé de le retrouver à l’hôtel dont il était le dueño (tiens tiens), en plein sur la plaza mayor.
On s’y est mis direct. Cerveza sur cerveza, le courant passait foutrement bien entre nous. Au bout d’un moment, je lui ai fait : Et alors, comment on fait pour devenir le mec le plus célèbre de la région ? Apparaitre en “coup de cœur” du Lonely, Hombre, y a des gens qui tueraient pour ça !
Il s’est fendu la poire avant de me mettre au parfum du délire ; j’ai eu droit à toute sa biographie, qu’était du genre intéressant. La façon dont il avait tenté de fuir le service militaire, comment ils l’avaient finalement chopé, pour qu’au final il devienne infirmier de l’armée et sauve des vies pendant treize ans. Un mariage foireux, deux filles, puis le retour au bercail. Ouverture d’un resto qu’a bien marché, rencontre avec un gringo amerloque complètement allumé avec qui il a sympathisé, à qui il a fait découvrir la région. Y se trouve que ce mec tenait un blog de voyage, l’un des premiers sur la Colombie, et qu’il a parlé de lui. Ce type taffe désormais pour le Lonely Planet. Et voilà comment on connaît la gloire !
Déjà passablement torchés, on est partis sur sa moto pour aller voir le coucher du soleil depuis le haut des montagnes, sans oublier bien sûr de se prendre des munitions en chemin. Là-haut on a retrouvé le couple de Belges qui squattaient l’hôtel, ce qui fait qu’on a dû partager nos bières. C’était des petits jeunes (faut que je m’y fasse, désormais tous ceux que je rencontre sont des gosses de 20 ans !), avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à parler, au point de poursuivre la conversation en rentrant. Avec la star locale on est repartis à moto, mais vu qu’on avait un peu pitié du couple qui s’était tapé toute la route à pied, on a pris des bières et changé de véhicule pour aller les récupérer en caisse. En mettant de la zik, le mec célèbre nous apprend qu’il a eu les CD livrés avec la voiture quand il l’a achetée, mais qu’il fatigue un peu d’écouter toujours les mêmes, alors moi je fais : Bah faut que t’achètes une nouvelle caisse… Ça nous a tordus de rire.
Allumée comme je l’étais par toute cette biture quand les gosses m’ont lancée sur mes bouquins, et entourée des bonnes ondes que diffusaient ces chouettes gens tout autour de moi (z’avez jamais remarqué que c’est plus facile de s’exprimer quand les autres vous écoutent vraiment, alors que vous bafouillez quand leur attention est naze ?), j’étais là, debout face à eux posés sur les canapés, une bière à la main, une clope dans l’autre, à m’enflammer au sujet de Borderline, de l’ayahuasca, de la vie sur la route et de la liberté, et c’était bon, putain, c’était tellement bon de se sentir comprise et écoutée comme ça que je pouvais plus m’arrêter, tout en culpabilisant de monopoliser la parole, mais voilà ce qui arrive après des semaines de solitude : quand ça sort, c’est l’inondation !
Bref, les jeunes ont fini par aller se pieuter, et j’ai laissé le dueño avec les Pink Floyd en fond sonore, pour rentrer complètement pétée par les rues noires du village.
Quête personnelle, páramo et fendage de gueule à 3800 mètres d’altitude
J’avais repéré un tout petit village qu’avait l’air inspirant, mais j’avais omis de vérifier à quelle altitude il était, si bien que quand j’ai débarqué là-bas à 19h, après une journée complète de bus (j’étais partie à 7h), en short, j’étais frigorifiée ! Mais l’hôtel que je m’étais trouvé était du style auberge chez l’habitant, et la gentille tenancière m’a fait une soupe que j’ai avalée direct en compagnie des autres clients qu’étaient là, une Américaine et un Québécois. La gonzesse a bouffé et s’est tirée, et l’autre a fait : Ah, on peut enfin parler français !
Je sais plus comment on en est arrivés là, mais soudain on parlait de nouveau ayahuasca, quête personnelle, en se demandant si on devrait pas tout lâcher pour de bon au lieu de se comporter en touristes, qui certes voyagent sur de longues durées, mais gardent toujours au fond de leur tête l’idée que tout ça n’est que passager, que leur cocon les attend encore, et, pire encore, avec la volonté sous-jacente d’en retirer quelque chose d’exploitable (ce mec-là tenait aussi un blog, faisait des vidéos, et était musicos), comme pour transformer tout ça en… produit.
Vers la fin, on en était à parler physique quantique et synchronicités. Messages qu’un moi futur envoie au moi passé via l’intuition et les signes. Continuum temporel. Réécriture permanente de son histoire personnelle. Du lourd, en fait, même si en ce qui me concerne, ces sujets sont ceux qui me passionnent le plus. Étrange quand même de se trouver perdue dans un bled comme Monguí à 2500 mètres d’altitude avec un parfait étranger, et d’en arriver à évoquer des choses si profondes, et si intimes, en définitive, sur sa propre vie.
Dommage, ce mec-là se barrait le lendemain, mais j’ai fait le trek du páramo (plaine de haute montagne) de Ocetá avec l’Américaine, un Égyptien et deux Colombiens de Medellín. A la base, j’aurais voulu attendre le lendemain pour me taper ce truc, mais voilà, l’excursion avec le guide était prévue ce jour-là, et tant qu’à faire, j’allais pas jouer les chochottes, alors à 5h du mat j’étais debout en train de fumer ma clope face au champ des vaches, par 5 degrés. Je sais pas comment j’ai trouvé le courage de prendre une douche tiède dans la salle de bain commune glaciale. Et à 6h30 on était partis.
Y a toute une histoire au sujet de ce páramo que les indigènes protègent farouchement, et dont ils autorisent l’accès aux touristes ou non, et là c’était un peu sur le fil, mais notre guide a trouvé moyen de moyenner, même si on a dû se taper à pied une partie qui normalement se fait en 4x4, amenant la distance finale parcourue ce jour-là à 22km de marche, sachant qu’on passe de 2500 à 3800 d’altitude (donc méchant dénivelé). C’était rude, mais ça valait le coup. C’est pas le premier páramo que je vois (j’avais fait un trek à cheval de trois jours vers San Agustin, pour me rendre à l’endroit où naît le fameux Rio Magdalena qui traverse tout le pays, qui est aussi un páramo), mais c’est toujours aussi surréaliste et spectaculaire. Ces plantes endémiques, ces couleurs qu’on ne voit nulle part ailleurs, ce brouillard…
Et puis évidemment, je me suis fait pote avec le guide, lui-même poète à ses heures, et je l’ai tordu de rire en étant selon lui extrêmement direct avec mes gros mots et mon humour du genre mordant. Par exemple, on parlait du fait d’être reconnu en tant qu’artiste. D’une manière générale, tout le monde n’arrête pas de me dire que ça finira par m’arriver, qu’y faut pas que je désespère. Bah là, pour le coup, je lui ai sorti : Ouais, n’empêche que t’as tout un tas de clampins qu’ont jamais été reconnus de leur vivant, et qui sont morts dans la pauvreté comme de sombres merdes inconnues avant que, trois siècles plus tard, quelques baltringues se décident à reconnaître leur talent et crient finalement au génie. Bordel, mais fallait se réveiller avant, les gars, allez vous faire foutre ! L’autre est mort dans la misère parce que personne voulait faire l’effort de reconnaître sa valeur, et maintenant tout le monde lui jette des fleurs ? Ça vaut bien le coup, tiens ! Nan, la vérité, c’est que c’est tout à fait possible que je finisse serveuse comme une débile, et voilà, à ce stade c’est une question de destin, c’est comme ça.
Moi je trouve pas ça spécialement direct, mais j’ai fait rire tout le monde, une fois de plus. Je crois que c’est surtout le côté désabusé qui fait marrer les gens. C’est vrai, remarque, moi aussi ça me fait rire !
A force de discuter avec beaucoup de monde, j’ai appris quelque chose qui chagrine pas mal mes plans. Depuis la France, avant mon départ, j’ai prévu de rejoindre le Pérou par le fleuve Amazone. A l’extrême sud de la Colombie, les frontières du Brésil, du Pérou et de la Colombie donc, se touchent, et il est possible de rejoindre Iquitos par voie fluviale. Et vu que moi je prends jamais l’avion pour faire des sauts de puce dans un même pays ou d’un pays à l’autre (cela dit je vais devoir le faire bientôt…), c’est exactement ce qu’il me faut, d’une parce que je connais déjà l’Équateur (pays frontalier de la Colombie, seule autre voie qui permet de passer au Pérou par voie terrestre) et que c’est précisément comme ça que je suis arrivée en Colombie la dernière fois, de deux parce que j’adore l’aventure, et que même si c’est pas du Mike Horn, bah ce périple en bateau s’en approche pas mal quand même !
Mais apparemment, c’est pas possible en l’état actuel. Disons qu’ils te laissent passer, mais refusent de te tamponner le passeport, ce qui peut s’avérer très problématique (j’ai beau être une aventurière, de là à passer en mode clandestino, y a des limites).
Et donc, j’ai pris une décision, qui à vrai dire faisait déjà son chemin en moi depuis un sacré bout de temps.
Marcher sur d’anciennes traces et voir des fantômes
J’écris ces lignes depuis Villa de Leyva, le village où j’ai été confinée 4 mois en 2020. C’est quand j’étais ici que Wish est mort. Et c’est d’ici que j’ai publié le Tome 2 de Borderline (je ne compte pas revenir dessus, ceux qui souhaitent des précisions, filez lire mon autobiographie).
J’ai pris la décision de rester dans ce village pendant un mois, à écrire. Je vais demander une prolongation de visa pour rester six mois en Colombie au lieu de trois. De cette manière, je donne une chance à la situation frontalière de se réguler, à Borderline 5 de s’écrire, et ça me laisse une marge financière pour poursuivre les plans magnifiques que j’ai encore en réserve avec ce pays (plans qui comprennent, pour le coup, deux vols internes, mais j’ai pas le choix). Ces projets risquent d’être coûteux, c’est pourquoi rester ici un mois entier, dans un appartement que je loue, va me permettre d’économiser à mort afin de claquer mon fric pour ces expéditions qui me tiennent vraiment à cœur.
Et la vérité, c’est que je suis carrément ravie de me consacrer à l’écriture pendant un mois entier depuis ce village qui est porteur d’une si lourde charge émotionnelle pour moi.
C’est pas la première fois que je reviens sur mes propres traces, des années après. J’avais déjà fait le coup avec le Pérou, en y remettant les pieds 10 ans plus tard. Il me semble que je peux encore voir le fantôme de celle que j’ai été, en train de marcher sur les chemins hors du village…
C’est une manière unique de mesurer sa propre évolution. Quels espoirs est-ce que je nourissais à l’époque, quels étaient mes rêves, mes priorités, mes peurs ?
Me voilà pile-poil 2 ans plus tard, et le bilan est loin d’être dégueulasse. Je compte pas me jeter des fleurs, mais il est clair que j’ai accompli tout ce que je m’étais promis, et plus encore.
Et bordel, c’est exactement ce que je vais continuer à faire.
Se rendre au Diario Latino #6.
© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés
La Passagère, Background : Une Histoire Personnelle
Pour un artiste, il est toujours plus intéressant d’utiliser le matériel dont il dispose - surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose qu’il a éprouvé intimement, dans sa chair - en l’incorporant à son œuvre, d’une manière détournée qui le sublimera, plutôt que de le dilapider en paroles ou en mots creux qui jamais ne sauraient rendre honneur à ses sensations et à ses visions. En tant qu’écrivain-voyageur qui tient un journal de voyage en parallèle du reste de ses œuvres, il fallait faire un choix. La Passagère est le mien. Et en dehors de cet article, je n’écrirai pas un mot de plus sur ce qui m’est arrivé dans ce désert.
Elle va marcher tout droit vers le soleil jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Genre : Autofiction
Le Pitch
Une voyageuse amoureuse du désert décide de le traverser jusqu’à ce qu’elle comprenne pourquoi son appel rugit en elle depuis toujours.
La Genèse
Préambule
Quand il t’arrive quelque chose que les mots semblent incapables de transcrire, qu’est-ce que tu fais ?
Si tu es écrivain, tu t’efforces d’en parler quand même, mais en usant d’une forme qui s’éloigne de la simple description de faits, pour entrer dans une zone où le langage propre aux rêves et aux visions saura esquisser les contours d’une expérience transcendante.
Et si ton propre vécu peut servir à donner vie au personnage d’une série littéraire, alors, en tant qu’artiste, c’est jackpot !
Pour un artiste, il est toujours plus intéressant d’utiliser le matériel dont il dispose - surtout lorsqu’il s’agit de quelque chose qu’il a éprouvé intimement, dans sa chair - en l’incorporant à son œuvre, d’une manière détournée qui le sublimera, plutôt que de le dilapider en paroles ou en mots creux qui jamais ne sauraient rendre honneur à ses sensations et à ses visions.
En tant qu’écrivain-voyageur qui tient un journal de voyage en parallèle du reste de ses œuvres, il fallait faire un choix.
La Passagère est le mien. Et en dehors de cet article, je n’écrirai pas un mot de plus sur ce qui m’est arrivé dans ce désert.
Quelques éclaircissements sur la nouvelle
Je ne compte évidemment pas livrer toutes les clés de La Passagère ici, déjà parce qu’il s’agit de quelque chose de très intime, ensuite parce qu’en tant qu’œuvre de fiction (oui, je sais marier les deux, à ce niveau Borderline m’a bien préparée) qui prend place au sein des Chants du Désert, ça reviendrait à spoiler les énigmes qui vous attendent, et pour finir parce que ouais, avec moi, y a toujours un travail de réflexion personnelle à faire, c’est comme ça !
Et c’est même tout l’intérêt du truc. Si vous sentez des éléments sans pouvoir être sûrs de leur signification, et si vous croyez comprendre un message sous-jacent sans savoir si c’est bel et bien ce que j’ai voulu dire, alors, tout va bien. Ça signifie que votre imaginaire travaille, et que la nouvelle est suffisamment profonde et subtile pour laisser place à plusieurs interprétations.
En fait, j’ai envie d’attaquer ce background en vous posant des questions :
Avez-vous compris à quel philosophe la Passagère fait référence ? Reconnaissez-vous certaines phrases en italiques qui sont des citations de ce philosophe ? Et surtout, est-ce que vous avez pigé que c’est ce philosophe-là qui aura droit à sa propre nouvelle ?
Avez-vous saisi l’idée des synchronicités rétroactives, c’est-à-dire, des messages qu’un moi futur envoie à son moi passé pour le guider ?
Savez-vous à quelle chanson la Passagère fait référence lorsqu’elle est postée sous le vieux phare ?
Pensez-vous que la Passagère meurt à la fin ?
Et enfin, avez-vous trouvé où se cache le Diable dans cette nouvelle ?
Allez, je suis cool, je vous donne quelques pistes…
Le Philosophe, c’est Nietzsche, évidemment, mon amour éternel, et je peux pas vous dire à quel point j’ai hâte de m’attaquer à sa nouvelle ! Pour les plus curieux d’entre vous, rendez-vous ici pour un super article sur lui, et découvrir de quel livre sont extraites les citations…
Hum, sur ce coup-là, il va vous falloir un éclairage vraiment balèze si vous n’êtes pas familier du concept… Je ne peux que vous conseiller de lire l’ouvrage Se souvenir du futur, véritable trésor en la matière qui pourrait bien faire basculer la façon dont vous envisagez la vie. Pour en savoir plus à son sujet, filez lire l’interview de son auteur Jocelin Morisson !
C’est probablement la chanson cubaine la plus connue au monde, en fait ! Il s’agit de El Carretero, de Buena Vista Social Club ! Ça vous dit rien ? Raaah, bordel, pitié, allez m’écouter cette merveille ! Et restez jusqu’à la fin pour entendre rugir ce fameux cri : Yo soy Guajiri y Carretero !!!
A vous de voir…
Il est PARTOUT !
D’une façon plus personnelle…
Tout ce qui est raconté ici est vrai. Je suis amoureuse du désert depuis toujours, c’est l’écosystème qui entre le plus en résonance avec mon âme. C’est d’abord en Espagne que je l’ai connu (c’est très aride là-bas mine de rien), avant de le rencontrer partout sur ma route lors de mes voyages (Nazca au Pérou, Tupiza et le Sud-Ouest en Bolivie, la Patagonie en Argentine…). Et jamais je n’ai été aussi bouleversée et aussi heureuse de ma vie qu’en étant immergée en lui…
En marchant dans le désert de la Guajira, j’étais hantée par les paroles de Nietzsche. Je sais que c’est difficile à croire pour certains d’entre vous, mais moi, ce mec a changé ma vie. On est quelques-uns dans ce cas-là, et y a qu’à voir la manière dont nombre d’artistes tels que John Fante, Jim Morrison ou Marilyn Manson sont en boucle au sujet de ce type… Je ne saurais jamais s’il m’a révélée à moi-même en métamorphosant ma vision du monde, ou si je me suis tout simplement reconnue en lui. Peu importe. Quand un penseur fait partie de toi comme ça, tu le charries en toi jusqu’au fin fond d’un désert colombien…
Pour revenir sur cette histoire de synchronicités, on ne se rend souvent pas compte qu’elles sont à l’œuvre quand on est prisonnier du quotidien. Parce que ce genre de vie ne laisse aucune place à l’improvisation, et encore moins à la magie. D’autre part, notre niveau de conscience dans le monde matérialiste ordinaire n’est pas en mesure de les percevoir, et à fortiori, de les engendrer. S’exiler hors de ses schémas classiques, de vie, de pensée, s’offrir tout entier à l’inconnu, accepter de perdre le contrôle et de s’en remettre aux signes et au destin… Ces circonstances favorisent l’émergence d’un autre niveau de conscience, quantique, créateur, et ma foi, très mystérieux, tout en étant terriblement réel.
L’anecdote sur la chanson de Buena Vista peut paraitre stérile, voire incongrue, mais je vous assure qu’il n’en est rien. Être hantée depuis l’enfance par le pouvoir d’un cri qu’on ne comprend pas (du moins pas rationnellement) et réaliser des années plus tard qu’on se trouve précisément à l’endroit d’où ce cri de l’âme est né, comme un lieu qu’on aurait cherché toute sa putain de vie… Merde, faut le vivre pour comprendre. C’est ça, la légende personnelle chère à Paulo Coelho.
Et c’est donc quand j’étais confinée en Colombie lors de l’irruption de la pandémie que, un soir de biture avec le gérant de l’auberge où je squattais et ses potes, alors qu’on était en train de se faire écouter des chansons les uns aux autres à tour de rôle, j’ai mis El Carretero (ce qui n’a pas manqué de les réjouir, vu que c’est latino, comme morceau !). Et j’ai fait : Mais bon sang c’est quoi qu’il gueule l’autre à la fin, là ? Yo soy guajiri y carretero ? C’est quoi, guajiri ? Ils m’ont expliqué que ce terme signifiait deux choses à la fois…
Un Guajiri, c’est un habitant de la Guajira, le désert où je projetais de me rendre si je parvenais à sortir un jour de cette auberge (toute la Colombie a été mise sur pause pendant 5 mois entiers, et je suis finalement rentrée en France après 4 mois de confinement sans avoir pu voir ce désert)… Et ce n’est qu’il y a deux semaines que j’ai enfin pu m’y rendre !
Mais surtout, un Guajiri, c’est un Guerrier du Désert.
La mort ? Il y a plusieurs façons de mourir… Et il y a aussi plusieurs façons de renaître. Les lecteurs de Borderline auront saisi le lien évident avec Tyler dans ce passage sur la falaise. Mais ceci est vraiment trop intime, et je n’ai pas le désir d’en parler d’une façon rationnelle.
Le Diable… est sans doute le démon le plus beau et le plus terrible d’une vie. Celui pour qui on est prêt à tout sacrifier. C’est très ambigu, en fait. Parce que ça veut dire que notre passion la plus folle et aussi la plus destructrice. Étrange condition humaine. Splendides possibilités d’enquête pour un auteur !
Conclusion !
Cette nouvelle n’est que la deuxième publiée pour les Chants du Désert, mais certains signes commencent à apparaitre… Je vous laisse donc avec une dernière question :
Et si la flamme sacrée qui anime chaque Homme dans le secret de son âme était aussi le feu démoniaque qui signera sa propre perte ?
El Diario Latino #4
Le petit jeu auquel je me livre pourrait bien me mettre face au cataclysme le plus brutal que j’aie jamais connu. Il existe des signes tangibles de la tempête intérieure que je suis en train d’alimenter. Mais c’est comme un feu qu’on regarde grandir et qu’on nourrit presque machinalement, presque sans y penser. Encore une branche, encore une bûche. Qu’est-ce qu’elles brillent, ces braises ! Comme les flammes sont hautes !
Minca, Colombie : Jour 40
Une fille qui marche seule le long des routes
Ça doit faire deux semaines que j’ai quitté Bahia Aguacate, mais niveau ressenti, c’est comme s’il s’était écoulé beaucoup plus... Bizarre, la façon dont le temps se dilate quand on fait la route. Est-ce la succession étourdissante d’un tas de micro-évènements qui donne cette impression ? Ou alors les changements si fréquents d’hôtels, de paysage et d’atmosphère ? Quand je regarde la carte, désormais pleine de souvenirs et de vécu s’attachant à chaque point, alors qu’avant c’était pour moi que des noms de villes inscrits sur un bout de papier et quelques fantasmes et projections inachevés de ce qu’elles pourraient incarner…
Remarque, ça m’a toujours fait cette sensation. Au fond, il est question de densité d’évènements. Sachant que dans la prison du quotidien, il peut s’écouler une année entière sans éléments marquants, sans rien qui se détache vraiment de l’amalgame de l’archi-vu, est-ce que le temps du voyage peut faire de la vie humaine quelque chose de plus significatif ? Cette densité du vécu comprimé en si peu de jours, est-ce qu’elle multiplie l’expérience de la vie par son poids ?
S’il faut vivre sur la route pour arracher à l’existence sa valeur et son sens, eh bien, disons que j’ai fait mon choix il y a longtemps. Et si ce choix doit creuser toujours plus le fossé qui me sépare du reste des Hommes, jusqu’à ce qu’un jour, il soit impossible pour eux ou pour moi de le sauter, alors, ça aussi, c’est déjà une vieille décision.
La vérité est que je suis extrêmement seule. Physiquement parlant, mais surtout à l’intérieur de moi. Oh, n’allez pas croire que cet état de fait m’afflige. S’il y a bien un truc sur cette misérable planète que je recherche avec avidité, c’est l’isolement. Simplement, parfois, ça me saute aux yeux. Le temps que je passe seule, à marcher sur les chemins, m’éloignant toujours plus de toute forme de civilisation, au point de m’être programmée à me lever le plus tôt possible pour jouir du monde qui m’appartient, à moi seule, avant que les autres n’émergent de leurs songes. Je pars marcher sur les plages, dans les montagnes, sur les sentiers forestiers alors que le soleil se lève, et je reviens après avoir vagabondé 15 km tandis que les autres commencent à peine leur journée. Et je regarde les groupes de touristes, les familles de vacanciers, les couples d’étrangers, et je me demande : Est-ce moi qui suis la plus seule ?
Je crois qu’il existe un implacable isolement en soi, qu’on se traîne jusqu’à la mort, peu importe qu’on soit entouré, aimé, ou même écouté pour de vrai. Aussi loin que je regarde, j’ai toujours été seule dans ma tête. En servant les gens au resto, sur mon vélo quand j’étais petite, en regardant la mer en Espagne, en lisant. En écrivant. Tout ce que je fais en ce moment, c’est juste de laisser sortir au grand jour cette fille qui chemine en détournant le regard quand les autres tentent de l’approcher.
Mais il faut admettre que cet effacement progressif des liens qui me tiennent attachée au reste de l’humanité est en train de faire lever une puissante, très puissante lame de fond. Le petit jeu auquel je me livre pourrait bien me mettre face au cataclysme le plus brutal que j’aie jamais connu. Il existe des signes tangibles de la tempête intérieure que je suis en train d’alimenter. Mais c’est comme un feu qu’on regarde grandir et qu’on nourrit presque machinalement, presque sans y penser. Encore une branche, encore une bûche. Qu’est-ce qu’elles brillent, ces braises ! Comme les flammes sont hautes ! Et cette odeur…
Je sais pas ce qui m’arrive, mais on dirait que je suis en train de m’entraîner, de me préparer pour quelque chose. Bien que très tonique et très résistante (le taff de serveuse a au moins ça de bon), j’ai jamais été ce qu’on appelle une sportive. Ça me dérange pas de marcher pour me rendre quelque part, au contraire, mais l’effort physique pur et dénué de but n’a jamais été mon truc. Eh bien, ça a changé. Insensiblement, une randonnée après l’autre, j’en suis venue à pousser mon corps au-delà de ses limites, chaque jour, sans savoir pourquoi. C’est arrivé lors de cette marche entre Bahia Aguacate et Sapzurro.
D’ailleurs, les préliminaires sont terminés. Il est temps de reprendre le fil du récit.
Des gens qui parlent d’ayahuasca et des fourmis qui filent la patate
Un mec m’avait contactée sur Insta, parce que le couple de Français qu’avait passé quelques jours à l’hostal de mes potes lui avait parlé de moi. Un mec de Sapzurro, un dueño d'hôtel. Le fait que j’écrive sur l’ayahuasca lui avait mis la puce à l’oreille, et il me disait qu’il souhaitait me rencontrer. Sauvage comme je suis, j’ai évidemment attendu le dernier jour, la veille de me barrer, pour me décider à aller voir le bonhomme. C’est pas de ma faute. Je suis comme ça.
Son hôtel se trouvait donc à Sapzurro, village colombien qui se trouve à la frontière du Panama. A 7h du mat j’étais sur la route, pleine d’allant, cheminant le long de la côte avec la forêt à gauche et la mer à droite, observant les timides rayons du soleil jouer entre les cocotiers. J’ai débarqué à Capurgana sans trop savoir si j’allais continuer à pied ou alors me trouver un bateau, mais je suis tombée sur un des primos (cousins), une bande de frangins français super potes avec mes potes à moi, et il se trouve que lui et sa nana colombienne accompagnaient une horde de vacanciers (c’est leur boulot) venant de Medellín jusqu’au bled où je devais aller, en bateau, alors j’ai décidé de profiter de l’occasion. En un quart d’heure c’était réglé, et je foulais le sol de Sapzurro. Le capitaine de la lancha a oublié de me faire payer, en plus. Toujours ça de gagné. J’ai trouvé l’hôtel du mec sans difficulté.
Il a semblé surpris de me voir débarquer comme ça, si bien que je me suis demandé si c’était moi qu’avais mal pigé ses intentions. Vieux, tu veux qu’on cause ayahuasca et écriture, pas vrai ? Bah tu vois, je suis là. Mes manières échappent encore à beaucoup de monde, mais il s’est rapidement mis en selle. Le truc relou, c’est qu’on était sans cesse interrompus par ses clients qui allaient et venaient, et s’incrustaient dans la conversation.
Quel était mon but en me pointant ici ? J’en savais rien. En voyage, j’ai pour habitude de suivre les signes, et je me disais que ce mec-là en était peut-être un. Je me disais qu’il pourrait me recommander un ou deux bons chamans. En même temps, mon attitude face à ça est très ambigüe. Je cherche sans chercher. On me file des pistes que je ne suis pas. Comme si j’attendais un miracle qui tombe du ciel, comme c’était arrivé avec Wish. Une évidence. Ou alors, peut-être bien que, simplement, je pressens que les pistes qu’on me donne ne sont pas les bonnes…
Bref, il m’est vite apparu que mon expérience de l’ayahuasca était bien plus profonde que la sienne, et qu’en réalité c’était plus moi qu’avais des trucs à lui apprendre que l’inverse. Le temps est passé où j’étais à l’affût de tout ce que j’entendais sur le sujet, buvant littéralement les paroles du premier péquenaud qu’avait vaguement tâté de la chose. D’une manière générale, je ne me sens plus aussi jeune que pour mon premier trip. A l’époque, c’était moi la nymphette de service, 20 ans tout vert, excitée et stupide, probablement. Ça me fait un peu bizarre de me dire ça, mais maintenant c’est moi l’ancêtre. C’est moi qui peux me positionner face aux blancs-becs que je croise en causant comme une matriarche qui sait de quoi elle cause, justement, pour le voyage comme pour l’ayahuasca.
Y avait un jeune type qu’était là aussi, avec qui j’ai discuté un moment. Une sorte d’allumé à l’origine indéfinissable (Argentin, peut-être, même s’il n’avait pas l’accent), qu’avait l’air de tâter d’un peu tout (toutes les drogues et toutes les médecines), qu’était pas désagréable, ma foi.
Mais soyons franc, l’un dans l’autre, et bien que le dueño et l’autre gars étaient charmants, je peux pas dire que j’en ai retiré grand-chose. Tant pis. Quand on nourrit aucun espoir, y a pas de déception. Le dueño, lui, était tout de même déçu que je reste pas. Sans doute qu’il s’attendait à choper une nouvelle cliente, en réalité… Loupé. Je lui ai appris que je me barrais le lendemain, et même à l’instant même, en fait. Il était bientôt midi et j’avais déjà décidé de me taper toute la route de retour à pince jusqu’à Bahia Aguacate, et entre-deux je voulais bouffer et me balader un peu dans le village. Un bien joli village, en vérité, qu’aurait mérité que je squatte là un moment, mais tant pis. Ça faisait déjà plusieurs jours que la route m’appelait, et j’avais hâte de la retrouver.
Un burger et une bière plus tard, j’étais donc sur le chemin qui coupe à travers la montagne pour rejoindre Capurgana. Un chemin qui rigole pas. Ça monte et ça monte, en pleine chaleur et en pleine humidité, évidemment. J’en étais à me demander pourquoi je m’infligeais ça, quand j’ai senti une drôle de douleur au pied. Une morsure. J’ai tout de suite fait le lien avec la colonie de fourmis que je venais de croiser. En tongs. J’ai regardé mon pied gauche en sentant soudain la même douleur au pied droit. Il fallait faire un choix. Mon gros orteil gauche était attaqué par une fourmi géante en train d’essayer de mordre à travers la corne (Dieu bénisse mes pieds cornés par des mois de service !). J’ai miséré à mort pour la détacher de là en criant LA PUTAIN DE TA RACE, avant de m’attaquer à celle de droite, qui s’accrochait à la chair tendre de mon troisième doigt de pied, par au-dessus. Avant de réaliser que j’en avais plein d’autres agrippées à ma tong, dans le caoutchouc. Ça a pas été simple de toutes les virer de là, et longtemps après j’étais encore en train de vérifier que je les avais bien toutes éliminées. Mais ces fourmis ont été la cause d’un effet que je ressens encore aujourd’hui. Après leur assaut, je me suis mise à marcher comme une furie, peu importe à quel point ça montait, à quel point je transpirais, à quel point mes cuisses me faisaient mal. J’avais trouvé un second souffle, et ce souffle, il me possède désormais tout entière, dès le début de mes randos. C’est très bizarre, en fait.
Ce jour-là, j’ai marché presque 29 kilomètres. Et depuis, on dirait que je tente chaque jour de dépasser ce record.
Un vrai baroudeur doit savoir modifier ses plans en un claquement de doigts
Une demi-heure avant de prendre le bateau pour quitter mes potes et cet hostal où j’avais passé deux semaines, il pleuvait à mort, exactement comme le jour de mon arrivée. La boucle était bouclée, et au fond ça me semblait logique. Mais la pluie a eu la clémence de s’arrêter avant le décollage. Mon objectif du jour était Necoclí, où j’imaginais rester une nuit avant de me relancer dans la folie des bus. Débarquée là-bas, j’ai eu l’idée saugrenue de ne pas prendre de moto pour me rendre à l’un ou l’autre hôtel qu’on m’avait conseillé, mais de longer la plage avec mon gros sac, mes coups de soleil et le sel des vagues que je m’étais reçues qui me piquait la gueule… persuadée que je tomberais sur ces hôtels rapidement. Hum.
En effet, au bout d’une demi-heure de marche, j’ai fini par tomber dessus, harassée, rouge écrevisse, pour m’apercevoir qu’ils étaient tous complets (haute saison), et que de toute manière, la ville entière était en proie à une violente coupure d’eau qui ne me permettrait jamais de me laver de ce sel et de cette sueur… OK, on y va pour un brutal changement de programme !
Si y a bien un truc que le voyageur aguerri doit être capable de gérer, c’est ça. Paumé au milieu de nulle part ou découvrant soudain ses précieux plans foulés au pied pour je ne sais quelle raison, le baroudeur doit savoir rebondir rapidement et bouleverser ses projets -peu importe à quel point il y tient- comme s’ils n’avaient tout simplement jamais existé. J’ai donc pris une moto pour le terminal (enfin, disons, l’endroit d’où partaient les bus pour le Nord, en plein sur la grand-rue), repoussant sans ménagement les ayudantes (ceux qui accompagnent le chauffeur de bus en gueulant partout le nom de la destination de l’engin, chargeant les bagages, récoltant les sous, haranguant à tout va les malheureux piétons qu’ont rien demandé) qui se jetaient déjà sur moi en criant : CARTAGENA, MONTERIA, SANTA MARTA, pour m'asseoir sur un muret au milieu des pots d’échappement, de la poussière, de la chaleur carabinée et des vrombissement de moteurs, m’allumer une clope et consulter mon guide.
OK. Le plus logique à faire, c’était de se rendre à Montería, bled sans intérêt, mais qui avait l’avantage de pas être trop loin (je fantasmais sur une douche) et surtout d’être à la jonction de l’itinéraire qui m’arrangeait le mieux. J’ai écrasé ma clope, me suis dirigée vers un des ayudantes, et j’ai fait : OK. Montería.
Un hôtel en face du terminal, l’odeur du gasoil et la vérité poussiéreuse du road trip
Pourquoi s’emmerder à trouver un hôtel dans le guide, prendre un taxi et s'exiler au cœur d’une ville dégueulasse quand tout ce dont on a besoin est une douche et un lit ? Une fois de plus, mon expérience m’a dépannée sur ce coup-là. Quand j’ai senti qu’on arrivait au terminal, j’ai ouvert grand les yeux et j’ai repéré un hôtel juste à côté. Parfait.
Très bonne aubaine. Il coûtait que dalle, la chambre était dotée d’un ventilateur ultra-puissant (indispensable dans ce bled étouffant de la mort), et la douche coulait bien. Bordel, j’avais pas besoin de plus ! J’ai consulté mon guide pour ma journée du lendemain. Le bled que je visais était pas à plus d’une heure et demi de route.
J’ai fumé des clopes sur la coursive en matant la rue. Y avait un comedor (petit restaurant) où ils te servent du gras 24h/24 juste en bas, et l’odeur des hydrocarbures mêlée de poussière me remontait depuis là où j’étais postée. Ça m'a rappelé des scènes du passé, ces hôtels impersonnels où t'atterris parfois sans l’avoir prévu, en transit, comme un fantôme coincé dans l’entre-deux Monde. Une ombre furtive que personne ne remarque, qui n’existe pas vraiment, parce qu’elle ne laisse aucune marque nulle part.
Et je me suis demandé si c’était pas ça, le vrai voyage.
Un lieu mystique au bord du Río Sinú
J’ai passé une nuit bizarre, peuplée de rêves étranges, et à 6h30 du matin j’étais déjà en train de descendre les marches de l’hôtel pour me rendre au terminal. Mais j’ai même pas eu le temps de l’atteindre que j’étais déjà dans un bus. C’est marrant comment ça marche ici. En France le chauffeur te récupérerait jamais au bord d’une route comme ça, si t’es pas en train d’attendre religieusement à l’arrêt. Ici, ils te chopent n’importe où, et te font descendre où tu le souhaites.
Bref, j’étais en partance pour Lorica, un bled qu’est pas du tout répertorié sur les guides. Et je dois avouer que ça faisait du bien qu’y ait aucun gringo à l’horizon. Mon voisin de bus m’a prise en main et m’a trouvé une moto pour me conduire à l’hôtel qu’il avait élu pour moi. Ça m'arrangeait bien, j’avais rien réservé, et c’est toujours un peu délicat de dire au mec chargé de te conduire : Amène-moi dans l’hôtel de ton choix, bien que je l’ai fait plus d’une fois. Mais on a parfois des mauvaises surprises. Je pensais que j’étais face à l’une d’entre elles quand la moto m’a fait descendre. On était juste à côté de l’église, à deux pas de la place centrale (là où se trouvent en général les trucs les plus chers) et l’hôtel avait l’air tellement clean que j’espérais pas une seule seconde qu’il soit dans mes prix.
J’en revenais pas quand le type de l’accueil m’a annoncé le montant, tout en glissant que la piaule était climatisée (limite indispensable, vu la chaleur dans ce bled). Je sais pas si vous pouvez imaginer le soulagement du gringo quand il se dégote une chambre de luxe dans ses prix, avec un petit balcon où il peut cloper en matant l’animation de la plaza mayor (place principale), une panaderia (boulangerie) à deux pas, et le fleuve en contrebas…
Il était très tôt, à peine 9h, et je suis tout de suite ressortie pour aller explorer mon nouvel environnement et me taper un café et un croissant tout chaud. L’énergie qui faisait vibrer le cœur de cette ville était d’une nature particulière : marché très vivant avec ses nombreux comedores donnant sur le fleuve, gens flânant sur le malecón (balade au bord de l’eau) à toute heure, chaleur sèche des petites rues poussiéreuses dont les murs des quelques bars et commerces s'ornent de graffitis, barques prenant l’eau le long des rives, architecture des porches et des fenêtres aux reflets arabes, et cette église colorée qui domine la place, pareil que dans toutes les villes d’Amérique latine d'ailleurs, mais qui justement offre un côté réconfortant, n’importe où que tu te trouves…
Je me suis baladée longuement, revenant à l’hôtel pour me rafraîchir, et ressortant parce que je devais encore tout voir, tout sentir… Le soir en particulier, lorsque l’air devient enfin respirable et que le fleuve fait ondoyer ses couleurs au coucher du soleil, l’âme de cet endroit révèle l’ensorcellement caché qu’on pouvait sentir ou deviner pendant la journée. L’esprit se tait, et il respire, lui aussi.
Être seul dans une ville inconnue à la tombée du jour, et s'imprégner d’une énergie étrangère, c’est quelque chose de sacré quand on voyage. J’ignore à quelle partie de nous-mêmes ça nous connecte, mais on se sent plus que jamais nomade dans ces cas-là. Ce qu’on appelle bêtement citoyen du monde, je crois.
Putain de haute saison !
J’aurais dû sentir venir la merde quand je me suis rendue à San Bernardo del Viento le lendemain, village en bord de mer censé être la tranquillité même. Ouais, eh bien non. La plage était envahie de vacanciers locaux, et puisque je déteste me retrouver au milieu d’un tas de gens, je me suis contentée de marcher sur le sable des heures et des heures en faisant quelques pauses jus de fruit, avant de m’en retourner à Lorica, un poil déçue, en retrouvant le même chauffeur de moto qu’à l’aller. C’est marrant, mais peu importe les déceptions que je peux rencontrer en chemin : quand il s’agit de faire de la route, j’oublie absolument tout ce qui vient de se passer pour être dans le pur présent. Les senteurs de cette côte caribéenne sont vraiment incroyables, et j’aurais bien du mal à décrire ce que ça fait d’être perchée sur une moto en observant la végétation, les rivières, les petites maisons et les cimetières colorés comme si on m’offrait le droit d’accéder à l’intimité d’une vie qui ne sera jamais la mienne. Comme… goûter en secret à différents aspects de l’existence.
De retour à l’hôtel, un brin inquiète quant à cette histoire de haute saison en train de monter en puissance, j’ai tenté tant bien que mal de trouver un hôtel pour le prochain village que je visais sur Booking, mais tout paraissait saturé, ou bien carrément hors de prix. Ça sentait de moins en moins bon…
J’ai laissé tout ça de côté pour aller savourer une dernière fois les ondes mystiques de Lorica…
Et le lendemain j’étais dans un bus, qui lui aussi m’a paru super cher, alors de deux choses l’une : soit je me suis fait enfler, mais grave, soit les prix triplent pendant les vacances. Avec le recul que j’ai maintenant, je dirais que c’est la deuxième option. Ces périodes de fêtes et de vacances ont toujours été ma hantise, et voilà que, comme une bleue, je me retrouvais encore une fois en plein dedans ! Y serait peut-être temps que j’apprenne à calculer un peu mieux mes itinéraires en fonction des périodes…
Jesus à moto, trois bières de trop et un mal de tronche légendaire
Arrivée à San Onofre, ville d’où partent les motos pour Rincón del Mar, j’ai pas eu le temps de dire ouf que j’étais à l’arrière d’un type qui m’y conduisait, en me faisant déjà un gringue éhonté. Oh, je dis pas, c’était un sacré beau Black, et flirter avec lui n’avait rien de désagréable. Au fond, je trouvais ça limite reposant qu’il soit aussi direct, ça nous épargnait les ronds de jambes habituels en matière de séduction.
- T’aimes pas les Morenos (Noirs) ?
- Si. Enfin je veux dire, j’ai jamais essayé, mais…
- Moi non plus j’ai jamais essayé une Française. J’aimerais essayer avec toi. Comment tu t’appelles ?
- Zoë.
- C’est joli Zoë. Moi c’est Jesus.
- Ah.
- Tu veux qu’on se voit ce soir ?
- Ben…
- Allez, j’ai vraiment envie de faire l’amour à une Française !
- Je suis à peu près certaine que ça fonctionne pareil dans le monde entier, tu sais… Et puis je suis sûre que tu mens. Je suis sûre que t’as déjà tapé dans de la gringa.
- Nan, jamais !
- Carrément que si ! Je suis sûre que tu sors les mêmes conneries à toutes celles qui montent derrière toi.
- J’ai jamais parlé avec une Blanche comme ça.
- Mouais, c’est plutôt qu’elles comprennaient rien à ce que tu leur racontais, surtout.
- Haha.
- Héhé.
Sans surprise, à Rincón, ça dégueulait de gens de partout. Ce que mes potes de Doble Vista m’avaient vendu comme un petit paradis de pêcheurs loin de tout, où il faisait bon se reposer sur la plage en buvant des cervezas face au coucher de soleil, se révélait être une immonde usine à vacanciers et touristes, où, comme de juste, tous les hôtels où Jesus m’a emmenée étaient complets. J’ai fini par lui dire de me laisser me démerder toute seule, je m’en voulais de lui faire perdre son temps en cherchant avec moi, et puis il commençait déjà à me saouler…
J’ai patienté deux heures dans un hostal où ils disaient qu’ils auraient peut-être une place, avant de finir par m’annoncer que la chambre coûtait 150 000 pesos, c’est-à-dire plus que mon budget quotidien. Mais ils connaissaient un type juste à côté qui proposait des piaules pour 100 000. Bordel de chiotte, je jure que j’étais à deux doigts de reprendre une moto pour me tirer de cette galère et de ce con de bled qui me sortait déjà par les yeux, mais pour aller où, en même temps ? Le prochain endroit que je visais était Cartagena et je savais que là-bas ce serait exactement le même délire, voire pire, vu la très bonne réputation de cette ville.
La mort dans l’âme, j’ai laissé le jeune du premier hostal me conduire au second en moto. Le dueño s’est montré adorable direct (tu me diras, vu le fric que je lui rapportais, ça se conçoit). Il faisait penser à un gros Hawaïen, chemise à fleurs, panse énorme, sourire chaleureux. On a un peu papoté le temps que sa femme prépare ma chambre, et il m’a branchée sur des trucs à faire dans le coin. Dans la foulée, j’ai donc réservé un tour pour visiter les mangroves en canot le soir même, et un autre pour aller voir l'archipel de San Bernardo le lendemain. Foutu pour foutu, autant que mon séjour dans cet endroit serve à quelque chose.
J’ai découvert ma chambre qu’était pas si merdique, même si en comparaison de l'hôtel que je venais de quitter à Lorica, ce truc était parfaitement moisi, tout en coûtant le double.
J’aurais peut-être bien dû me reposer un brin, mais j’avais surtout besoin d’une bière. Au bout de trois, j’ai réalisé que c’était une très mauvaise idée quand un mal de tronche carabiné m’a chopé la tête en étau, qui ne devait se relâcher que deux jours plus tard…
A moitié bourrée, je suis retournée à l’hôtel en attendant l’heure de sortir dans les mangroves, en priant pour qu’y ait pas trop de monde dans le bateau. Je commençais à me sentir prise à la gorge par les gens, le bruit, l’agitation, et tout ce que je désirais au monde, c’était de respirer un peu loin de tout ça.
Virée en canot dans les mangroves, paresseux et narcotrafiquants
Mes talents de sorcière se sont révélés utiles : les gens qui devaient venir avec le guide et moi se sont décommandés, et c’est donc seule avec ce petit mec freluquet et sympa comme tout que je me suis lancée dans les marais. Honnêtement, j’ai vu des trucs bien plus impressionnants que ça dans ma vie, mais y se trouve que passer deux heures loin de l’agitation du monde avec ce gars était tout ce que je désirais en cet instant. Il avait l’air plutôt concerné par son boulot, en plus.
Apparemment, cette mangrove reliée à la mer sur laquelle on circulait était pura basura (pure poubelle) avant que l’association pour laquelle il taffait prenne les choses en main pour tout nettoyer. Il m’a expliqué que la végétation de ces fameuses manglares (écosystème constitué de marais donc, avec de drôles d’arbres qui poussent dans l’eau avec les racines soit sortant de l’eau, soit allant vers l’eau depuis les branches) produisait plus d’oxygène que n’importe quel pauvre arbre tout sec qu’on trouvait dans les plaines, et que c’était donc super important de la préserver. Il me citait les noms latins de chaque plante, m’apprenait le nom des oiseaux, et m’a emmenée dans une plaine pour qu’on tente de voir les paresseux.
En sortant du canot, il m’a fait : Si on voit un paresseux, tu me files un pourboire, d’accord ? Sa manœuvre était plus que grillée, mais je le trouvais tellement cool que j’ai topé sans faire d’histoire. A peine sortis de l’eau, sur le premier arbre planté face à nous, non pas un mais trois paresseux étaient accrochés là comme font toujours ces bestiaux, soit roulés en boule, soit se déplaçant avec une lenteur effarante et un sourire de fumeur de ganja perdu de Dieu. Faut dire que les feuilles de cet arbre étaient leur nourriture favorite. Moi j’étais simplement contente de voir la vie sauvage ailleurs que dans un zoo.
On a repris le canot après s’être un peu baladés. Entre-temps, il m’avait montré une célèbre piste d'atterrissage d’avions des narcotrafiquants, et m’avait expliqué qu’une grande partie de sa famille s’était fait buter par eux. C’est quand même spécial la Colombie. Elle a un sacré passé que les chochottes françaises pourront jamais comprendre, moi la première…
Parfois, la réalité est aussi merdique que la fiction
J’aurais voulu que cette parenthèse dure plus longtemps. De retour à l’hôtel, mon mal de tronche avait empiré et je me sentais capable de rien, ni de sortir bouffer, ni de lire, ni même de me brosser les dents, ce qui ne me ressemble vraiment pas. Je me suis tout juste contrainte à préparer une gourde de flotte histoire de pouvoir boire durant la nuit, en glissant carrément deux cachets de micropur dedans, tant elle semblait foireuse… J’avais tout sauf besoin de me choper une intoxication en plus du reste. Bordel, je me sentais comme Travis au début de Borderline, et dans un sens, ça m’a fait rire, cette connerie. Étalée à poil sur mon lit, le ventilo en pleine gueule, avec cette foutue musique qui ricochait dans toute la ville, et particulièrement chez les voisins, vraisemblablement, cette migraine me filait la nausée, elle était en train de me rendre complètement dingue…
J’ai presque pas dormi, je crois. Au petit matin, la nuit entière m’apparaissait comme une longue abomination faite de visions sordides, de musique qui s’insinue dans ta tête sans espoir d’y échapper, et d’une douleur occipitale d’une lente et rare violence, continue, intraitable.
J’étais dans un état proche de l’Ohio, et dire que j’étais censée me taper une virée en bateau pour aller découvrir ces fameuses îles qui, je le sentais, allaient être envahies DE GENS ! La putain de sa race. J’ai avalé une gorgée d’eau ultra-chlorée qui s’est débrouillée pour avoir quand même goût de moisi. Chaud, le moisi. Putain. J’ai rampé sous la douche, qui n’était en fait qu’un vague tuyau planté dans le mur crachant un filet mou d’eau froide, histoire d’essayer de me remettre en place pour la journée. Brossé les dents. Avalé un nouveau Doliprane. Et suis descendu fumer une clope avec le dueño, qu’a eu la décence de m'offrir une tasse de tinto (le café très léger et sucré qu’ils boivent ici). J’aurais préféré un triple espresso, mais bon.
Ça allait quand même un peu mieux. Il était super tôt, pour pas changer, l’excursion décollait à 8h, j’avais le temps de faire un tour du village et de me taper un vrai café bien fort. Personne dans les rues. Le soleil en train de se lever, caressant de sa lumière les rues en sable et les petites maisons colorées… Voilà à quoi devrait toujours ressembler le monde, je me suis dit. Juste moi, la lumière, et quelques cabots qui traînaient par là.
J’ai bu mon café en regardant la mer. Elle était calme à cette heure-là, les vagues ne commençaient que vers 10 heures. Ça m'a fait du bien. Quand il a été l’heure de partir, j’avais retrouvé figure à peu près humaine.
Les Iles du Diable
Parfois, on sait très bien qu’on se fout dans un plan débile, mais on y va quand même. Mon idée de base en me dirigeant vers Rincón del Mar, c’était de dormir sur l’Isla Mucura, qui est réellement splendide, mais avec les récentes déconvenues que je m’étais chopées avec les hôtels, j’avais pas osé me pointer là-bas comme une fleur en mode Holà, hay habitación ? (salut, z’avez une chambre ?).
Je dis pas que j’aurais dû, mais ce qu’est sûr, c’est que ce tour de merde n’était pas la bonne option pour profiter de cette île, et que les deux autres que j’ai visitées ce jour-là valaient pas un pet de lapin. Je hais les putains de tours opérateurs. Chaque fois que j’ai dû y avoir recours, j’ai détesté ça, putain. Comment on est censé kiffer quand le bateau te largue avec un tas d’autres neuneus sur une micro-île surpeuplée en te disant : OK, rendez-vous dans une heure à l’embarcadère, les pigeons !
Eh bien, on trace direct dans le sens inverse de la cohue. Tout le monde va à droite, où y a la zik et les restos ? Va à gauche, suis le sentier le long de la mer, écarte-toi autant que possible en surveillant l’heure quand même pour pouvoir être de retour quand ce fichu bateau repartira, et marche, vite, loin, jusqu’à trouver une crique où tu pourras te tremper le cul tout seul pendant le quart d’heure qui te reste.
Quelle situation pathétique… Dans un lieu si beau, le genre de truc dont tu rêves depuis que t’es gamin ! Encore heureux que j’arrive à me connecter rapidement à la beauté qui m’entoure quand je l’ai sous le nez. Je dirais que c’est ce qui m’a sauvée. Et j’ai répété le processus sur l’île suivante, Tintipán…
Le monde est devenu franchement moche, vous savez. Ce coup-ci, c’était Indiana Jones au pays d’Instagram. Nom d’un chien, c’est pas que j’aie le sentiment d’avoir une place à moi quelque part, mais là, j’aurais pas pu être plus loin de mon monde… J’ai fermé les yeux sur les pétasses en mode selfie avec leur gros culs cellulitiques débordant de leurs strings, et j’ai franchi la barrière supposée séparer le monde en deux : la plage publique, qui devait pas représenter plus d’un quart de l’île, sur laquelle s’ébattait donc la horde effroyable de vacanciers que je venais de croiser, et la partie privatisée, où chaque hôtel de luxe a acheté son petit coin de paradis à l’usage exclusif de ses hôtes…
Ce qui fait que je me suis retrouvée dans un no man’s land où les pilotes de bateau des tours opérateurs se reposaient à l’ombre, étonnés de voir une pauvre gringa mortifiée débarquer. J’ai tracé sans rien demander, jusqu’à trouver des rochers qui s’avançaient dans l’eau. J’entendais presque plus la musique. Y avait personne. Ouf.
L’un des types est tout de même venu me prévenir de faire gaffe où je mettais les pieds. En effet, ici les oursins et les coraux tranchants comme des lames avaient remplacé le sable blanc. C’était le prix à payer pour la solitude.
Tout était si cher sur ces îles que j’ai rien bouffé de la journée, et de retour à Rincón le soir, le mal de tête était revenu en force. En me connectant vite fait dans un bar (mon hôtel n’avait évidemment pas la wifi), j’avais découvert que celui que je croyais avoir réservé pour le lendemain était en réalité complet, ce qui me faisait changer mes plans à la dernière minute, une fois de plus… Dans l’urgence, j’ai dégoté un truc moisi pour une autre ville le long de la côte. Toute cette connerie commençait à me courir sur le haricot. J’étais impatiente d’être au lendemain pour me tirer d’ici.
Tu sais ce que ça veut dire, d’être au bout de sa vie ?
J’ai enchaîné taxi (vraie voiture, ce coup-ci, pas un Jesus en moto), puis voiture privative pour Cartagena, et puis bus et encore taxi ce jour-là. C’est chelou comment ça marche ici. Tu sais jamais dans quel transport tu vas grimper.
Le premier taxi m’a lâchée sur une sorte de grand-route où s’arrêtaient des voitures, des bus, des motos, et les mecs qu’étaient là se sont occupés de mon cas, arrêtant une voiture dans laquelle ils m’ont fait monter, apparemment le mode de transport qu’allait m’amener à Cartagena. J’étais là, mon arepa toute grasse à la main (galette de maïs, petit dej de rue typique de la Colombie), et j’ai dû bondir dans cette caisse sans même prendre le temps de m'interroger. Ce n’est qu’une fois seule avec ce mec que j’ai réalisé que j’étais absolument pas dans un taxi officiel, que j’avais pas pris en photo sa plaque d’immatriculation (c’est conseillé de le faire dans ces cas-là), et que donc, bah, j’étais à la merci. J’avais pas peur non plus, cela dit. Il était 9h du mat, et hormis le fait que ce chauffeur avait des yeux bleus très bizarres et un accent que j’avais foutrement du mal à comprendre, il avait l’air sympa, et sa caisse était bien, elle roulait vite.
Dans le doute, je lui ai tout de même monté un bateau sur un type que j’étais censée retrouver pas loin, genre : Je suis pas toute seule dans ce pays, des tas de gens s’inquiètent pour moi ! Tu parles. La vérité, c’est que si je disparaissais, personne s’en rendrait compte avant un sacré bout de temps.
Mais j’ai pas disparu. Même si en approchant de la fin de journée et donc de mon hôtel, y restait plus grand-chose de moi, tant j’étais rincée. C’est peut-être ça d’ailleurs, cette dureté qui te possède quand t’atteins tes limites, qui m’a poussé à refuser que l’enculé de taxi me laisse à des rues et des rues de mon hôtel, prétextant que la route était fermée ou je ne sais quelle connerie. Il a tenté, il a échoué. La route n’était pas fermée et je l’ai forcé à me déposer au pied de mon logement. Hors de question que je marche des kilomètres dans les rues sablonneuses avec le sac sur le dos et le soleil qui brûle la couenne avec une migraine d’un autre monde et une journée de voyage dans l’os. Nique ta mère. Je lui ai balancé son fric et j’ai franchi les portes du taudis. Mais non, j’étais toujours pas au bout de mes surprises…
L’hôtel n’avait pas pris ma réservation en compte. Heureusement, m’a annoncé la bonne femme, il reste une place en dortoir (les DORTOIRS, ma hantise depuis mon premier trip ! Des repaires de ronfleurs que je fuis comme la peste depuis mes 20 ans !), et coup de bol, y avait personne dedans, pour le moment. Quand elle a vu ma tronche, elle a compris son erreur, et je dois d’ailleurs la remercier de m’avoir finalement laissé tout le truc sans me foutre personne d’autre, même quand une bande de clampins s’est présentée.
Est-ce que j’allais enfin pouvoir me reposer ? Je me suis tapé trois bières achetées à la tienda (épicerie) d’à côté pour favoriser mes chances, mais c’était sans compter sur… LES PUTAINS DE VOISINS QU’ONT MIS LA MUSIQUE A FOND LA CAISSE TOUTE LA PUTAIN DE NUIT ! Ces connards envoyaient même des pétards dans le ciel, au point, oui oui, de foutre le feu à la maison d’à côté… Cela dit ça on me l’a raconté le lendemain. Y avait de la cendre dans ma piaule en me réveillant, et c’est après que j’ai pigé.
Ça commençait à bien faire. J’ai préparé mon sac en deux temps trois mouvements et j’étais de retour à attendre le bus. Ces sales vibrations qui me poursuivaient depuis trois jours avaient méchamment entamé mon système nerveux, et j’osais même plus imaginer que l’endroit soi-disant enchanteur où je me rendais l’était bel et bien. Du coup, quand j’ai finalement débarqué, le soulagement a été IMMENSE.
Minca était vraiment le paradis qu’on m’avait vendu, l’endroit idéal où j’allais enfin me ressourcer.
Village roots, guérisseuse indigène et exorcisme intestinal
Dans chaque pays d’Amérique du Sud, y a un bled que les gringos ont élu. Il s’agit souvent d’un petit village plein de charme à la température clémente, où il fait très bon en journée mais frais la nuit. Et dès ses premiers pas dans ce village, on ne peut que sentir qu’une énergie particulière est à l'œuvre.
Évidemment, on pourrait penser que c’est les gringos qui se sont établis là pour y vivre qu’ont amené avec eux cette sorte de vague new-age, puisque ce sont majoritairement des gens roots, portés sur les médecines naturelles, le yoga et la bouffe healthy, et qu’ils se sont employés à transformer les lieux en une sorte de refuge où on boit du tchaï, bouffe des pancakes vegan, du houmous et du granola, et où on peut prendre des cours de méditation vipassana à tous les coins de rue. Et où, d’une manière générale, tout le monde met un point d’honneur à se comporter avec ouverture et bienveillance.
Mais à y regarder de plus près, en cherchant un peu dans le passé et les légendes locales, on réalise que c’est pas le cas : l’énergie était là avant, les gringos l’ont juste identifiée, et se la sont plus ou moins appropriée… Pisac au Pérou, Samaipata en Bolivie, San Marcos de Atitlán au Guatemala, et maintenant, Minca, Colombie.
N’importe quel voyageur pourra tenter de s’en défendre, même moi qui suis pas du genre à coller à mes semblables et qui fuis comme la peste tout ce qui s’apparente à la bienveillance outrée. Mais la vérité est là : dans ces endroits, on se sent bien, et on y reste souvent bien plus longtemps que prévu…
Un refuge donc. Celui dont j’avais besoin après l’exposition démesurée et la promiscuité que j’avais vécues sur la côte comme s’il s'agissait d'une opération à cœur ouvert.
Cela dit, même ici, les vacanciers sont présents, sans compter les gringos donc, auxquels j’ai toujours autant de mal à m'identifier et vers qui je me dirige jamais facilement. Mais avec mes horaires de poule sous amphets, c’est pas trop difficile pour moi d’éviter la foule en cheminant aux aurores vers les cascades et autres merveilles qui peuplent ce coin de paradis.
Pourtant parfois je m'interroge sur cette impossibilité de nouer des liens avec ceux que je croise. Je marche des kilomètres, entièrement seule, et quand je rentre au village j’éprouve toujours pas l’envie de tenter d’avoir un contact avec les autres. J’ai pourtant croisé des gens cool quand j’ai été dans cet hôtel sur les flancs de la montagne (c’est tout l’intérêt de Minca, à priori : squatter dans les ecolodges somptueux avec vue sur la mer en contrebas, isolés de tout), et j’aurais eu la possibilité de les accompagner un moment pour me rendre avec eux dans la Guajira, désert qui se trouve à l’extrême nord du pays. Mais non.
Faut dire aussi qu’il s’est passé un truc qui, même si je l’avais voulu, m’aurait empêchée de le faire.
Une Française que j’avais croisée à l’hostal de mes potes s’était rendue dans ce fameux hôtel, où elle s’était fait masser par une indigène. Mais c’était pas un massage classique. Au bout de quelque temps de palpations, la femme s’était mise à lui révéler des choses sur elle. Des choses qu’elle était techniquement incapable de savoir. Et moi, avec la lame de fond dont j’ai parlé au début de ce carnet, j’avais des trucs à régler. J’étais curieuse de voir ce qu’elle découvrirait sur moi.
J’ai donc pris rendez-vous avec cette femme. Elle avait l’air rude, et pas spécialement amical, mais c’est un truc auquel je suis habituée avec les chamans. Rapidement, elle a commencé à me parler, évoquant des éléments de ma vie qu’elle semblait sentir à travers mon corps. Elle m’avait tout d’abord passé un linge humide, imprégné d’une sorte de tisane aux herbes, chaude, pour ouvrir les pores de ma peau afin d’être en mesure de me lire. Puis, elle avait mis ses mains sur mon ventre, dont, selon ses dires, chaque zone correspondait à un aspect de moi : familial, émotionnel, sentimental…
Mon corps lui a tout dit. Ses massages faisaient mal. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais à la fin, au niveau du pied, ça faisait si mal, aussi bien physiquement qu’émotionnellement, que je me suis cambrée sur ma planche, comme en proie à un exorcisme, pour hurler des pleurs d’une force inouïe. Et elle qui me disait de respirer, d’inspirer par le nez, souffler par la bouche tout en faisant avec mes mains le geste de balayer, de balayer cette souffrance que je traversais, de m’en défaire, de la laisser s’en aller… Cette façon de gérer le souffle m’a rappelé le pouvoir qu’il a en cérémonie d’ayahuasca.
Elle a voulu me revoir le lendemain pour terminer le boulot. Donc, à 7h du matin, j’étais de retour sur la table de massage. C’est principalement sur mon ventre qu’elle a travaillé (la veille, toutes les glandes et méridiens qui parcourent mon corps y avaient eu droit, jusqu’à mon pied, donc). C’est peut-être ce qui explique ce qui s’est passé…
Peu de temps après l’avoir quittée, j’ai commencé à me sentir très mal. Faible, épuisée, nauséeuse, tremblante… Un brin fiévreuse, peut-être ? Je me sentais si mal que j’ai dû changer mes plans : alors que j’avais réservé une nuit dans un autre ecolodge paradisiaque, ce qui impliquait un retour à moto à Minca, puis un autre trajet à moto pour m'y rendre, et enfin une nuit dans un dortoir (trop cher la chambre solo), et surtout une exposition permanente aux gens (comme c'est le cas dans ces endroits où les gringos sympathiques pullulent), j’ai finalement choisi de retrouver mon hôtel au village, pour me cloîtrer dans ma chambre individuelle, fraîche et solitaire.
Grand bien m’a pris. Toute la sainte journée, j’ai été victime d’une diarrhée d’un autre monde, c’est-à-dire, du monde de la medicina, comme celle que j’avais déjà connue avec l’ayahuasca. Un truc émotionnel qui te vide de ta propre substance…
Je ne sais pas si on peut dire que cette femme était chamane, et au fond je me contrefous de l’étiquette qu’on peut lui coller. C’était une guérisseuse, et le travail de nettoyage qu’elle avait initié connaissait son ultime dénouement…
Tout ce que j’espère désormais, c’est que cette énergie néfaste, pesante, et surtout, d’une incommensurable tristesse qui m’habitait a trouvé le chemin vers la sortie. C’est ce dont je parle, quand j’aborde le thème de la confrontation avec soi-même.
On réveille la lame de fond. Et puis, on se trouve en plein centre de sa fureur. Mais il faut apprendre à la gérer, à la dominer, à surfer dessus. C’est là qu’intervient le chamanisme, de n’importe quelle tradition. Voilà la medicina, qu’elle soit personnelle, c’est-à-dire pouvoir curatif de sa propre conscience sur elle-même, ou bien apporté par une femme dont on entend parlé, et dont on se dit : Tiens tiens…
Continuer l’aventure avec le Diario Latino #5 !
© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés
El Diario Latino #3
D’emblée, la conversation a pris un tour plus qu’intéressant. C’est marrant comment ça marche. On commence à évoquer son voyage, ses passions, son taff d’écrivain, et on en arrive à parler de Pablo Escobar, Nietzsche et Bukowski. Au final, j’ai passé la journée à parler avec le Colombien. Il y avait quelque chose de surréaliste à se trouver si loin de chez soi, en plein cœur des Caraïbes, à creuser la pensée de Schopenhauer, la vision artistique de Fante et la façon d’écrire de Buko.
Bahia Aguacate, Colombie : Jour 25
Un voyage en bus qui fait pleurer
Le voyage depuis Santa Fé jusqu’à Turbo a été assez inconfortable. J’ai perdu l’habitude de pas avoir ma place à la fenêtre, mais quand j’ai grimpé dans le bus il était déjà plein. C’est la haute saison ici, et les gens débarquent en masse vers la côte depuis Medellín. Ceci dit, je l’ai plutôt bien pris, me contentant de regarder le bout de paysage à moitié caché par la tête de mon pionceur de voisin qui m’était dévolu, en bouffant les fruits que je m’étais achetés au terminal.
Petit à petit, le bus s’est vidé de ses occupants, et durant les dernières heures de voyage j’ai retrouvé ma position fétiche, le nez collé à la vitre. Pour plonger dans quelque chose de sombre.
J’ai déjà dit que la longue contemplation induite par les trajets qui durent des heures étaient propices à la méditation, et à une certaine introspection, un examen dépassionné de soi-même, de son passé et de son futur, bien loin du tumulte un brin pathétique et surtout affreusement stérile qui prend place au sein de notre tête dans la folie du quotidien, où quasiment toutes les pensées naissent de la peur, de la volonté mesquine de dominer les autres, et surtout de la certitude égotique que le monde tourne autour de soi.
La contrepartie de ce regard neuf, qui plonge aussi loin en soi que dans le monde, est qu’il amène vers la surface des éléments qu’on pensait enterrés. Comme une sorte d’auto-hypnose, probablement. Dans la vie normale, on ne prend jamais le temps d’être inactif pendant si longtemps (sept heures, par exemple, comme ce voyage en bus). Pas étonnant que ce matériel psychique reste hors de notre portée. Mais dans ces circonstances, pas le choix que d’être entièrement immergé en soi. C’est assez étrange, cette résonance que la contemplation du monde provoque. Cette résonance avec son moi profond.
Comme un tambour primitif qui appelle à la vie, à la lumière, les échos d’anciennes souffrances, pour les faire danser sous le regard de notre conscience devenue extralucide.
J’ai pas envie d’entrer dans les détails de ce qui s’est passé, mais j’ai pleuré en silence durant une heure, seule face à ma vitre. J’éprouve aucune honte à pleurer devant des étrangers, mais je me suis tout de même contenue du mieux possible. Parce que si la digue avait cédé autant qu’elle le souhaitait, les torrents de douleur qu’elle retenait auraient inondé l’ensemble du monde. Le mien, et probablement celui des autres.
Il y a pourtant un étrange constat à faire au sujet de cet épisode. La vérité, c’est que j’étais rassurée que cette souffrance vive encore en moi, aussi vraie, aussi profonde que le jour de sa disparition. Il m’était souvent arrivé de me sentir coupable de l’avoir si vite acceptée, d’avoir pu continuer ma vie comme si le pas avait été définitivement franchi. Réaliser qu’il n’en était rien, que la tristesse était toujours aussi vive, aussi brûlante près d’un an et demi après, m’a fait comprendre qu’elle existerait là, pour toujours, et qu’il suffisait que je plonge les yeux suffisamment longtemps dans l'abîme pour la ressusciter, et l’éprouver dans toute sa démence, dans le vide sans fond qu’elle avait creusé, et qui m’habiterait à jamais, tel un nouveau constituant de mon être.
Exister par le vide, avec un creux, un puits creusé en plein cœur… et pouvoir malgré tout continuer à fonctionner. Peut-être plus riche, plus dense, plus complexe grâce à cette place un jour habitée, désormais vide. Comme l’écho de la mer dans un coquillage. Ça faisait chaud, et aussi atrocement froid.
Mais c’était moi. C’est ça que je suis désormais.
Le vieux Black à la chariote
Arrivée à Turbo, la nuit n’était plus très loin, et en sortant du bus j’ai cherché des taxis sans pouvoir en trouver un seul. Ça me paraissait zarbi, étant donné que le terminal était plutôt excentré. C’est là qu’un vieux black m’a abordée, en me voyant errer comme une gourde, me proposant de me conduire à mon hôtel, moi et mes sacs, dans sa chariote à roulette qu’il manœuvrait comme un vélo. Mais ça va faire lourd pour toi, j’ai grogné en désignant mon équipement et ma propre personne. Nan, pas de problème, il a fait, je peux transbahuter beaucoup plus.
C’est là que j’ai aperçu les motos. Pas des moto-taxis, des vraies motos. Dans certains bleds, c’est ça, les taxis. Mais le vieux paraissait ravi de me conduire, et il avait visiblement besoin de sous puisque quand j’ai tiqué sur le prix annoncé, il m’a demandé combien j’étais prête à lui offrir. Ça a achevé de me convaincre. Et puis je le sentais bien. Il m’appelait déjà mi amor et mi reinita (bon, comme ils font tous par ici, même entre eux, même de femme à femme ou d’homme à homme), et on a papoté comme deux vieux potos tout le long de la route jusqu’à l’hôtel (y a pas eu moyen qu’il m’emmène à celui que je voulais, mais j’ai pas trop lutté non plus, acceptant qu’il me largue à celui qu’il avait élu. S’il touchait une commission grâce à moi, tant mieux pour lui). D’ailleurs, au moment de le payer, je lui ai finalement fourgué le prix initial qu’il m’avait demandé.
Ai-je déjà dit que je marchande quasiment jamais ? Je conchie le principe de faire baisser les prix à des gens qui ont beaucoup moins de pouvoir d’achat que moi. Baisser un prix de quelques milliers de pesos représente souvent quelques euros pour moi, mais énormément pour eux. Donc, merde à la sacro-sainte loi du touriste qui moyenne comme un perdu et se sent fier de lui quand il parvient à ses fins. Depuis mon premier voyage, j’ai adopté cette ligne de conduite et je m’y tiens.
Bref, l’hôtel donnait sur la rue hyper bruyante, mais je savais que ça allait pas m’empêcher de pioncer. J’ai observé la vie de cette ville depuis la terrasse de ma piaule, une Corona et un paquet de clopes à portée de main. Le lendemain je devais partir super tôt pour choper un bateau pour le bled de mes potes, près de Capurgana.
De la flotte plein la gueule, un paradis perdu et un Colombien fan de Bukowski qui cause scopolamine
A six heures du mat, il pleuvait sa race et je m'inquiétais un peu de la traversée que j’allais me farcir avec ce temps de chiotte et la mer que j’imaginais ultra agitée. Mais le chauffeur de taxi qui m’a conduite à l’embarcadère m’a dit que les eaux étaient calmes quand il flottait comme ça. En même temps, c’est des détails dont je me moque un peu. Je savais que je pouvais protéger mes affaires avec des sacs plastique vendus sur place, et j’ai quasiment peur de rien. Une mer agitée, c'est chiant sur le moment, mais les pilotes savent gérer le truc, alors pourquoi s’en faire ?
On a décollé à huit heures. La pluie avait cessé et la mer était calme. Y avait pas grand-chose à voir au départ, mais je savais très bien que j’étais en partance pour un paradis, et ce changement de moyen de transport me ravissait. Un voyage n’est total que quand on cumule toutes les façons de se déplacer : avion, bus, 4x4, bateau, pirogue, cheval… Ça c’est du trip, bon sang de bois !
C’est quand on a débarqué les premières personnes et qu’on s’est arrêtés pour une pause pipi que j’ai réalisé l’ampleur du délire : eau turquoise, cocotiers, musique à fond dans les bars, des Blacks partout. Putain, j’étais à nouveau en plein rêve !
Manque de bol, la pluie s’est remise à tomber pour la dernière demi-heure de trajet, et je m’en suis pris plein la gueule, obligée de fermer les yeux face à la flotte, pluie et vagues salées, qui me fouettaient et me cinglaient la face en continu. Mais c’était tellement marrant de sentir le bateau cogner l’eau, les yeux clos comme dans un grand-huit, incapable de prédire le prochain coup, à la merci des flots.
Le bateau m’a larguée toute seule sur une plage qui semblait abandonnée. La pluie tombait toujours et je me suis réfugiée pour fumer une clope sous l'auvent d’une baraque qui elle aussi paraissait inhabitée. On m’avait dit que l’hôtel était en face dans la montagne, en pleine jungle, et que j’avais qu’à demander aux habitants où il se trouvait.
Donc no panic, une fois de plus.
J’ai repéré deux nanas qui semblaient attendre quelque chose, et me suis mise à taper la discute avec elles. Y se trouvent qu’elles attendaient un gars de l’hostal où je devais aller, qu’allait venir les chercher. Nickel. Deux secondes après il était là, et on a grimpé la pente boueuse qui menait vers les hauteurs jusqu’à ce fameux Hostal Doble Vista, qui porte bien son nom. Un mirage tout en bois et hamacs, cabanes au toit de palme, dont le QG est une plateforme sur deux étages ouvrant sur 360 degrés de jungle et de mer. J’ai salué mes potes, pris possession de ma bicoque à la Robinson, et suis revenue me taper une bière avec les femmes de Bogotá que j’avais rencontrées en bas et un jeune Colombien qui squattait dans le coin.
D’emblée, la conversation a pris un tour plus qu’intéressant. C’est marrant comment ça marche. On commence à évoquer son voyage, ses passions, son taff d’écrivain, et on en arrive à parler de Pablo Escobar, Nietzsche et Bukowski. Au final, j’ai passé la journée à parler avec le Colombien. Il y avait quelque chose de surréaliste à se trouver si loin de chez soi, en plein cœur des Caraïbes, à creuser la pensée de Schopenhauer, la vision artistique de Fante et la façon d’écrire de Buko. C’est peut-être un lieu commun, mais on aurait tort de croire que cette sphère n’appartient qu’à l'intelligentsia occidentale. Ce jeune mec avait lu ces auteurs bien plus profondément que moi, et son analyse, sa vision de leur philosophie étaient poussées à l’extrême.
C’est rare pour moi de rencontrer des gens qui s’intéressent précisément aux mêmes auteurs que moi, et ma foi, c’était son cas à lui aussi. Bière après bière, livre après livre, on a refait le monde en se racontant la manière dont l’art avait changé nos vies. Je lui ai parlé de Borderline, il m’a raconté l’histoire qu’il avait en tête.
Ici en Colombie, y a un guet-apens très répandu à base de scopolamine, qu’on appelle dans le coin burundanga ou encore Sople del diablo (le souffle du diable), dont sont victimes aussi bien les touristes que les locaux. Ça se passe principalement dans les grandes villes, avec Bogotá et ses bas quartiers en vedette. Le GHB, aussi connu sous le nom de “drogue du viol”, ça vous dit quelque chose ? J’ai de bonnes raisons de penser que cette fameuse scopolamine est le même principe actif, sauf qu’il n’est pas synthétisé chimiquement comme chez nous. C’est une poudre qu’on produit avec les graines de la Datura, de la famille des Brugmansia, des plantes qu’on a aussi en France, et dont je parle dans l’Inventaire des Plantes Maîtresses : le fameux Toé, c’est elle.
Bref, tu réduis les graines en poudre, que tu vas ensuite glisser subrepticement dans le verre de ta future victime. Les effets ? Eh bien, à partir de là, ton pigeon va faire exactement tout ce que tu lui demandes, sans manifester aucune résistance. Il se transforme en victime consentante qui va vider son compte en banque pour toi, t’inviter chez lui ou dans son hôtel, te filer son PC et son portable, et même pourquoi pas t’offrir son cul sans même un froncement de sourcils devant tes exigences. Tout au fond de lui, il sentira peut-être que quelque chose déconne, mais ça n’atteindra pas la partie dirigeante de son cortex, et les témoins de ton petit jeu ne pourront pas deviner que t’es en train de dépouiller un malheureux, d'autant plus que les barmans ou videurs sont souvent les complices avec qui tu partages le magot. Et puis pourquoi se priver après tout ? Le lendemain, ce couillon se rappellera quasiment de rien… Attention, cela dit : si tu deviens trop gourmand et lui refous une lichette de poudre dans un nouveau verre au milieu de la nuit, il se pourrait bien que le pigeon défaille d’un arrêt cardiaque, et là tu devras te débarrasser du corps, ce qui est plus emmerdant.
Tu vois le délire ? J’ai rencontré ici un nombre faramineux de personnes à qui c’est arrivé, principalement des hommes en fait, qui se sont faits avoir par une fille qu’avait même pas l’air d’une pute. Dont mon fameux pote colombien. Il avait donc envie de transformer sa sinistre aventure en nouvelle littéraire, mais en modifiant un peu la fin de l’histoire. Il avait vu un reportage (dont voici le lien) où un type ayant subi cette magouille témoignait. Mais ce type avait décidé de se venger, en punissant ceux qui lui avaient fait ça ; c’est-à-dire, en les butant les uns après les autres.
Pas mal, n’est-ce pas ? Évidemment, je l’ai sauvagement encouragé à écrire cette putain de nouvelle ! Partir de son expérience personnelle, avec tout ce que ça suppose d’immersion psychique et corporelle, vivre cette sombre dépossession de l’intérieur, puis, comme tout bon auteur, enrichir tout ça d’une autre histoire vraie dont on s’inspire…
Mec, si on tient pas ici la recette d’une histoire fracassante de réalité, je sais pas ce que c’est !
Des rencontres qui vont à l’essentiel
Cette rencontre n’était que la première d’une longue série. Ici, dans cet hostal, les voyageurs ont tendance à se retrouver dans les parties communes, bar, toit-terrasse, petits salons et hamacs, et très vite on en vient à parler de ce qui nous anime. Les rapports sont différents quand on est en transit quelque part. Il y a comme une économie de mots, une volonté d’aller à l’essentiel, d’évoquer les choses qui comptent véritablement pour nous, plutôt que de se perdre dans les détails insignifiants et souvent mortifères du quotidien, dont on parle plus volontiers avec les amis proches. Ici, tout est à découvrir, et ne serait-ce que de demander à quelqu’un pourquoi il voyage, pour combien de temps, son itinéraire et les merveilles qu’il a croisées sur sa route amorce d’emblée un autre type de relation. Bon, cela dit, faut pas non plus croire qu'on tombe jamais sur de fourbes fils à papa qui prétendent être autre chose que ce qu'ils sont pour avoir l'air plus roots.
Je découvre qu’être écrivain, un écrivain-voyageur qui va faire la route pour longtemps, présente aux autres la meilleure facette de moi-même, et m’incite à leur ouvrir mes mondes sans retenue. D’ailleurs, je me dis que je devrais peut-être écrire un article là-dessus. Sur les spécificités du romancier vagabond.
Oui, j’écris. Je suis une ayahuasquera. J’ai publié cinq livres. Je tiens un blog qui parle de liberté.
Je pense que vous pouvez imaginer qu’en déballant l’affaire comme ça, les discussions qui s’ensuivent n’ont pas la même teneur que de se trouver en France et de dire : je suis serveuse, je taffe pour toute la saison.
Faire la liste de toutes les personnes que j’ai croisées prendrait trop de temps, mais qu’il s’agisse de locaux, de travellers ou de gens qui se sont installés ici pour monter une affaire, moi qui suis d’une nature solitaire, j’éprouve en fait un grand plaisir à découvrir le parcours chaque fois différent de ces âmes réunies ici en un même lieu, en un même temps. J’aurais aimé faire des shooting de ceux qui m’ont le plus marquées, du style galerie de portraits en noir et blanc, mais je me sens pas assez confiante en mes qualités de photographe pour ça. Ce sont pourtant des visages qui mériteraient d’être gravés.
Vivre comme une sauvage qui boit des bières
Le quotidien ici est assez cool, le rythme caribéen prend rapidement possession de celui qui s’arrête dans le coin. Mais je suis quand même loin de passer ma vie dans un hamac à siroter des Coco Loco.
Le truc particulier, c’est que j’éprouve ici une détente dont je me croyais plus capable. Se réveiller avec le soleil, boire un café tout là-haut en observant la mer, les toucans et les singes dans les arbres, écrire face à l’immensité, se baigner des heures, sans penser à rien, en osmose avec la mer. Se reposer dans un hamac en lisant des livres sur l’ayahuasca, puis partir en exploration le long de la côte ou dans la forêt des montagnes. Et se sentir… vibrer au sein de cette végétation à l’odeur entêtante, capiteuse, où la nature ne cesse de croître, de se dévorer et de renaître, dans un cercle infini, et avoir la sensation d’être un de ces Hommes d’il y a longtemps, tellement connecté à ses racines qu’il ne peut plus dire : ceci est mon corps, ceci est la nature, parce qu’il fusionne avec ce que ses sens embrassent… Et puis redevenir humain en rentrant pour boire des bières et fumer des clopes avec les autres voyageurs… Et se coucher tôt, comme tout le monde ici, avec la mer qui chante au loin et les insectes et les grenouilles qui entonnent leur concert nocturne comme un envoûtement primitif…
Fiesta, danse rituelle et cocaïne
La fête ici, c’est quelque chose de phénoménal. Passer Noël et le jour de l’an loin de chez soi peut donner des résultats plus ou moins foireux, et j’ai souvenir d’avoir attendu le Père Noël toute seule comme une merde sous ma tente inondée en Argentine, ou alors de m’être retrouvée à bouffer de la soupe à la tomate préparée à l’arrache par un hôtel qui ne pensait qu’à faire la fête de son côté en famille pour un 31 au Honduras…
Mais cette fois-ci, j’ai plutôt visé juste. C’est d’ailleurs la raison principale qui m’a poussée à squatter ici pendant deux semaines, en dehors du fait que l’endroit est splendide et que les dueños de l’hostal sont mes potes. Les prix grimpent à mort pendant cette période dans toute l’Amérique latine, et faut s’y prendre pas mal à l’avance pour réserver ses piaules, chose dont je suis parfaitement incapable. Une fois de plus, je me suis déjà fait niquer en Argentine à payer le triple pour une chambre miteuse, parce que tous les hôtels des environs étaient complets. Hors de question que ça m’arrive de nouveau, ce coup-ci le truc était calé.
En dehors de cet hostal, ça bouge pas des masses sur le reste de la petite plage de Bahia Aguacate (où y a pas de village, d’ailleurs, le plus proche étant celui de Capurgana), et vu que mes potes sont bien implantés et ont de bons rapports avec les locaux, bah tout le monde rapplique pour faire la fiesta là-haut où se trouve le bar et l’immense toit-terrasse avec vue à 360 degrés.
Et ça envoie du lourd. Tout le monde danse et s’enfile des bières et des shot de rhum artisanal, au son de cette musique d’ici, salsa, merengue, reggae ton, cumbia…
Les jeunes, les grosses, les vieux, les gosses, ils ont vraiment ça dans le sang, bordel ! Pour Noël, un moment en particulier m’a marquée. Y avait le petit gars qui bosse sur la construction de la future maison d’hôtes spécial digital nomad d’un Français d’ici, et El Capitan, un vieux qui s'occupe du service de lancha (bateau) pour l’hostal en transbahutant les voyageurs de Bahia Aguacate à Capurgana ou Sapzurro.
On dansait tous au milieu de la salle lorsqu’un gros type d’ici saisit une immense flûte en bois et se met à coller un son ambiance vaudou sur la musique, d’une façon totalement instinctive. Alors le vieux et le jeune commencent à s’avancer en plein centre de la danse, et les gens forment un cercle autour d’eux. Le vieux danse comme un soulman, tenant le devant de son pantalon, tandis que le jeune se meut d’une façon serpentine, à la limite de l'épilepsie parfois, et le jeu qu’ils jouent ensemble, le spectacle qu’ils offrent a quelque chose de profondément authentique, comme deux hommes des cavernes se laissant envahir par les vibrations d’un appel de la Terre… Tout le monde les encourage, crie, applaudit en cœur, tape des mains et des pieds, parce que c’est comme d’assister à un rite, une danse ancestrale, aussi vieille que l’animal qui hurle encore en chacun de nous, et je suis si heureuse d’être témoin de ça que ça me réconcilierait presque avec l’être humain !
Après plusieurs verres et des litres de sueur évacués, inévitablement, j’ai goûté la coke d’ici, incroyablement pure. Faut dire qu’on est pile-poil sur le parcours des narcos ici, ceux du Clan del Golfo, l’une des organisations criminelles les plus puissantes de Colombie. Cette zone a été rouverte au tourisme il y a peu, mais elle est encore pleine de paramilitaires. En fait, il s’agit des types qui surveillent les passeurs de drogue, qui partent à bord des bateaux chargés de poudre qu’on voit régulièrement prendre la mer pour aller livrer les États-Unis qui sont finalement tout près. Mais tout le monde vit en bonne entente. La coke est bonne et pas chère, et les touristes ne courent aucun danger.
La bonne cocaïne te fait pas serrer des dents et t’empêche pas de dormir. Ça, c’est quand elle est coupée au speed, aux amphés, quoi. Rien de tout ça ici, on la chope au tout début de son parcours, avant qu’elle passe entre une centaine de mains qui ajouteront leur coupe afin de s’en mettre un peu plus dans les fouilles. Inutile de préciser que celle qui nous parvient en France contient à la fin plus d’additifs que de cocaïne, et que son prix a grimpé d’une manière proportionnelle à la merde qu’elle contient.
Mais j’ai sniffé deux pointes et ça m’a suffit. Depuis que j’ai découvert la transe, le vrai voyage avec l’ayahuasca, ce genre de dope m’intéresse plus des masses.
J’ai gerbé ma race avant de me coucher, ce qui était plutôt une bonne idée. Tu t’enfiles des verres, tu danses, tu te lâches, et puis tu dégobilles tout avant de dormir histoire de pas avoir à cuver, et tu te réveilles frais comme un gardon le lendemain. Technique personnelle qui a maintes fois fait ses preuves.
Jouer à Raoul Duke et prêter l’oreille à Travis Montiano
J’avoue qu’il m’arrive parfois de me sentir comme ce bon vieux Hunter S. Thompson qui s’enquillait alcool et dope tout en essayant d’écrire Rhum Express lors de son séjour à Puerto Rico. Je suis peut-être un peu trop dans le fantasme, mais j’ai toujours adoré marcher dans les traces de mes idoles, et faut reconnaitre que le côté écrivain-voyageur est une casquette particulièrement agréable à porter. Mais bon, tout comme lui, j’ai parfois du mal à m’astreindre à écrire au lieu d’être dans la démence de la vie en train d’être vécue. Et puis, je sens qu’il faut encore que ça mature.
L’histoire de Travis est là, juste sous la surface de ma conscience, mais il ne me livrera pas ses derniers secrets tant que je ne me serais pas confrontée à ce qui a été désigné, loin dans le passé, comme l’ultime essence, la révélation finale qui donnera tout son sens à ce qu’il a traversé. Et à ce que j’ai traversé avec lui.
Alors j’attends. J’écris sur la périphérie. Je pose le décor. Je creuse timidement.
Je ne suis encore qu’au tout début du voyage, et si je parviens à réaliser les plans vertigineux que je fomente chaque jour un peu plus, alors ça ne fait aucun doute que Borderline aura la digne fin que cette saga mérite.
Poursuivre la route avec le Diario Latino #4 !
© Zoë Hababou 2022 - Tous droits réservés
El Diario Latino #2
Je me suis dit que c’était une réalité que les gens de chez moi ne pouvaient même pas envisager. Tout ce bordel, cette chaleur humaine et cette folie à cent à l’heure. Toute cette crasse qui pourtant se débrouille pour être accueillante. Nan, ils pouvaient pas imaginer. Et je me demandais comment moi, j’avais réussi à m’y faire.
Santa Fé de Antioquia, Colombie : Jour 10
Dans la vie, y a deux sortes de personnes : les Aventuriers et les Hipsters
Enfin un endroit un peu posé pour écrire. Foutredieu, c’est pas si évident de conjuguer aventure et écriture ! J’imagine que les vrais digital nomads voyagent pas de la même façon que moi. Sans doute qu’ils favorisent les grandes villes avec leurs cafés hipsters où ils peuvent se connecter tranquillos en se tapant des latte macchiato tout comme à la maison, en louant un Airbnb plusieurs jours d’affilée. C’est pas du tout ma manière de faire, et je compte aucunement la changer. Le truc, c’est que si je veux écrire sur l’aventure, faut bien que je la vive pour de vrai avant, nan ?
Je pensais à Kerouac, hier. Y me semble bien qu’il rentrait chez môman entre deux virées avec Neal Cassady pour taper ses notes et tenter d’en faire des romans. Ma foi, si je dois me contenter de larguer quelques mots à l’arrache ici, pour les mettre en forme et reconstituer le puzzle une fois rentrée, pourquoi pas ? Hunter S. Thompson s’y prenait un peu de la même manière, et pour tout dire il aurait presque souhaité que ses patrons des grands journaux soient suffisamment freestyle pour oser publier ses bouts de reportages tels quels.
On verra comment ça se goupille, aujourd’hui j’ai du temps, une connexion qui tient la route, et du produit anti-moustiques. Ces petits enculés me défonceront pas les jambes pendant que j’écris. Et puis, j’ai qu’à traverser la rue pour aller me taper une bière si jamais l’inspiration venait à manquer.
Je me sens bien ici. J’aurais pu faire comme ces fameux hipsters et rester à Medellín, qui est soi-disant une ville géniale, ultra-vivante, moderne et compagnie. Tu parles. Je l’ai à peine traversée en taxi pour me rendre du terminal sud au terminal nord. M’avait l’air aussi moisie que les autres grandes villes ! Ce village me ressemble beaucoup plus. C’est pas hipster pour deux sous, loin s’en faut, mais imaginez Indiana Jones débarquer chez les barbus en slim et vous aurez une idée de ma dégaine.
Ouais, parfois, vaut mieux rester avec ses paires…
C’est un monde de fou
J’ai quitté Manizales le lendemain du premier Diario, déjà impatiente de continuer ma route. Aussi beau que soit un endroit, il le sera jamais autant que celui que tu connais pas encore. Le chauffeur de taxi m’a prise pour une Espagnole. Ça fait toujours plaisir de se dire qu’on parle suffisamment bien la langue pour faire illusion. Au terminal, le petit jeune qui conduisait le collectivo (mini-bus) m’a fait monter à l’avant. Rien de mieux pour avoir une vue totale sur l’Eje Cafetero, ou Zona Cafetera, bref, la région du café, quoi, constituée de montagnes où les fameux plants croissent comme des petits fous.
Ce conducteur avait l’air très fier de sa région. C’est un truc que j’ai souvent remarqué, et pas que chez les Latinos. D’où je viens, les gens sont également persuadés que rien ne vaut l’endroit où ils sont nés, alors que bien souvent, ils ont jamais foutu les pieds ailleurs. Ce sentiment d’appartenance, qu’on appelle je crois “régionalisme”, m’est totalement étranger. J’ai sans doute trop souvent déménagé pour venir encore d’où que ce soit, et être attachée à un lieu précis. Et puis, je sais que le monde qui s’étend au-delà de notre paillasson recèle un charme qu’aucun lieu connu ne pourra jamais prétendre posséder. Mais ce type n’était pas trop causant, en fin de compte. Tant mieux, je déteste parler quand j’observe le paysage. Les gens ont souvent cette sale manie de la ramener au lieu de te laisser te concentrer. Bref, ce mec-là était cool pour ça, et on se contentait de se sourire bêtement quand nos yeux se croisaient.
On a fait un arrêt dans une ville pour qu’il réceptionne d’autres voyageurs. Depuis la place du mort du micro-bus, je regardais tout ce qui se passait d’un œil à la fois habitué et surpris. Ça criait de partout dans cette rue, les rabatteurs de bus donnaient de la voix, comme ils font dans toute l’Amérique Latine, PEREIRA, PEREIRA, PEREIRITA (le bled où se dirigeait le bus), un homme orchestre attifé en rastaman est passé en claudiquant devant moi, un autre est monté dans le bus pour vendre ses chewing-gums, en appelant à Dieu pour nous inciter à céder et lui acheter ses merdes, des femmes avec leurs glacières hurlaient HAY AGUA HAY GASEOSAS (y a de l’eau, y a des sodas), ajoutant au vacarme général, et les rabatteurs continuaient, sube mi amor, te esperamos (monte chérie, on t’attend), qu’ils disaient à tout ce qui porte des seins. Un peu plus loin sur le trottoir un resto-grill de salchichas (saucisses) crachait ses vapeurs graisseuses tandis que le chauffeur, à l’aise dans son univers, poli et souriant, encaissait le fric en attendant que son bus soit plein.
Je me suis dit que c’était une réalité que les gens de chez moi ne pouvaient même pas envisager. Tout ce bordel, cette chaleur humaine et cette folie à cent à l’heure. Toute cette crasse qui pourtant se débrouille pour être accueillante. Nan, ils pouvaient pas imaginer. Et je me demandais comment moi, j’avais réussi à m’y faire.
C’est une réalité que j’aimerais savoir transcrire davantage, surtout dans mes livres.
Le rappeur du bus
Arrivée à Pereira, j’ai direct enchaîné avec un bus pour Salento. Y avait quelques gringos à bord pour une fois, ce qui ne m’arrive pas souvent. C’est dingue, mais j’ai régulièrement l’impression d’être la seule touriste au monde ici. Pourtant, je sais qu’on est légion. Sans doute que je me lève trop tôt pour eux. Il m’arrive d’être déjà dans le bus à 7h du mat alors que le touriste de base émerge pas avant 9h.
Peu avant la fin du trajet, un mec est monté avec son gosse. Le style roots, avec des écarteurs aux oreilles et des tatouages sur les bras. J’ai tout de suite su que celui-là aussi allait chercher à nous vendre quelque chose.
Il a sorti un poste de radio à l’ancienne, du style qu’avaient les rapeurs à l’époque de l’arrivée du hip hop, et il a dit : La pire prison qui existe, c’est celle qu’on porte dans notre propre tête. On doit se libérer d’elle avant tout si on veut un jour essayer d’être libre. La chanson que je vais vous chanter cause de ça. Du labyrinthe de la pensée qui torture un Homme dans son cerveau.
Oui. Pour ceux qui ont lu Borderline, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler, et pourquoi j’ai été si surprise. Alors il a lancé sa musique et s’est mis à rapper dessus. Un truc vraiment cool, avec des paroles profondes, un bon rythme, de la passion. Bon après, faut dire que je suis bon public avec le rap latino. Je trouve que ça envoie grave, bien plus fort, en fait, que le rap d’autres pays.
Quand il a terminé, j’ai été la première à lui fourguer un billet. En faisant ce geste, je me suis soudain souvenue de Wish, qui donnait systématiquement aux saltimbanques et autres artesaños (artistes de rue) qui croisaient sa route. Le moindre jongleur qui faisait son truc face aux moto-taxis, profitant d’un feu rouge à Pucallpa, le plus mauvais tisseurs de bracelets à Lima, il lui filait quelque chose, alors que lui-même n’avait quasiment pas un rond. Parce que, lui-même, il avait galéré dans sa jeunesse, et vécu dans la rue, avant de devenir chaman. Qu’il savait ce que c’était, et qu’il avait pas la moindre envie d’oublier.
Moi, j’avais oublié ce trait de caractère de Wish, avant de filer 2000 pesos à ce type en lui disant que ses paroles étaient puissantes. Et puis, par la force des choses, tout le monde dans ce bus a fini par lui fourguer un peu de monnaie. J’étais contente d’avoir initié le machin. Je sais comment c’est. Faut que quelqu’un se lance avant que les autres l’imitent.
Une rando de 20 KM, des colibris et un paquet de clopes
Salento est un village très touristique, mais adorable. Comme dans tous les villages sud-américains, la vie se concentre principalement sur la place principale face à l’église, avec ses petites cabanes qui vendent de la bouffe et ses décorations de Noël. J’ai posé mon sac à l’hôtel et j’ai été me taper une bière dans un rade dont la musique m’avait attirée. D’ailleurs c’est plus ou moins devenu une habitude. Quand je débarque quelque part, je me défais de mes affaires et pars me balader de par les rues pour me boire une cerveza quelque part.
C’est le lendemain que je suis partie pour la fameuse Valle de Cocora. A 6h30 du mat j’étais sur la place centrale pour choper une jeep qui m'emmènerait au début de la rando. Ça faisait longtemps que je m’étais pas retrouvée seule pour marcher en pleine nature comme ça, et surtout pas vingt putains de bornes entre collines et forêt de nuages !
Heureusement que j’avais eu la présence d’esprit de louer des bottes à l’hôtel. L’escapade avec le dueño de Manizales et mes chaussures trempées au retour m’avaient au moins servi de leçon. J’ai dû franchir des rivières et patauger dans la boue pour accomplir ce chemin. Ça montait sa race et j’étais essoufflée à mort, mais faut que je m’entraîne. Si je veux faire des treks plus tard, y a pas à moyenner.
Ça m'a pas empêchée de fumer des clopes tout le long de la route, ceci dit. Je crois bien être la seule à fumer comme ça en randonnant. Les gens d’ici ne fument qu'occasionnellement, parce que c’est un luxe, et les gringos, ma foi, la majorité d’entre eux sont trop healthy pour ça. Les Blancs ont trop bien appris leur putain de leçon. Je m’en tape, j’ai beau être très spirituelle dans certains domaines, je suis pas obligée de prendre le packaging complet. La punk qui vit en moi crache à la gueule de tout ça.
J’ai fait un arrêt à la ferme de colibris, pas très raisonnable vu le prix, mais je tenais à voir ces oiseaux et puis le bout de fromage et le chocolat chaud étaient inclus. Vous pouvez rire, mais j’avais rien avalé depuis la veille tout en m’étant levée à 4h du mat, parce que j’essaye de faire des économies, et que rogner sur la bouffe est le moyen le plus efficace que j’ai trouvé. Après des heures de marche, ces maigres denrées étaient plus que bienvenues.
Un guide et trois Français sont montés à la ferme pendant que je filmais les bestiaux. J’ai tout de suite su qu’ils étaient français, à leur rire. C’est fou qu’on puisse reconnaître sa langue natale dans un simple rire. Mais c’est pas avec eux que j’ai causé, ça non, mais avec leur guide, un jeune gars très cool qui m’a montré les photos qu’il prenait durant les treks où il accompagnait ses clients. Il avait un sacré œil ! Ses photos d’oiseaux étaient dignes d’un pro, et j’ai vraiment apprécié de papoter avec lui. Il semblait aimer son boulot, et rayonnait d’une belle énergie.
Du coup, je lui ai demandé d’essayer de me photographier ces satanés colibris bien trop rapides pour moi. C’est lui qui a pris ce cliché d’eux. Bon, mon appareil est moins bien que le sien, mais au moins j’ai une photo valable !
Ça m'a requinquée de le croiser et j’ai repris la route avec un nouvel allant. Du moins, jusqu'au milieu de la montagne qu’il fallait gravir jusqu’au sommet, quasiment tout droit. J’en ai chié sa mère. Mais une fois en haut, il restait plus que quatre kilomètres assez faciles, en descente, vers la fameuse vallée où poussent ces palmiers à cire uniques en leur genre. Ils offraient une impression bizarre, mais ma solitude et la brume sur les montagnes me laissaient un sentiment d'éternité, de puissance, que j’ai respiré à pleins poumons.
Vingt kilomètres et quatre heures de marche solitaire ont un drôle d’effet sur un Homme. Je me sentais lavée. Épuisée, mais comme nettoyée de l’intérieur.
De retour à l’hôtel, j’ai profité de la machine qui se trouvait là pour laver tout mon linge, plein de boue, de sueur et d’herbe depuis la marche avec le dueño de Manizales. L’eau de la douche était tiédasse, mais c’était le cas depuis que j’avais quitté Bogotá, et je commençais à m’y faire. Tant pis pour mes muscles crispés. Eux aussi, ils allaient finir par s’y faire.
J’ai été me prendre une bière. Manger un morceau. Le lendemain je redécollais, une longue journée de bus m’attendait.
Avant de partir, j’ai laissé un exemplaire de Borderline à l’hôtel, dans la bibliothèque prévue pour le bookexchange.
La chiva de la mort, le pollo et la DMT
Le bled que j’avais choisi n’était pas facile à atteindre, du moins, il s’écartait un peu de la route classique du gringo. Pourtant, au terminal de Salento, j’ai trouvé d’autres touristes qui prenaient la même direction que moi. Celle de Jardín, en l'occurrence, village niché en plein cœur de la Zona Cafetera. Il y avait là deux Polonais, une Thaïlandaise et un Hollandais. Les Polaks sont rapidement venus me parler. Et c’est toujours la même histoire : ils me racontent qu’ils sont là pour deux semaines, que ça fait déjà une semaine qu’ils sont là, et au vu de leur parcours c’est le genre qui se contente de quelques spots parmi les plus touristiques. Et puis le type vise mon sac, et me fait :
- Et toi, t’es là pour combien de temps ?
- Un an.
- Un an (pincement de jalousie) ? Et tu voyages qu’avec ça ? Hey, regarde chérie, elle part un an et elle a qu’un tout petit sac ! (et, se retournant vers moi) J'arrête pas de lui dire qu’elle prend toujours trop, mais bon…
- Je suis minimaliste, je fais comme pour m’excuser, en avisant son sac du coin de l’œil, qu’est pas plus léger que celui de sa copine…
La Thaïlandaise hoche la tête vigoureusement. Elle voyage avec encore moins que moi. La Polonaise s’intéresse à mon cas, est surprise que je sois écrivain, veut en savoir plus. Quand je lui dis que j’écris une saga, elle veut savoir si c’est de la fantasy. Marrant, hein, que les sagas soient forcément associées à ce genre-là. Mais non. Je finis par lui montrer mon livre.
On se tape les premières heures de bus chacun dans son coin, les touristes jouant avec leur téléphone ou en train de pioncer, moi collée à la vitre à regarder mon paysage. Lors du changement de bus au terminal, tous se précipitent pour aller bouffer vite fait du pollo con arroz (poulet avec du riz) dans le premier rade qui traîne. Moi non. Je mange pas de pollo et j’ai pas de sous. Je me contente d’un coca et de mes clopes. C’est ça quand on part longtemps. Faut une certaine ascèse, et être capable de bouffer qu’une fois par jour.
Une heure plus tard, on grimpait dans la chiva, bus typique de la Colombie. Pour des gringos comme nous, c’était le rêve, surtout pour moi qui aime être au plus près de la nature. Mais on a vite déchanté. Au bout de deux heures de route à deux à l’heure, à cahoter de partout et à rebondir sur nos fesses comme des zébulons en phase terminale, avec le froid et l’humidité qui tombaient à mesure qu’on s’élevait dans les montagnes, le trip n’était plus si folichon que ça.
On nous avait dit que le trajet durait entre deux et trois heures.
Quatre heures plus tard, il faisait nuit, on était frigorifiés et toujours pas arrivés. J’ai fini par dévier mon esprit de sa souffrance en papotant philo et DMT avec le Hollandais. C’est le genre de conversation que j’adore, suffisamment intriguante et prenante pour parvenir à se concentrer sur autre chose.
Un village en fiesta perpétuelle
Une fois débarqué à Jardín, ce que je me figurais comme un tout petit pueblo assoupi s’est révélé être un village endiablé à la vivacité extrême, avec une place centrale immense, une église gigantesque, illuminée à mort pour Noël, et des gens absolument partout, en train de boire du café, de la bière ou de l’aguardiente, tout ça entouré de musique provenant des différents bars tout autour de la place. Incroyable !
C’est peut-être parce que j’habite moi-même dans un trou paumé, mais ça me fait bizarre de voir tant de gens vivre à l’extérieur, à se retrouver tard le soir comme ça, toujours accompagnés de musique. C’est pas une légende. La Colombie est vraiment vivante, avec une culture de proximité entre les habitants qui fait défaut à la France, y me semble. La chambre de mon magnifique hôtel pas cher du tout donnait sur la place, mais j’étais défoncée de fatigue et le grabuge m’a pas empêchée de dormir.
Le lendemain j’ai recroisé le Hollandais et on est partis poursuivre notre conversation en se baladant en dehors de Jardín. Une chouette marche de onze kilomètres au milieu des bananiers. Au retour il prenait la route pour Medellín, et moi je me suis payé un délicieux café (c’est la région, après tout) sur la place.
C’est marrant, moi qui suis d’un naturel sauvage, je commence à accepter d’être exposée au monde. Et je m'imprègne. Je m'imprègne à mort de tout ce qui m'entoure.
Jungle + Colonialisme = Santa Fé de Antioquia !
Le bus partait à 7h du mat, j’allais me rendre à Medellín, mais j’y parviendrais assez tôt pour pas avoir à y passer la nuit. La ville la plus cool de Colombie, tu parles ! Ça me fera toujours marrer, ça. Elle avait l’air aussi crado que les autres. Tout ce qui dépasse le pueblo (village) me semble monstrueux et flippant. Et puis en tant que fille seule, j’ai pas la moindre intention d’aller dans un bar pour me faire draguer et me retrouver avec du GHB dans le verre, ou plutôt, toute nue et dépouillée le lendemain dans une poubelle, sans aucun souvenir de la soirée. J’exagère peut-être, mais le regard des hommes sur moi me suffit déjà amplement. Pas envie de tenter le diable, et pas mon délire non plus. Donc j’ai pris un taxi pour changer de terminal et sauté dans un collectivo pour Santa Fé de Antioquia.
C’est marrant, mais je pensais pas débarquer dans un bled si humide, quasiment la jungle, qui a pourtant des airs coloniaux. Les moustiques m’ont attaquée dès ma première clope dehors à mon arrivée à l’hôtel. Une sorte de petite maison chez l’habitant, vraiment pas chère, où je suis en train d’écrire ces lignes. Malgré ma fatigue, je suis sortie en traversant tout le village pour aller découvrir un peu les environs et me prendre une bière au parc central. Je suis tombée sur un joli cimetière, mais il était fermé.
C’est bizarre mais c’est seulement à ce moment-là que je me suis souvenue à quel point j’aimais les cimetières latinos lors de mon tout premier voyage, au point de les rechercher avec attention, de les prendre en photos sous tous les angles, et même d’écrire Borderline, assise entre deux caveaux. Parfois je me demande pourquoi une partie de la conscience s’obscurcit comme ça, et se réveille des années après.
Poursuivre l’aventure avec le Diario Latino #3 !
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
El Diario Latino #1
Le chauffeur de taxi m’a entubée direct. Pourtant, c’est pas comme si j’avais pas fait attention de bien prendre un taxi officiel à l’aéroport, étant donné le risque très concret qui existe de se faire niquer à Bogotá avec les taxis sans compteur conduits pas des types aux ambitions plus que douteuses. Et dans ce cas-là, le problème qui se pose n’est pas seulement lié au pognon. A vrai dire, le fait de se faire tirer le triple de ce que vaut la course habituelle est bien le moindre des problèmes qui peuvent t’arriver.
Manizales, Colombie : Jour 3
Les taxis sont des enfoirés
Le chauffeur de taxi m’a entubée direct. Pourtant, c’est pas comme si j’avais pas fait attention de bien prendre un taxi officiel à l’aéroport, étant donné le risque très concret qui existe de se faire niquer à Bogotá avec les taxis sans compteur conduits pas des types aux ambitions plus que douteuses. Et dans ce cas-là, le problème qui se pose n’est pas seulement lié au pognon. A vrai dire, le fait de se faire tirer le triple de ce que vaut la course habituelle est bien le moindre des problèmes qui peuvent t’arriver.
Quand il m’a annoncé le montant de la facture, j’ai même pas lutté. Après deux jours de voyage depuis chez moi à Barcelone, puis de Barcelone à Amsterdam, et enfin d'Amsterdam à Bogotá, sans compter les trois plombes qu’il avait fallu attendre, debout dans une file longue comme trois fois mon bras, pour passer le contrôle de migration (imagine le délire : pour ton corps il est presque minuit, t’as dormi deux heures à l’hôtel d’Amsterdam et pas un brin dans l’avion, t’as le bide en vrac rapport à la bouffe de merde que tu t’es tapée depuis ton départ, et en Colombie il est 15h, et tu sais que tu dois encore récupérer ton sac, pisser un coup, acheter une merde quelconque à boire, trouver des clopes, retirer du fric au DAB et puis dégoter un taxi en essayant de moyenner pour pas qu’il t’encule - loupé -, te farcir la route jusqu’à l’hôtel et enfin te trainer sous la douche et tomber comme une merde).
Après, faut avouer que j’étais juste heureuse d’être de retour sur ce continent. En regardant les palmiers défiler et les graffitis sur les murs, avec la radio du taxi qui diffusait cette musique typique d’ici, je me suis retrouvée des années en arrière, lors de mon arrivée à Lima, pour mon tout premier trip. C’est remonté en moi, cette mémoire enfouie, qui se fait si souvent oublier, mais qui jaillit dès qu’elle est en contact avec ce qu’elle reconnaît comme sa source. J’étais animée d’un bonheur serein, profond, un peu comme quand on sait qu’on rentre à la maison, peut-être. Sauf que moi, ça me fait ça quand je retrouve la route.
Alors, il m’a dit son prix, j’ai fait Ouais, c’est ça, je lui ai fourgué sa thune et me suis dirigée vers la porte de l’hôtel. Un type m’a matée tandis que j’entrais. Bogotá me faisait déjà peur, putain, d’autant plus que c’était quasiment la nuit. Je hais les putains de capitales, de n’importe quel pays que ce soit, même Paris, bordel. Le type est entré derrière moi. C’était lui, le gérant. Il était affligé d’un handicap je crois, peut-être la polio qui lui avait déformé un bras et une jambe. Mais il était plutôt beau gosse, du moins quand on aime le style bad boy latino, et il était très serviable. Il m’a accompagnée à ma piaule qui donnait sur la rue, un chouette truc, en fait. J’ai pris une douche bouillante et me suis pieutée. Il était 20h ici, 2h du mat au pays d’où je venais. J’ai sombré.
Les flics, les clodos, besoin de fumer
Les alarmes de voitures de police m’ont réveillée. J’avais le sentiment d’avoir déjà beaucoup dormi, mais il était que minuit. J’ai vérifié ce qui se passait à la fenêtre. Les flics squattaient là, mais impossible de savoir pourquoi. Je suis retournée dormir, mais deux heures plus tard j’étais à nouveau debout. J’ai maté ce qui se tramait dehors. Ce coup-ci c’était un type en train de fouiller les poubelles, juste en face de moi. Il les a vidées en totalité sur le sol, afin de récolter des restes de bouffe dans un des sacs. Je l’ai laissé à son affaire pour aller me doucher. A mon retour un pote à lui l’avait rejoint et ils s’y mettaient à deux.
Fallait que je fume, putain. J’ai zoné dans l’hôtel en essayant de trouver un patio ou une porte de derrière ouverte. Que dalle, et la porte principale était verrouillée. Je suis retournée dans ma chambre et j’ai fait glisser la fenêtre en me penchant dehors le plus possible pour éviter que la fumée n’empuantisse tout. Un des fouilleurs a levé les yeux vers moi. Je l’ai ignoré.
Plusieurs clopes plus tard, ils avaient tout bien rangé les ordures dans les sacs et s’en étaient allés avec leur butin.
Il était bientôt sept heures, l’heure de me tirer avec le taxi que j’avais demandé au dueño de l'hôtel d’appeler. Quand je suis descendue il était en bas derrière son comptoir, et on a taillé le bout de gras comme deux potes en attendant ma voiture. C’est marrant comme les gérants d’hôtel se montrent curieux envers les touristes. Moi à leur place, j’en n’aurais plus rien à carrer d’entendre leurs histoires. Il a paru assez impressionné quand je lui ai décrit mes projets. Faut dire que certains sont assez couillus. A voir si j’arrive à les mettre en œuvre.
On s’est quittés en se disant qu’on se reverrait si je passais à nouveau par Bogotá. J’avais le sentiment qu’on était déjà copains, et on s’est serré la pogne avec effusion.
J’ai sauté dans le taxi pour le terminal. Un long voyage m’attendait.
10 heures de périple en bus
Le bus avait une heure de retard. J’avais oublié le manque de précision des horaires ici. Cela dit, le terminal de bus de Bogotá est plutôt accueillant, et puis je me suis payé des petits pains au fromage tout frais comme il font ici, produits sur place. C’est comme ça que je fonctionne sur la route. J’ai jamais de bouffe sur moi, parce que je sais que je pourrais mettre la main sur des trucs à picorer en chemin.
Le bus a fini par se pointer, un truc très confortable, d’autant plus qu’avec le covid y te mettent personne à côté de toi, c’est royal. La meilleure partie du voyage commençait enfin. J’étais dans mon bus, ma place préférée au monde, avec le paysage et ma solitude comme seuls compadres. J’ai fini ma nuit le temps qu’on quitte Bogotá. Quand j’ai émergé, le décor avait changé. C’était vert, et beau.
Petit à petit, la végétation est devenue plus dense, plus humide, et la nature de mes pensées a changé. Il existe un mode voyage que seuls les voyageurs solitaires connaissent. Les souvenirs d’anciennes errances remontent. Des mémoires que tu pensais perdues dans les limbes de l’esprit. Tu regardes ta vie d’une autre façon. J’imagine que d’être collé à une vitre durant dix heures d’affilée, en observant le quotidien de gens qui vivent d’une façon différente de la tienne, avec cette nature exubérante tout autour, te connecte à une zone du cerveau dont tu te sers très peu dans le monde ordinaire. C’est une contemplation qui plonge en profondeur, tout en étant très subtile. D’autres formes de pensées entrent en éclosion. Elles ne connaissent ni la peur, ni les plans futurs. Le passé apparaît comme continuant d’exister, tissant un maillage complexe qui dessine les lignes de l’avenir. Impossible de douter de soi quand on est témoin de ça. Impossible de douter du sens de son existence. J’étais ravie de me dire que durant un an, j’allais avoir accès à ça.
Je commençais à avoir un peu faim quand un vendeur est monté à bord avec son grand panier. Il m’a fait goûter un petit pain tout chaud fourré à la pâte de goyave, me disant qu’il en avait aussi au fromage. J'ai pris un sachet de chaque. C’était tellement bon ! Ça vaut vraiment le coup de faire confiance au destin pour t’envoyer la graille. Ces aliments du bord des routes sont les plus frais et les moins chers que tu puisses trouver. Avec ça, j’allais pouvoir patienter jusqu’au soir, parfait.
Le paysage était si beau… Des arbres fruitiers en pagaille, des palmiers, des bananiers, des papayers, des cacaoyers, et bon nombre des plantes que je venais de décrire dans mon inventaire des plantes maîtresses, un truc de fou ! J’ai vu le fameux Toé et le Piñon Blanco ! Les bords des routes s’égaillaient d’échoppes où on vendait du pain de yucca, des papayes, des ananas et des avocats énormes, il y avait aussi ces petites maisons typiques des endroits tropicaux, basses, colorées, avec du fer forgé aux fenêtres et des hamacs suspendus sous le porche. Ça m'a fait plaisir de retrouver tout ça.
Cela dit, le temps était quand même long, surtout parce que j’avais le dos en vrac et une méchante pointe de douleur sous l’omoplate, due à ces putains d’heures de vol et à ma fatigue générale. On a fait un arrêt dans un rade qui m’a rappelé celui où Travis se fait offrir un sandwich par un vieux au tout début du tome 1 de Borderline. C’est si étrange de retrouver les éléments qui ont inspiré mes livres. Une fois de plus, ma réalité et celle de Travis coïncident…
Il faisait déjà nuit noire quand on a finalement débarqué à Manizales. Dix heures de route dans les bottes, pour le lendemain d’une arrivée en pays étranger, même en tant que voyageuse chevronnée comme moi, c’est quand même du lourd. J’ai chopé un taxi pour qu’il m'emmène à la finca, sans me donner la peine de négocier le prix auparavant, ce qui peut être très risqué. Si tu marchandes pas direct, t’as toutes les chances au monde pour te faire enfler ta race à l’arrivée. En plus, le type s’est à moitié paumé (j’ai le chic pour me dégoter des hôtels perdus au milieu de nulle part qui ne figurent sur aucun radar). Mais en fait, il était charmant, on s’est bien marrés ensemble en cherchant la finca, et le prix qu’il m’a fait payer était de loin très inférieur à celui des deux courses précédentes (ce qui m’incite à penser que le deuxième chauffeur m’a lui aussi entubée…).
J’étais enfin arrivée dans mon paradis. Bon, vu qu’il faisait nuit, j’en ai rien vu avant le lendemain, mais les chants d’oiseaux me certifiaient que j’étais au bon endroit. J’ai avalé mon dîner en en laissant la moitié (trop crevée), pris une douche, et me suis jetée dans le grand lit de ma magnifique chambre en bois ciré.
Ce coup-ci, j’allais enfin pouvoir me relaxer.
Réveil au paradis
Imaginez une terrasse perchée à flanc de montagne, d’où partent des sentiers formés de marches en pierre, entourés de végétation. Des bananiers, des fleurs, des plants de café, et des tas d’oiseaux tous plus colorés les uns que les autres, dont le chant est une musique zen. Des nappes de brumes s'accrochent aux collines, dévoilant par moment un panorama d’un vert électrique, si dense, si profond, qu’il semble incarner une forme de vie primitive et sauvage. L’odeur, à la fois musquée et sucrée, vous pénètre comme celle d’un animal féroce, d’une beauté sans égal.
Le jour est en train de se lever. Et si les mots perfection et envoûtant ont jamais eu de sens, alors il est en train de se révéler, là, sous vos yeux.
S’éveiller dans un endroit pareil après trois jours de voyage, c’est une récompense grandiose. Le genre de cadeau qu’on se fait à soi-même, qu’on ne peut recevoir que de soi-même, en fait.
Quand la réalité rejoint le rêve, à des années-lumière de la vie ordinaire, le monde apparaît comme magique, et la volonté, les désirs de l’Homme, qui le poussent sans cesse à lutter, à se dépasser, rencontrent leur accomplissement.
Ça peut sembler stupide, voire malvenu de ressentir de la gratitude envers soi-même. Pourtant, c’est exactement ce que j’ai éprouvé. Et j’ai eu envie de remercier le monde d’être aussi beau.
La balade de la lose
Le gérant de l’hôtel (ouais, cherchez pas, je me fais toujours pote avec les gérants d’hôtel) m’a proposé qu’on aille se balader dans la montagne. Évidemment, j’étais partante. On a parcouru les sentiers de la finca, lui me montrant les arbres fruitiers qu’il avait plantés, me disant à quel point la terre était fertile ici, au point que le compost lui-même donnait naissance à des arbres sains et grands en l’espace d’une paire d'années. Du café, des goyaves, des avocats, des bananes, des papayes, des ananas… Il avait tout ici, et c’est avec ça qu’il nourrissait ses clients et les oiseaux des environs.
On a passé le portillon en bois qui menait au-delà, directement dans les collines des vaches, une merveille de verdure et d’immensité. Le panorama était à couper le souffle. On descendait en zigzag pour éviter de se ratatiner la gueule, tant le sol était humide et boueux. C’était cool de discuter le coup avec lui. C’est marrant, au début je me montre toujours un peu timide, et puis rapidement je me mets à parler librement, à jurer dans toutes les langues comme à mon habitude, et à faire rigoler celui qui m’accompagne.
Au bout d’un moment, je me suis rendue compte que j’étais en train de me faire piquer de partout. Y me semblait pourtant n’avoir vu aucun moustique dans les parages. Et puis j’ai identifié ce que c’était : des sand-flies, ou mosqueros comme on les appelle ici, sorte de petites mouches jaunes très présentes dans les lieux tropicaux, et qui, contrairement aux moustiques, piquent à toute heure du jour. Ces mouches sont ma hantise. Quand je m’occupais des singes en Bolivie, j’avais le corps littéralement défoncé par leurs morsures. Eh ben, elles étaient de retour. Mais c’est pas ça qu’allait m’empêcher de continuer à marcher.
On cheminait, on papotait, ça devait déjà faire une heure qu’on descendait la montagne quand on a franchi un petit cours d’eau, une source, comme il me l’a appris, avant de passer sur la montagne d’à côté. Les herbes avaient doublé de volume, et de hauteur. Le sol était si boueux que, sans savoir comment, mon pied a soudain glissé, j’ai fait une roulade digne d’un pro de capoeira, en m’accrochant désespérément à une touffe d’herbe bien robuste qui se trouvait là, pour atterrir un niveau plus bas (il y a plusieurs “sentiers”, on va dire, un peu comme une culture en terrasse), saine et sauve. Enfin, c’est ce que je croyais…
Après quelques nouvelles minutes de marche, je me suis aperçue que j’avais plus mon téléphone, qui se trouvait normalement dans la poche kangourou de mon sweat. Bon, OK, on s’est dit, le dueño et moi, c’est rien, y a qu’à retourner à l’endroit de la chute et basta.
Ouais. Mais c’était sans compter la hauteur de ces putains d’herbes, et la raideur de la pente. Vu la roulade que j’avais faite, le maudit portable avait pu bondir très loin, rouler tout en bas, ou plus simplement s’enfouir dans une touffe pour y rester planqué comme un petit salopard, et ce, à jamais…
On l’a cherché. Trois. Putains. D’heures. Évidemment, la première idée que le dueño a eue, c’est de m’appeler pour qu’on l’entende. Mais voilà, il n’avait pas de ligne normale, seulement WhatsApp, et moi, j’ai pas de connexion sans wifi. Il a dû appeler différents potes à lui pour que l’un d’entre eux se casse les couilles à prendre un taxi, aller en ville, puis dégote une tienda qui vendait des minutes d’appel à l’international pour pouvoir faire sonner mon putain de téléphone. Entre deux, la pluie s’était mise à tomber, et nous on devenait complètement fous à fouiller ces herbes en tous sens, à la recherche de cet engin de malheur qui m’apparaissait de plus en plus comme un fléau de la civilisation. J’ai fait au mec : Dieu sait que je déteste être le genre de gourdasse qui peut pas survivre sans son tel, mais bordel j’ai absolument tout là-dedans, et sans lui voyager serait bien plus difficile. Il comprenait parfaitement, et m’a assuré qu’on le retrouverait, quitte à faire venir des employés à lui pour qu’ils ratiboisent toute la prairie avec des machettes. Mais avec la pluie, je doutais de plus en plus qu’il soit encore en état de marche le lendemain…
Au bout de trois heures, donc, le pote a réussi à passer son appel. Mais on entendait rien, sa mère. Alors on a bougé, loin de l’endroit où j’avais chuté, prêtant l’oreille comme des malades dans l’espoir d’entendre cette fichue sonnerie annonciatrice de téléphone en vie. Et putain, je l’ai entendu, ce petit bâtard. Loin du lieu où j’étais tombée. Le dueño s’est précipité pour mettre la main dessus, posé tout tranquille qu’il était, l’air de dire : Hey les mecs, j’étais là depuis le début, moi, j’ai pas bougé ! Le pire, c’est qu’il était même pas au fond d’une touffe, il était juste… là, à nous attendre gentiment depuis le commencement de cette connerie. J'avais dû le perdre après être tombée. Incroyable.
Bref, on a enfin pu prendre la route de retour, grimpant la montagne quasiment tout droit, de la boue jusqu’aux genoux, mais j’étais si soulagée que l’effort ne m’a pas paru démesuré.
On a conclu cette idiote d’aventure avec une bière, tout mouillés, tout crasseux, mais avec le sentiment d’avoir quand même gagné quelque chose.
C’est con des fois la vie.
Se rendre au Diario Latino #2.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route : La Récap’
Tous les épisodes du Carnet de Route réunis au même endroit. Elle est pas belle la vie ?
Carnet de Route #1 : Arrivée à Lima, Pérou
Carnet de Route #2 : Lima m’emmerde
Carnet de Route #3 : Nuit solitaire dans le désert de Paracas
Carnet de Route #4 : Nazca et le Mexicain
Carnet de Route #5 : Survol des lignes de Nazca, momies de Chauchilla, oasis de Huacachina, Cerro Blanco
Carnet de Route #6 : Vague à l’âme à Arequipa
Carnet de Route #7 : Cabanaconde, le Yamil me les brise
Carnet de Route #8 : Descente de la mort dans le Canyon del Colca
Carnet de Route #9 : Les gamines qui chantent tristement, Puno, Lac Titicaca
Carnet de Route #10 : Soirée coke à Copacabana, Bolivie, Lac Titicaca
Carnet de Route #11 : Paraît que je suis timbrée
Carnet de Route #12 : Première rencontre avec l’Amazonie, Villa Tunari
Carnet de Route #13 : S’occuper d’animaux sauvages, Réserve Inti Wara Yassi
Carnet de Route #14 : Un roman écrit sur la route
Carnet de Route #15 : Mon pote l’Anglais s’en va et moi je taffe avec les singes
Carnet de Route #16 : Départ de la jungle, galère de bus, arrivée à Sucre
Carnet de Route #17 : Un anniversaire à Tupiza, western bolivien
Carnet de Route #17 : Deux Mois Et Huit Jours
Rien que d'envisager les deux putains de journées que j’allais me taper là-bas me foutait les boules. Arrivée à Potosi, je me suis dégoté une sorte de cellule monacale de un mètre sur deux, avec du plancher et un vieux matelas mou qui donnait sur une cour à l’allure sinistre. J’ai été faire un tour en ville et je me suis acheté à bouffer, du pain, des bananes, du yaourt à boire, puis je me suis cloitrée, résignée.
Un anniversaire à Tupiza, western bolivien
Les jours qui viennent de passer n’ont pas été faciles et par la force des choses, j’ai été obligée de m’adapter. Et je me rends compte que c’est exactement ce que je cherche, en fait. Être capable de réagir à l’instinct et de jongler avec des situations nouvelles, dans un environnement sans cesse changeant où j’ai aucun repère, et ainsi réveiller des forces, des capacités que j’avais pas besoin de mettre en œuvre dans la sphère sécurisée où je vivais avant. C’est pas si simple de se transformer au sein de la routine, quand on a pour seule arme un esprit ramolli par des années de jeux à répétition avec des gens qui s’y complaisent et s’y enlisent. Pas étonnant que j’étais en train de péter un câble.
Ici, les choses sont ce qu’elles sont mais y a que moi pour décider de ce que je vais en faire. Et la peur est en train de disparaître. Au final, c’est plutôt jouissif de se laisser aller dans le courant du hasard et de faire des choix en un clin d'œil. C’est un jeu qui se joue rapidement. L’esprit y possède sans doute un petit rôle, mais je pense qu’on a davantage affaire à l’instinct, à l’intuition, et encore une fois au hasard d’un choix pris sur un coup de tête parce que c’est précisément ce que requiert la situation. Une personne passe, tu vas lui causer ou non, et le futur en dépend, sans que tu saches à quoi t’attendre, ce que t’y gagnes ou ce que t’y perds. Une fois les dés lancés, le truc suit sa route et t’as plus qu’à courir derrière sans même avoir le temps de te demander si t’as pris ou non la bonne décision. Tout s’enchaîne, sans cesse t’es confronté à de nouveaux choix à prendre très vite, et quand enfin te voilà, plusieurs jours plus tard, seul et en mesure de t'interroger sur le cours des événements, tu ne peux que constater avec fascination l’imbrication inextricable du destin, et te dire que tout est à sa juste place (alors qu’au fond t’en sais rien, pas vrai ? Mais c’est l’impression que ça donne).
C’est un jeu que j’aime beaucoup. Impossible de savoir si j’y joue bien ou pas, mais je dois pas m’en tirer trop mal puisque j’adore ça. Et désormais, je refuse de juger ce que je suis en train de vivre. Je me contente de jouer avec les cartes qu’on me donne, et au fond c’était sans doute pareil dans l’autre vie. On croit avoir un pouvoir, mais on se contente de réagir tant bien que mal.
On dirait que je commence à apprendre la patience et l’acceptation. Moi ! Franchement, c’est un comble.
J’ai quitté Sucre avec mon linge tout propre et mes boutons et autres piqûres de moustique en train de cicatriser. Après deux nuits dans cet hôtel, j’avais déjà une forte envie de me tirer pour aller voir ailleurs. Je savais précisément où je voulais aller, mais avant ça je devais obligatoirement passer par une autre ville qui me disait rien, mais j’allais devoir faire avec, et plus que je l’imaginais. D’emblée, le chauffeur de taxi m’avait mise en garde : le lendemain, inutile de chercher à prendre un bus, c’était les élections, toute la ville serait enfermée chez elle à je ne sais quoi foutre (regarder la téloche ? Picoler pour le vainqueur ou le vaincu ?). OK, prends ça dans les dents. Rien que d'envisager les deux putains de journées que j’allais me taper là-bas me foutait les boules. Arrivée à Potosi, je me suis dégoté une sorte de cellule monacale de un mètre sur deux, avec du plancher et un vieux matelas mou qui donnait sur une cour à l’allure sinistre. J’ai été faire un tour en ville et je me suis acheté à bouffer, du pain, des bananes, du yaourt à boire, puis je me suis cloitrée, résignée.
J’ai lu en boucle mes guides de voyage, seules merdes que j’avais à lire, et la première journée est passée. Le soir j’ai été dans un resto végétarien et j’ai maté un bout des Monthy Python avec le patron. La deuxième journée a été encore plus hardcore, une véritable épreuve de patience pour les nerfs, mais l’idée de me barrer le jour d’après m’a aidée à tenir. Et le lendemain, enfin, je me suis levée tôt et je me suis tirée. Mais je suis quand même arrivée trop tard au terminal, les bus pour Tupiza partaient encore plus tôt. Je vous dis pas la rage. J’ai failli prendre un bus pour une autre destination qui m’arrangeait pas du tout vu les connexions, de dépit, quoi, mais Dieu soit loué c’était trop tard pour celui-là aussi. Pleine d’amertume, je me suis traînée vers un hôtel juste en face du terminal. L’idée de retourner dans cette putain de cellule de prisonnier me révoltait, mais cet hôtel-là était trop cher, j’avais pas le choix, c’est donc la mort dans l’âme que j’ai hélé un taxi et suis retournée dans mon cloître la queue entre les jambes. La patronne m’a dit que je pouvais récupérer la même piaule, qu’elle avait pas encore été nettoyée (génial…). Retour à la case départ.
Alors fuck off. Pou compenser, je me suis payé un putain de petit dej et deux bouquins, histoire de tenir le coup. Ça n’avait rien de raisonnable au vu de mon budget super ric-rac, mais parfois dans la vie faut savoir se faire plaisir, merde ! En plus j’ai découvert que je savais lire l’espagnol. J’avais fait exprès de prendre deux livres que j’avais déjà lus (L’Alchimiste et un autre de Paulo Coelho) histoire de pas être trop paumée, de pouvoir deviner les mots que je comprenais pas, et en fait j’adore lire dans cette langue ! Et j’ignore comment mais cette saloperie de journée est passée. Le lendemain j’étais tellement flippée que je me suis réveillée super en avance. La porte de la cour était fermée. J’ai dû faire tout un foin pour que la patronne se lève m’ouvrir. J’ai pris un taxi. Il était 6h du mat. J’étais toujours aussi fébrile en attendant le bus qu’avait évidemment une heure de retard, l’enculé, à fumer clope sur clope. C’était mon anif et je voulais à tout prix atteindre Tupiza le jour même, cet endroit qui me faisait rêver depuis les quelques photos que j’avais vues dans mon guide, où la terre est rouge feu et pleine de cactus.
Dans le bus, il faisait une chaleur à crever, et au début j’étais contente car la zic n’était pas trop merdique, mais je sais pas comment une autre musique a été mise par au-dessus, et c’était une abomination tonitruante, cumulé avec la chaleur, j’ai bien failli tuer quelqu’un.
Lors de la pause, j’ai entendu deux nanas parler français, alors je leur ai glissé au milieu des klaxons et des gens qui gueulaient dans la rue : Ils aiment le bruit, ici, pas vrai ? L’une d’entre elle m’a répondu : On est d’accord, c’est pas nous qui hallucinons ! Je pensais pas que ça irait plus loin, mais va savoir pourquoi quand on a débarqué je les ai collées en leur demandant où elles allaient et on a choisi un hôtel ensemble, un hôtel cher (10 euros la nuit, une dinguerie pour moi, puisque c’est mon budget journalier normalement) avec une piscine et un buffet petit dej, mais je leur ai dit que c’était mon anniversaire et que fuck.
On a papoté un peu dans la chambre en prenant nos quartiers. Les filles se sont montrées étonnées que j’aie pas profité de mon séjour à Potosi pour visiter les mines (seule attraction touristique de ce bled de merde, no comment). Elles m’ont raconté ce qu’elles avaient vu : des mecs qui triment leur race jour après jour, se défoncent à l’aguardiente après le boulot, et meurent à 40 ans des suites de toutes les saloperies qu’ils inhalent à la mine, et bien souvent à moitié aveugles à cause de cette fameuse eau-de-vie qu’ils s’envoient pour tenir. J’étais révoltée qu’on puisse envisager de considérer ça comme une “étape à ne pas manquer d’un voyage en Bolivie”, mais elles semblaient penser que leur démarche n’avaient rien de voyeuriste, que c’était au contraire une façon de soutenir ces hommes… Ces hommes qui sont heureux de mourir jeunes parce que leur famille, veuve et enfants, toucheront une pension à vie pour leur sacrifice. Je crois que je préfère ne rien dire à ce sujet.
C’est à la piscine qu’on a croisé l’Allemand. De loin, je l’ai pris pour un sportif prétentiard avec son ventre musclé et ses lunettes de soleil. Il s’est aperçu qu’on causait français et s’est approché pour faire connaissance. Il vit en France, en fait, vraiment pas loin de chez moi, et il a un tel débit de paroles que très vite on a été au courant de toute sa life. Ce mec a débuté son trip au Canada. Il fait tout à vélo. Il a taffé un moment en Floride, à Key West, à réparer des bateaux, histoire de refaire du fric pour poursuivre le voyage jusqu’ici, et il projette d’aller jusqu'en Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine. Il était cool alors on s’est mis d’accord pour tous se retrouver le soir au resto. Ça a été une putain de soirée. Pizzas, bières, clip de Michael Jackson à la télé (trop de la chance, je suis fan !), et une putain d’ambiance. Une soirée d’anniversaire dont je me souviendrai toute ma vie !
Et vous savez quoi ? Aujourd’hui, à l’aube d’un nouveau jour, avec cette terre rouge splendide incendiée par le soleil que j’observe depuis la fenêtre, je me dis que tous ces contre-temps n’avaient en réalité pas d’autre but que de me faire arriver ici au moment parfait. C’est ça, que moi j’appelle le destin.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #16 : Deux Mois et Quatre Jours
Et je regarde en arrière, ce mois de dingue que je viens de vivre en Amazonie en pleine saison des pluies, à m’occuper d’animaux sauvages comme dans mes rêves de gosse, et tout ce qui m’est arrivé depuis seulement deux mois que je suis partie, et je me demande pourquoi j’ai tant de chance, est-ce qu’il y a quelqu’un là-haut, une force quelconque qui se démène pour que ma vie coïncide enfin avec ce que j’ai toujours voulu qu’elle soit ?
Départ de la jungle, galère de bus, arrivée à Sucre
Ça a été la misère pour quitter cette putain de jungle. Et Dieu sait qu’il était temps de se tailler. Y avait plus d’eau à Vegas depuis une semaine, à cause de la pluie torrentielle qu’avait fait péter une canalisation, et les moyens qu’on trouvait pour se laver étaient de plus en plus désespérés.
J’ai d’abord fait comme pas mal des villageois qui ne doivent pas disposer de douche, et je suis partie avec mon maillot de bain et ma serviette à la cascade où un torrent d’eau plus ou moins propre te décape le scalp gratos, en compagnie d’une demi-douzaine de locaux lavant leur gosses et leur linge et se foutant pas mal que l’eau pleine d’Omo aille direct dans la rivière (dans laquelle nous on balançait la merde des singes et la javel, d’ailleurs. Vive la contamination !).
Un soir il flottait tellement fort que j’avais pas la moindre envie de me traîner à la cascade, alors j’ai carrément pris une douche sous la pluie, postée sous une gouttière (ou plutôt un trou du toit) de Vegas. Et le dernier jour, il pleuvait pas mais j’avais la flemme alors j’ai pris un seau qui traînait dans la cours, plein d’eau de pluie, et me le suis vidé sur la tronche. Ouais, j’en étais là. C’était mieux que rien, et même franchement indispensable après le genre de journée que je me tapais, à charrier des seaux de fruits à travers la jungle, nettoyer la merde et me faire pisser dessus à longueur de temps par Danielito, en transpirant toute la journée.
En plus, impossible de faire sa lessive (pas d’eau) et à force c’était hardcore de remettre constamment la même chemise imbibée de pisse et imprégnée de merde, encore humide de la veille et de la pluie de la nuit. Ma peau commençait à présenter des signes de réactions épidermiques bizarres, à me démanger, à boutonner, mais la cause pourrait être n’importe quoi, de toute façon l’environnement entier dans lequel j’étais plongée était une aberration totale à l'hygiène de soi. Des tas de volontaires avaient chopé des parasites intestinaux super coriaces et se gavaient d’antibios, et à vrai dire je m’en tirais pas trop mal avec mes piqûres de moustiques et de sand-flies et mon espèce d’eczéma.
Ça sentait la fin, et j’étais heureuse de repartir. J’ai été dire au revoir aux singes et aux tejones avec une drôle de boule dans la gorge, triste à l’idée que la majorité de ces petits gars allaient poursuivre leur vie dans une cage à cause de la connerie des Hommes…
Certes, au départ, mon projet était de partir vers l’est et de continuer dans la jungle, vers un bled qui me tentait énormément, mais j’ai attendu trois plombes un bus qu’est jamais venu pour aller dans cette direction (plus tard j’ai compris qu’il était bloqué en amont). J’étais en nage, pour changer, plantée comme un navet au bord de cette route, et la pluie recommençait à tomber, alors je me suis dit : Eh merde, j’en ai plein le cul ! et j’ai traversé la route. En moins de deux, j’étais dans un minibus partant pour l’endroit opposé, d'où j’étais arrivée un mois plus tôt et où je voulais à priori pas refoutre les pieds (je déteste revenir sur mes pas, ça me donne le sentiment de ne pas avancer), mais fallait s'adapter et fallait surtout que je me tire. C’est vrai, quand j’ai décidé de me barrer, faut juste que je me barre, je peux pas attendre trois heures qu’un putain de bus daigne ramener ses fesses. En plus tous les gens à qui je demandais m’ont filé des réponses différentes, donc c’était hors de question que je poireaute en attendant un bus hypothétique.
Donc OK, je prends le minibus et arrivée au terminal de Cochabamba illico je décide d’enchaîner direction Sucre. Un premier bus, et ensuite un deuxième, de nuit. On roulait pas depuis une demi-heure qu’on a été forcés de s'arrêter. Et là je me suis rappelée que cette satanée route était tout le temps inondée, effondrée ou je ne sais quoi (j’avais entendu des mecs du refuge raconter qu’ils avaient galéré 5 à 10 heures, sans déconner, le temps que ça se débloque, et arriver en pleine jungle à 4h du mat, sympa comme délire), et je me suis dit : Eh remeeeeeeerde, je vais jamais arriver à quitter cette foutue jungle !
Le premier arrêt a duré une trentaine minutes, et les deux ou trois fois d’après un peu moins, et putain on y est arrivés. Je crois que j’ai eu du bol encore une fois. Débarquée au terminal, je me suis fait agrafer par un mec qui voulait de toutes forces me vendre un billet. Moi je demandais : C’est combien ? et il me répondait pas et était déjà en train d’écrire sur le papelard, et moi je répète : Combien c’est ? (ho, ça va de se faire entuber). Il finit par me dire le prix, alors je me casse. Faudrait voir à arrêter de me prendre pour un con. Deux secondes après, j'ai trouvé une autre compagnie qui vendait des billets bien moins chers. Merde à la fin.
J’avais rien bouffé de la journée, mais dans mon larfeuille j’avais qu’un billet de cinquante et une pièce de un, et je savais d’expérience qu’il était inutile de tenter d’acheter un petit truc avec le bifton parce qu’ils ont jamais de monnaie dans ce pays, et d’un autre côté je crevais d'envie de pisser et ça coûtait précisément un sol. Dilemme. J’ai acheté un petit pain avec cette pièce mais en fait j’avais toujours autant envie de pisser, et dix heures de transports, ça allait être rude, jamais je tiendrais toute la nuit. J’allais pas pouvoir dormir. Dehors y avait des gens partout, impossible de s’isoler derrière un bus ou quoi. Alors j’ai accosté un vieux et je lui ai dit : C’est stupide mais tu sais pas où je pourrais trouver un coin pour pisser ? J’ai plus de pièces et à l’intérieur ils veulent absolument pas que je paie avec mon billet.
Il m’a regardée avec un air mi-consterné mi-compréhensif (je sais c’est dur de se représenter mais c’est bien ça) et il m’a filé une pièce. Cool. Je l’ai balancée à la dame pipi qui m’avait jetée deux minutes plus tôt et au vu des litres que j’ai évacués c’était pas du luxe. Je suis ressortie de là, j’ai fumé deux clopes à la chaîne histoire de tenir les dix heures du trajet, et j’ai grimpé dans le bus, heureuse et soulagée avec ma vessie vide, ma nicotine dans le sang et mon bout de pain dans l’estomac.
La route était super cahoteuse et c’était franchement dur de pioncer. Je me retournais d’un côté et de l’autre. A un moment j’ai eu conscience que le bus était arrêté et je me suis vaguement demandé si c’était normal ou si c’était encore un blocage mais en fait c’était mieux pour tenter de dormir alors je suis repartie en somnolence, mais quand j’ai rouvert les yeux le bus était toujours à l’arrêt. J’ai regardé ma montre, il était 6h du mat, heure à laquelle on était censés arriver. Quoique ça m’arrangeait, ça me faisait chier d’arriver trop tôt dans une ville endormie avec ma gueule de gringa. Quand je me suis à nouveau réveillée, il était 8h. Toujours pas bougé. Ils nous ont fait descendre le temps que le bus et les autres qui étaient devant empruntent un détour moins boueux, et on est remontés. Enfin.
C’est ma deuxième nuit dans cette ville, qui est très mignonne, dans un hôtel à mille lieux de Vegas. Tout est sec, propre et douillet. Même mon vieux linge ramené de la jungle, encore plein de pisse et de merde, que j’ai fourgué à la laverie du coin (j’ai eu peur que la meuf refuse mon sac. Avant de l’amener, je me suis rendue compte qu’il était était gavé de fourmis) sent maintenant si bon que j’arrive pas à le croire.
Merde, que demander de plus ? Et je regarde en arrière, ce mois de dingue que je viens de vivre en Amazonie en pleine saison des pluies, à m’occuper d’animaux sauvages comme dans mes rêves de gosse, et tout ce qui m’est arrivé depuis seulement deux mois que je suis partie, et je me demande pourquoi j’ai tant de chance, est-ce qu’il y a quelqu’un là-haut, une force quelconque qui se démène pour que ma vie coïncide enfin avec ce que j’ai toujours voulu qu’elle soit ? Cette liberté, cette indépendance à faire pâlir d’envie tous les jeunes de cette foutue planète, cette audace folle avec laquelle je tiens les rênes de mon destin, je peux les sentir dans mon corps et dans mon esprit, comme une puissance qui n’appartient qu’à moi, dont je peux disposer selon tous mes caprices…
Et pourtant, il y a quelque chose, en sourdine, qui ne cesse de me rappeler que tout ce que je fais, tout ce que je pense, n’est en réalité que la transformation en acte et en pensée d’un chemin tracé pour moi, qui me préexiste, auquel je me livre tout entière parce que je sais que je suis au bon endroit, au bon moment.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Dans le sac d’une Desperada : La Check-list de la Liberté
Tout lâcher, partir sur les routes du monde pour plusieurs mois, n’emporter avec soi que le strict nécessaire, être légère, libre, dire adieu aux verbes avoir et posséder pour les remplacer par être et expérimenter… Se défaire de l’inutile, de tout ce qui encombre le corps et l’esprit pour s’immerger dans le vécu. Ouais, ça fait rêver sur le papier, mais en pratique, c’est pas si facile à organiser, et c’est une grande voyageuse qui te le dit…
Tout lâcher, partir sur les routes du monde pour plusieurs mois, n’emporter avec soi que le strict nécessaire, être légère, libre, dire adieu aux verbes avoir et posséder pour les remplacer par être et expérimenter…
Se défaire de l’inutile, de tout ce qui encombre le corps et l’esprit pour s’immerger dans le vécu.
Ouais, ça fait rêver sur le papier, mais en pratique, c’est pas si facile à organiser, et c’est une grande voyageuse qui te le dit.
J’ai mis des années à roder mon sac à dos, à partir avec toujours trop, à enrager d’avoir à porter toutes ces choses dont je ne croyais pas pouvoir me passer. Et c’est au fil du temps que j’ai appris à n’emporter avec moi que l’essentiel, c’est-à-dire, ce que je suis absolument sûre d’utiliser.
C’est marrant, mais c’est justement le fait d'être une voyageuse au long cours qui m’a menée au minimalisme, dans ma vie de tous les jours, et encore plus en road trip.
Et tu sais quoi ? Quand t’as goûté à cette sorte de liberté, t’as plus la moindre envie de revenir en arrière.
Le minimalisme, c’est valoriser l'expérience au lieu de la consommation.
Se détacher du matériel, séparer le besoin de l’envie, se défaire du superflu. C’est claquer son fric pour du vécu, des expériences qui marquent à jamais, plutôt que des objets qui n’apportent aucune satisfaction durable. C’est garder en tête que si on part, loin, longtemps, c’est pour vivre et se sentir vivante, grandir et évoluer en s’adaptant, rester ouverte aux imprévus plutôt que d’être une psychopathe qui envisage toutes les situations à l’avance en farcissant son pauvre sac de trucs débiles “juste au cas où”.
Le minimalisme, c’est revenir à l’essentiel de l’humain, et transformer sa vision et surtout son expérience du bonheur.
Cet article va t’apprendre à préparer le sac à dos parfait pour un voyage en mode backpacker, dans n’importe quel pays du monde, qu’il dure quelques mois ou plusieurs années. Tu tiens ici la liste ultime de la vagabonde indépendante et libre, prête à fouler les chemins de la planète sans rien ni personne pour entraver son rêve en train de prendre vie, droit devant elle…
T’es prête, la desperada ?
Voilà ce que tu vas trouver dans la Check-list Parfaite de la Voyageuse Minimaliste :
Trousse de toilette spéciale baroudeuse écolo
Kit de survie de la warrior
Fringues de sauvageonne minimaliste
Équipement de base de la voyageuse aguerrie
Pharmacie no stress de la fille cool
Appareils numériques light
Camping et Trek bien réfléchis
Voyager avec son Âme, sa Chatte et son Couteau
(cette liste peut aussi convenir aux hommes, il leur suffira de retirer deux ou trois petits trucs)
Pour info, seuls les liens Amazon sont affiliés. Si tu passes par eux pour te procurer les articles vraiment cool que je te conseille, bah moi, ça m’aide à fond. A repartir en voyage, à amortir les frais de mon blog, et à publier mes livres, par exemple. Et ce, sans te coûter un centime supplémentaire. Alors n’hésite pas à cliquer.
D’autre part, tous les produits recommandés ici, je les ai testés en condition réelle, on ne me paye pas pour en faire la pub. Tu vas découvrir des sites bio et zéro déchet, des trucs Décathlon vraiment pas chers, et du matos de qualité qui te servira aussi dans la vie quotidienne.
Trousse de Toilette Spéciale Baroudeuse Écolo
On va pas se la jouer.
Quand on est une meuf, la trousse de toilette peut facilement devenir le pire fléau d’un trip, celui qui transforme ton sac en âne mort et ton dos en charpie.
Ouais, parce que c’est bien bon, de voyager, mais c’est-à-dire qu’on a envie d'être jolie quand même, aussi freestyle qu’on se prétende. Si par hasard on croisait la route d’un cowboy solitaire, on aimerait autant éviter de le faire fuir, quoi…
Mais laisse-moi te dire une chose, cocotte : y a carrément moyen d'être clean et belle sans se coltiner trois tonnes de produits de beauté. Si si.
Et au-delà de la légèreté de la liste qui suit, sa qualité essentielle est qu’elle se compose en majorité de produits zéro déchet, qui ne pourriront pas la nature si tu te laves dans une rivière en pleine jungle et ne généreront presque aucun déchet plastique.
Si tu voyages pour voir les beautés du monde, c’est pas pour le bousiller derrière avec ton gel douche crado et ton shampoing plein de silicone, pas vrai ?
L’avantage des produits qui entrent dans ma trousse de toilette spéciale baroudeuse écolo, c’est qu’ils sont solides, sans emballage, et qu’ils durent bien plus longtemps que la moyenne.
Avec eux, tu vas réduire drastiquement le poids de ton sac à dos, ton impact environnemental, et les merdes que tu te fous sur la tronche.
Visualise…
Une desperada super badass, qui se lave à la rude avec un bon vieux savon, se soigne aux huiles essentielles, se fond dans la nature comme une jolie sauvage, et sourit crânement aux pauvres filles bien synthétiques qui se traînent un sac à dos de la mort juste pour… rien, en fait.
C’est parti !
Savon de Marseille : Le vrai de vrai, à l’huile d’olive, fabriqué en France. Tu le coupes en trois, tu le mets dans une petite boite en métal, et t’es propre pour pas un rond, et ton linge aussi (ouais, y a rien de mieux pour laver les fringues, en plus).
Shampoing solide : Ça te fait des cheveux de ouf grâce aux poudres de plantes ayurvédiques, sans plastique ni dedans et ni dehors.
Brosse à dents en bambou Ecobamboo : Plus légère qu’une brosse en plastique, et carrément plus écolo quand tu la jettes.
Dentifrice solide Pachamamaï : Pourquoi transporter un gros tube de pâte alors que ce petit galet dure super longtemps, te fait les dents clean pareil et pèse que dalle, hein ?
Déodorant solide Pachamamaï : Adieu l’aluminium, celui-ci fonctionne très bien, et dure des mois.
Crème désaltérante Aroma-zone (ou n’importe quelle crème bio, en fait) : Celle-ci a l’avantage d'être très efficace avec juste une pression, sous n’importe quel climat (froid intense ou chaleur extrême) et la contenance du flacon t’assure plusieurs mois de tranquillité.
Baume à lèvres Aroma-zone : Très réparateur, sent super bon, dure longtemps malgré sa petite taille.
Huile essentielle Tea Tree et Lavande Aspic : Inutile d’embarquer cinq flacons d’huile essentielle pour parer à tous les maux, celles-ci sont multi-usage, et suffisent à soigner boutons, coupures, piqûres de moustique, coup de soleil, maux de gorge...
Brosse à cheveux Tek : Petite et légère.
Coupe menstruelle : C’est le moment de l’adopter, tu la vides deux fois par jour, pas de fuite, pas de déchets, pas d’achat de tampons.
Rasoir et lames de rechange : Un tout petit modèle.
Pince à épiler.
Coupe-ongles.
Optionnel :
Lingettes : Pas écolo mais ça dépanne, faut avouer !
Eyeliner et rouge à lèvres : Moi je prends, parce que j’aime être sexy même en plein désert.
Crème solaire et lotion anti-moustiques : A toi de voir. Sache quand même que les produits anti-moustiques vendus sur place seront toujours plus efficaces que les trucs français. Et perso, je mets pas de crème solaire.
Kit de Survie de la Warrior
L’aventurière qui se respecte doit être équipée pour l’indépendance et le mode survivor.
Et ça, ça passe par un petit équipement de base solide et sûr. Si tu veux rouler ta bosse de travelleuse hors des sentiers battus, dans des conditions parfois un peu hard, tu dois être en mesure d’assurer ta sécurité et dans une certaine mesure, ton confort.
L’idée n’est toujours pas de se charger d’un tas de gadgets soi-disant ingénieux dont tu ne te serviras à l’évidence jamais, style chargeur à énergie solaire, couteau-suisse de la mort (à quoi peut bien servir cette putain de pince ?!), ou encore loupe pour faire du feu, mais bien de faire le point sur le matos de base véritablement utile, auquel tu auras recours dans de nombreuses situations.
Avec la liste du kit de survie de la warrior, tu vas faire des économies et tu seras parée pour l’aventure !
Gourde Bambaw : Légère, en acier inoxydable, la plus économique du marché. Tu la remplis le matin à l’hôtel, tu fous une pastille de micropur dedans, t’attends une demi-heure, et tu peux boire n’importe quelle eau, sans acheter de bouteilles plastique. Mais le chlore du micropur, beurk ? Ouais, sauf que dans beaucoup de pays du monde, l’eau en bouteille que t’achètes n’est pas de l’eau de source, mais de l’eau purifiée. Donc ça revient au même, sauf que tu produis pas de déchet, et que t’es pas dépendante des magasins. Tu prépares ta gourde comme une grande et t’es tranquille pour la journée.
Serviette microfibre Décathlon : Ne pèse rien, sèche même pliée, et en très peu de temps.
Couteau Leatherman : Une marque sûre. Compact et maniable, tu gardes ce schlass toujours sur toi dans la poche de ton jean, et si un connard montre un quelconque signe de folie, tu le plantes.
Corde à linge : Pour faire sécher tes fringues lavées à la main, dans ta piaule à l’hôtel, en camping, ou en pleine nature.
Frontale Décathlon : Coûte que dalle, dure longtemps, indispensable dans beaucoup de situations.
Cadenas : Pour protéger ta piaule si tu débarques dans un hôtel pourri dont les portes ne ferment pas, ou encore ton casier dans un dortoir.
Guide Lonely Planet en broché : En broché, oui, pas en e-book. Seule entorse à la règle du poids, pour avoir testé les deux, fais-moi confiance, le vrai livre est indispensable. Plus facile à annoter, à feuilleter, et les cartes sont plus grandes et claires, ce qui s’avère extrêmement précieux pour tracer et visualiser ton itinéraire. D’une manière générale, oublie le Routard et autre Petit Futé. Les guides Lonely Planet sont des tueries. Ultra-documentés sur les hôtels (pour tous les budgets, même vraiment ric-rac), les restos, les prix des taxis, les horaires de bus, les parcs nationaux, les choses à faire et à voir, les climats des pays selon l’époque, les papiers utiles, la pharmacie, les maladies, la monnaie locale, les possibilités de parcours selon le temps que t’as devant toi, même hors des sentiers battus… Avec eux, tu peux pas te sentir perdue, même en voyageant seule.
Adaptateur prise universel : Oui, penses-y. Les systèmes électriques varient selon les pays.
Clé USB : Pour décharger tes cartes mémoires des photos, par exemple.
Carte de crédit N26 : Une banque en ligne allemande “spécial voyageur” avec plein d’avantages, même si elle coûte un peu cher chaque mois : tu peux payer avec sans frais, retirer du fric à frais réduit, t’as une assurance annulation de vol, rapatriement et compagnie pendant les trois premiers mois de ton voyage, l’application est parfaite pour checker tout de suite tes dépenses, tu peux changer le code, si on te la vole et retire du fric sur ton compte t’es assurée… Bref, tu m’as comprise.
Fourchette-cuillère 2 en 1 : Bien utile pour éviter les couverts en plastique et surtout manger ce que t’achètes au marché.
Briquet : En tant que fumeuse j’ai toujours le mien mais je précise pour les autres.
Ceinture cache pognon : Vraiment cool. Dis-toi que si tu voyages hors des sentiers battus, tu vas te balader avec beaucoup de cash sur toi, parce que tu vas faire le plein dans les grandes villes avant d’aller dans des petits villages perdus où y a pas d’ATM, et où, évidemment, les hôtels et restos ne prennent pas la carte. Donc tu plies tes billets en languettes et tu les planques dans la poche à fermeture éclair dissimulée dans la face cachée de la ceinture. Et surtout, en cas de vol de ton sac ou de ton porte-monnaie, t’as une petite réserve pour survivre et te payer un bus jusqu’à l’Ambassade ou un taxi jusqu’au commissariat. Perso, je laisse toujours au moins 100$ dedans.
Kindle ou Liseuse : Comme ça t’as toujours de quoi lire sur toi et tu peux même t’acheter des nouveaux livres avec une simple connexion wifi.
Permis de conduire international : Ça peut servir si tu comptes louer une caisse. C’est gratuit, faut juste faire la demande à ta mairie.
Carnet de vaccination : Même si on te le demande jamais, en fait, mais dans le doute, c’est pas ça qui pèse lourd. Les vaccins ne sont pas obligatoires, sauf la fièvre jaune pour le Brésil, alors à toi de voir.
Une boite de capotes !
Fringues de Sauvageonne Minimaliste
Ouais, là, on va rigoler. Mais t’es une vraie desperada ou pas ?
On a toujours tendance à embarquer trop de vêtements, histoire de parer à toute situation…
Mais il se passe un truc marrant quand on trace la route pendant un moment : petit à petit, on réalise qu’on s’en balance de remettre encore et encore le même T-shirt et le même jean, et à vrai dire on se sent de plus en plus à l’aise dans son uniforme de voyageuse à l’arrache.
Comme dirait Tyler Durden, mon héros minimaliste, tes fringues retrouvent leur fonction primaire : du tissu qui te protège, et basta. Tu t’aperçois que t’es toujours toi-même (et même peut-être pire que toi-même) sans tes habits de poupée censés te définir. T’en as plus rien à foutre, en fait.
T’es là pour vivre, pas pour paraître.
Alors résiste à l’envie de prendre des trucs en rab au cas où. Enfile ton jean, ton débardeur et tes pompes de guerrière, coche la check-list de la sauvageonne minimaliste et deviens une véritable badgirl qui se fond dans le paysage. Souviens-toi que tu n’es pas tes vêtements, définitivement.
1 jean : Quand tu le laves (pas trop souvent, garde la poussière, c’est plus cool) tu mets le legging.
1 short : Pour la plage et les climats hot. Évite de te balader avec en ville, joue pas les allumeuses, tu t'éviteras pas mal d’ennuis.
1 legging ou pantalon fluide : Pour être à l’aise à l’hôtel et éviter les moustiques dans la jungle.
2 débardeurs : Ça suffit. En coton, un peu lâches, tu schlingueras moins.
1 T-shirt : Le doudou que t’adores, c’est celui-là qu’il faut prendre.
1 polaire près du corps : Ça réchauffe bien.
1 gros polaire à fermeture éclair ou 1 sweat large à capuche, à foutre au-dessus du premier polaire : Pas besoin de manteau avec ça. Si t’as froid, l’idée est d’empiler les couches. Débardeur, T-shirt, premier polaire, second polaire, K-way… Ça fonctionne, tu verras.
1 K-way : Oui, même si tu pars pour les Tropiques. Ça flotte sa race, là-bas.
1 chemise : Utile pour dissuader les moustiques de te piquer ou éviter les coups de soleil, sans que ça tienne trop chaud.
3 paires de chaussettes : Ça suffit. Non, t’en changes pas tous les jours, t’es une desperada ou une chochotte ?
10 culottes : Oui alors là, comparé à beaucoup de minimalistes qui préconisent de n’en prendre que deux (une sur toi et l’autre lavée qui sèche), je dis non. Prends au moins une semaine de culottes d’avance. Tu vas voir, en pleine Amazonie, si l’unique autre culotte que t’as va sécher si vite, avec l’humidité ambiante. Et puis tu pars pas non plus pour faire ta lessive tous les jours et repartir avec du linge mouillé dans le sac. Nope. Tu feras ton linge tous les dix jours, dans un lieu qui s’y prête, où il fait chaud et sec de préférence. Et de temps en temps à la laverie, quand toutes tes fringues ont besoin d’un récurage intensif.
1 soutif : Un petit truc léger sans rembourrage, qui sèche tout seul.
1 brassière : Pour le cheval ou les treks.
1 paire de Havaïanas : Indispensable pour se laver dans les douches crados sans choper une mycose des orteils et traverser des rivières avec des cailloux qui piquent au fond.
1 paire de Birkenstock : Meilleure marque de sandales au monde, encensée par tous les voyageurs ! Solides, durables, confortables, tu vas les surkiffer, tes birk !
1 paire de chaussures de rando : J’aime bien les Salomon, surtout ce nouveau modèle. Elles sont un peu chères, mais le confort, la résistance et l’étanchéité sont garantis avec cette marque, et quand t’es partie pour un trek en pleine jungle, crois-moi, ça mérite l’investissement ! Prends-les pas trop montantes, c’est celles que tu vas mettre la majorité du temps, tu dois te sentir très à l’aise avec.
1 maillot de bain : Ou pas, on peut aussi se baigner en culotte noire.
1 Paréo : Plus léger qu’une serviette de plage, et puis tu fous pas du sable sur ta serviette de toilette comme ça.
1 casquette ou 1 chapeau : Que ce soit dans la jungle, le désert ou encore en haute altitude, un couvre-chef est bien souvent indispensable pour éviter l’insolation.
Équipement de Base de la Voyageuse Aguerrie
Après moult voyages et différents essais de sacs (comme tout le monde, j’ai commencé par le ridicule 80 litres qui pesait 18 kilos, carrément suicidaire, avant de parvenir à faire baisser la taille et le poids sur mon dos jusqu’à atteindre le 40 litres pour 8 kilos), j’ai fini par trouver LE SAC A DOS IDÉAL qui convient au trip au long cours que je pratique, et les astuces pour l’organiser de la façon la plus optimale possible.
L’idée sur laquelle tous les baroudeurs chevronnés se retrouvent est celle-ci : plus tu prends un gros sac, plus tu vas le remplir.
Et en voilà une autre : plus tu pars longtemps, moins tu prends d’affaires, parce que tu vas les laver ou les renouveler sur place.
Si tu vises de voyager léger avec moins de 10 kilos sur le cul, alors oublie ce fichu sac de 80 litres qui te fait de l'œil, et que tu te figures être celui des “vraies travelleuses”.
Nan, sans dec, oublie-le.
Déjà parce qu’il pèse en lui-même super lourd, ensuite parce qu’il coûte over cher, et enfin parce que c’est tout bonnement inutile.
Beaucoup de minimalistes aiment l’idée de prendre un sac qui passe en cabine, pour éviter la soute (plus rapide de repartir de l’aéroport, pas de risque de perte de bagages…).
Oui. Mais.
Si tu veux ton rasoir et ton couteau, bah t’es forcée de le mettre en soute, ton sac. Autrement ces enfoirés de l’avion te prennent pour une putain de terroriste. Et tu le prends, ton couteau, on discute pas. Je t’épargne la bombe lacrymo et le sifflet anti-viol, mais pas le schlass. Et pareil pour le rasoir. Hors de question d’acheter des merdes en plastique jetables sur place.
Donc on y va pour l’équipement de base de la voyageuse aguerrie :
Sac à dos Forclaz 40 litres Décathlon : Il est noir, il a pile-poil la bonne taille, il s’ouvre comme une valise pour éviter le boxon, il est confortable, il est pas cher, il est solide. Et il est livré avec sa housse de protection imperméable pour le protéger de la pluie et de la crasse des soutes d’avion ou de bus. Je te fais un dessin ?
Sacs organisateurs de voyage : Alors ça c’est une découverte que j’ai faite y a quelques années et dont je ne peux plus me passer ! Ces petits sacs en tissu de forme rectangulaire permettent d’organiser tes fringues facilement et de les ranger dans ton sac à dos sans que ce soit le bordel.
Petites trousses imperméables : Servent pour ranger tous les petits éléments : passeport, chargeurs et cartes mémoires, produits de toilette, médocs…
Petit sac léger et pliable : Indispensable. C’est celui que tu vas garder sur toi tout le temps, devant, comme un bébé kangourou, tandis que le gros sera derrière sur ton dos. Ce petit sac, tu mets tes objets de valeur dedans, appareil photo, fric, ordi, mais aussi guide de voyage et liseuse, parce que lui, tu l'abandonnes jamais. Quand tu prends un bus ou un avion, c’est le gros qui part en soute, surtout pas celui-là. Et ne le perds jamais de vue. Ne le mets pas dans les filets au-dessus des sièges du bus. Enroule-toi autour de lui si tu pionces durant le trajet. Et sache qu’il te servira aussi durant un trek. Les hôtels acceptent souvent de garder ton gros sac dans leur consigne si tu réserves une nuit à ton retour, et toi tu pars crapahuter avec juste le nécessaire dans ton petit sac tout léger.
Pharmacie No Stress de la Fille Cool
Je ne vais pas m’étendre indéfiniment sur la question des médocs.
Je me contenterai de dire que si tu suis les conseils des guides de voyage ou des toubibs, tu vas partir avec une trousse à pharmacie énorme et tu te serviras à peine de la moitié.
D’autre part, sache que dans beaucoup de pays, tu peux acheter les médicaments selon tes besoins, presque à l’unité, c’est-à-dire pas la boite entière comme chez nous, mais selon la durée de ton traitement. Et à un prix bien plus économique.
Et puis, il suffit de connaitre quelques bons remèdes naturels qui ont fait leurs preuves pour venir à bout des possibles désagréments que tu pourrais rencontrer sur place, style turista, parasites intestinaux et piqûres de moustiques.
Mais ça peut avoir un côté rassurant de se dire qu’on a ce qu’y faut sur soi, sans avoir à courir chez le médecin en cas de pépin. Un antibiotique à large spectre, par exemple, peut sauver la vie en cas de blessure grave si t’es perdue en pleine jungle…
Mais en vrai, tu crois que ça va t’arriver, ça ? Non.
Mais je ne suis pas docteur. Il est évident que si tu pars pour ton premier trip, tu seras tentée d’emporter avec toi tout ce qu’il faut pour parer à tous les maux de la Terre. Alors à toi de faire tes choix.
Dans cette pharmacie no stress de la fille cool, je te propose juste mes indispensables à moi, des choses auxquelles t’aurais pas forcément pensé, mais que ma pratique du terrain m’a apprises.
Pour le reste, check ton guide de voyage selon ta destination, demande conseil à ton doc, et avise.
Charbon actif : Un remède entièrement naturel pour venir rapidement à bout des problèmes digestifs et intestinaux, les intoxications de toutes sortes, et qui dézingue même les parasites les plus coriaces !
Argile verte : Parfaitement efficace contre la turista, inutile de chercher plus loin. Et puis tu peux t’en servir pour te faire un petit masque de beauté de temps à autre, et même soulager une entorse…
Antiallergique bilastine : Ça me sauve la vie quand je suis dévorée par les moustiques. Je ne suis pas le traitement complet. Je prends juste un cachet quand mes piqûres me démangent trop et recouvrent tout mon corps. Un cachet, et les boutons dégonflent, ça me gratte plus, ça passe. Je les économise, et n’en prends un que quand ça devient vraiment insupportable.
Paracétamol : Pour le mal de tronche ou la fièvre, c’est quand même important.
Les fameuses huiles essentielles de Tea Tree et Lavande Aspic conseillées plus haut, qui servent de désinfectant, cicatrisant, et possèdent des propriétés antibiotiques.
Sachet unique d’antibios pour infection urinaire : Dans les pays chaud et humide, c’est fréquent d’en choper une si l’hygiène est pas top et qu’on s’hydrate pas correctement. Et perso, ça me rend dingue. Je trouve ça invivable. Alors quand une cystite s’annonce, je prends le sachet, et c’est réglé.
Micropur, en pagaille : Un tout petit cachet à dissoudre dans l’eau, et tu peux BOIRE partout.
Appareils Numériques Light
Bon, pour ce qui concerne la high-tech, j’imagine que t’es déjà équipée et que tu te passeras de mes conseils.
Certains se contentent de leur smartphone pour tout, et il est vrai que de nos jours, ceux-ci font d’excellentes photos, permettent de surfer sur internet tranquille, d’écouter de la zic et compagnie.
Du coup, si tu comptes pas taffer sur place en mode digital nomad, je ne peux que t’inciter à ne prendre que ton smartphone.
Personnellement, je préfère avoir mon appareil photo Canon compact parce que j’ai besoin de clichés de qualité élevée pour mon blog (j’embarque toujours deux batteries pour pouvoir assurer).
J’ai aussi plein de cartes mémoires d’une très bonne marque, Sandisk (les autres se ruinent dans les climats hard, trop froids, trop chauds, trop humides, et tu perds tout, ça m’est arrivé, c’est affreux), de 32GB, ce qui m’évite de me limiter ou de me prendre la tête sur le stockage. Je mitraille à fond et je fais le tri une fois rentrée.
J’emmène aussi un PC portable très léger (non, pas un MacBook Air), un Asus pas cher qui pèse un kilo, pas plus, avec une bonne housse et basta. Mais c’est parce qu’en tant qu’écrivain, je travaille sur place. Si ce n’est pas ton cas, tu pourras très certainement t’en passer.
Avoir un ordi sur soi est toujours générateur de stress : peur qu’on te le chourre, peur qu’il s’abime, davantage de poids dans le petit sac que tu portes devant toi…
Bref, réfléchis bien à la question, et encore une fois, ne prends que l’essentiel.
Camping et Trek bien réfléchis
Selon le type de voyage que tu prévois, tu vas aussi peut-être avoir besoin d'équipement de camping.
Sache que tu peux toujours louer ce dont t’as besoin pour un trek sur place, à moindre coût, ce qui t’évite de trimballer une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, un réchaud et des gamelles en permanence.
La vérité, c’est que peu importe combien light et compact peut se prétendre ce matos, il sera toujours lourd et encombrant, et te contraindra à prendre un sac plus grand, que tu te sentiras obligée de remplir de trucs “au cas où” jusqu’à l’escalade des fameux 18 kilos !
Mais voilà… Pour mon premier trip par exemple, j’ai décidé sur un coup de tête de me taper toute l’Argentine du nord au sud, mais j’ignorais que les tarifs des hôtels seraient bien plus élevés là-bas qu’au Pérou ou en Bolivie. Heureusement, j’avais ma tente ultra-légère et mon sac de couchage -10 degrés. J’ai acheté un tapis de sol sur place. Et je me suis fait tout le pays en camping. C’était une putain d’expérience, mais la contrepartie, c’est que j’ai maudit un milliard de fois mon sac à dos d’être si lourd…
Désormais, je ne prends plus ces équipements. En tant que minimaliste, je sais qu’en cas de nécessité, je louerai ou achèterai ce dont j’ai vraiment besoin sur place, en m’adaptant. Je préfère réagir au coup par coup, plutôt que de tout prévoir en amont.
C’est une autre manière d’envisager la vie.
Alors à toi de voir. Il existe de nos jours des équipements très légers, très compacts, mais qui sont franchement chers. Va chez Décathlon, tu verras.
Souviens-toi juste que pour voyager léger, tu dois être certaine de n’embarquer avec toi que ce que tu es absolument sûre d’utiliser.
Les liens Amazon de la page sont affiliés. Pour tout achat via ces liens, le blog perçoit une petite commission.
Ainsi vous contribuez sans effort à la vie de ce blog, en participant aux frais d'hébergement.
Carnet de Route #15 : Un Mois et Vingt Jours
Moi je m’occupe des capucins, y en avait trois au début, bientôt prêts à être relâchés en pleine nature, afin qu’ils reprennent leur vie libre, et puis le petit dernier est arrivé, Danielito, clairement traumatisé et effrayé au dernier stade. Il s’est de suite pris d’affection pour moi et donc je passe ma journée avec lui sur le dos en train de m’étouffer avec ses petits bras qu’il tient crochetés autour de mon cou, à serrer comme un maboule dès qu’un autre singe fait mine de s’approcher ou que je fais un mouvement trop brusque, et surtout à me pisser dessus chaque fois qu’il a trop peur (c’est-à-dire quinze fois par jour).
Mon pote l’Anglais s’en va et moi je taffe avec les singes
L’Anglais et moi, on était devenus pas mal pote. On avait vite pris l’habitude d’aller dîner ensemble le soir, au Puma, le resto du village où se retrouvent tous les volontaires, et de se taper deux bières (les modèles extra-larges qu’ils servent ici) qu’on partageait l’une après l’autre. Ils passent toujours de la bonne musique dans ce rade, notamment du jazz qu’il adorait, et c’était un putain de bon moyen de décompresser après les journées éreintantes qu’on se cogne dans la jungle. On parlait de plein de trucs, du processus artistique, de comment changer sa vie. Il m’a dit un truc qui m’a marquée au sujet de la création, quelque chose que j’avais pas capté toute seule. Je sais plus trop comment, mais je lui ai demandé pourquoi les génies et les fous étaient si souvent associés et confondus. Selon lui, c’est parce que ces deux types de personnes sont capables de se concentrer si totalement sur leur vision que le monde alentour finit par disparaître. Ils savent se dédier tout entiers à une chose unique, qu’eux seuls peuvent percevoir, mais qui acquiert pourtant une importance telle sur leur vie qu’ils en oublient de manger, de dormir, ou encore d’entretenir un quelconque rapport humain ou social. J’ai trouvé ça beau, et pertinent. Je crois que j’aimerais devenir ce type de personne.
Hier c’était son dernier soir et je suis tombée sur lui, assis sur un banc du village avec une bouteille de rouge, en train de regarder ce qu’il avait filmé avec les singes du Mirador, sa place à la réserve. Je me suis assise avec lui et on a sifflé la bouteille à deux, ce qui était en définitive la meilleure façon de se faire des adieux en bonne et due forme. C’est comme ça les voyages. On se croise, on squatte la même fréquence quelque temps, et puis chacun reprend sa route, s’en va poursuivre ses propres chimères, tracer une nouvelle ligne droit devant.
J’ai les boules qu’il se soit barré, maintenant je partage ma piaule avec un Australien qui ressemble à un Marine, exactement le style de mec que je peux pas saquer.
Je taffe avec les singes moi aussi désormais, au Monkey Park, là où se trouvent les spécimens les moins agressifs, que les locaux peuvent venir visiter comme dans un zoo. Des singes, y en a aussi en bas, une trentaine, près de la clinique vétérinaire. Des pauvres petits bonhommes dans des cages, traumatisés ou malades, qui nécessitent des soins constants, et d’autres encore au Mirador où travaillait l’Anglais. Des singes araignées, très violents pour cause de mauvais traitements encore une fois, les noirs avec des longs bras et des longues queues.
Moi je m’occupe des capucins, y en avait trois au début, bientôt prêts à être relâchés en pleine nature, afin qu’ils reprennent leur vie libre, et puis le petit dernier est arrivé, Danielito, clairement traumatisé et effrayé au dernier stade. Il s’est de suite pris d’affection pour moi et donc je passe ma journée avec lui sur le dos en train de m’étouffer avec ses petits bras qu’il tient crochetés autour de mon cou, à serrer comme un maboule dès qu’un autre singe fait mine de s’approcher ou que je fais un mouvement trop brusque, et surtout à me pisser dessus chaque fois qu’il a trop peur (c’est-à-dire quinze fois par jour). Je subis ça d’une façon relativement stoïque. Ce gosse a besoin d’être rassuré, et il va mettre du temps à s’adapter, à trouver ses marques et s’émanciper un peu.
Malgré tout, c’est génial d’être au milieu de ces petits êtres et d’essayer de communiquer avec eux, même si ça représente un taff épuisant de s'en occuper. Le matin quand on arrive, on prépare les seaux de fruits qu’on monte tout là-haut dans la jungle où se trouve le Monkey Park. Sur le chemin faut faire gaffe de pas se faire agresser par les singes sauvages bien évidemment attirés par la bouffe, et notamment ne surtout pas regarder l’Alpha Male de cette petite troupe dans les yeux, car il y verrait un signe de provocation et pourrait nous mordre et nous déchirer les tendons du poignet comme il l’a fait avec un ancien volontaire. Arrivé là-haut, on vide les seaux dans les mangeoires et toute la jungle se précipite pour bouffer, ce qui est toujours agréable à regarder : singes-araignées, capucins, singes-écureuils et oiseaux font disparaître la tonne de fruits en quelques minutes, et nous pendant ce temps-là on est censés nettoyer les cages des capucins et des gros singes qu’on ne libère que le temps du repas. Leurs cages sont dégueulasses, de la merde partout, et faut y aller à grandes eaux sans jamais parvenir à un résultat satisfaisant… Un truc qui me chagrine : les singes ont des bouts de tissu en guise de couette ou de doudou, et chaque jour on doit les laver à la javel pour éviter les parasites et les infections, mais l’eau des bacs où on les lave va directement… dans la rivière, ouais, celle qui passe sous le pont. Faudra m’expliquer le délire… J’ai de plus en plus de mal à le faire, et je vois pas l’intérêt de sauver des animaux pour pourrir chaque jour l’écosystème où on est censés les relâcher ensuite…
Bref, une fois les cages propres, on balade les singes en laisse dans la jungle histoire qu’ils se défoulent un peu. J’adore les voir courir, grimper aux arbres, puis sauter sur mes épaules, m’agripper, jouer entre eux. Puis c’est déjà la pause de midi, on les remet en cage, on descend bouffer, et au retour rebelote les seaux de fruits et la promenade. Et puis c’est la fin de journée et tant mieux parce que fatalement après tout ça, avec la chaleur, l’humidité, la pluie, les sand-flies (pire que les moustiques, c’est des espèces de petites mouches qui piquent à tout heure du jour et laissent des marques rouges qui démangent sa mère à fond), la pisse de singe dans le dos, les bottes lourdes de terre, et le crapahutage dans la jungle, t’en peux plus.
Mais je regrette pas d’avoir décidé de squatter un mois dans cet endroit. C’est une réelle immersion dans ce pays, une manière vraiment unique de vivre et ressentir la Bolivie et l’Amazonie que j’aurais pas connue autrement. Et puis maintenant je sais ce que c’est une averse tropicale, ça dure des nuits entières sans faiblir, ça tonne comme si c’était la fin du monde, et tes fringues puantes pleines de merde de singe, tes chaussettes pendues devant la fenêtre de ta piaule sur un pauvre fil accolé à la moustiquaire ne veulent pas sécher, alors tu mets et tu remets le dernier T-shirt qui te reste jour après jour et ça schlingue à mort mais tu t’en branles puisque tout le monde sent aussi fort que toi. Au fond j’adore être fringuée n’importe comment, sentir la sueur, être couverte de boutons d’insectes et transpirer sans faire même y faire attention parce que maintenant je suis habituée à ce climat de fou.
Et je veux jamais oublier la sensation de plénitude que j’éprouve chaque matin aux aurores, quand je traverse le pont pour aller bosser, et chaque soir après ma journée de taff, quand je suis lessivée et dégueulasse pour rentrer à Vegas. Lessivée mais heureuse, apaisée, comme je l’ai jamais été de ma vie. Comme si j’étais là où je dois être, et c’est tout. Je veux pas oublier ça.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #14 : Un Mois et Quinze Jours
Un soir à Vegas, l’Anglais m’a entendue chanter les Pink Floyd en revenant de la douche et il m’a demandé si je connaissais Shine On You Crazy Diamond. Aussi fou que ça puisse paraître, vu comment j’adore ce groupe, je l’avais jamais entendue, alors il me l’a mise sur son PC avant d’aller se doucher à son tour. Je l’ai écoutée allongée sur mon lit et quand il est revenu j’étais en train d’écrire. Voilà le passage.
Un roman écrit sur la route
Un soir à Vegas, l’Anglais m’a entendue chanter les Pink Floyd en revenant de la douche (le solo de guitare de The Wall, que j’adore reproduire note pour note rien qu’avec ma voix), et il m’a demandé si je connaissais Shine On You Crazy Diamond.
Aussi fou que ça puisse paraître, vu comment j’adore ce groupe, je l’avais jamais entendue, alors il me l’a mise sur son PC avant d’aller se doucher à son tour.
Je l’ai écoutée allongée sur mon lit et quand il est revenu j’étais en train d’écrire.
A ce moment même je savais que ce que je rédigeais allait changer la face de Borderline.
Extrait de Borderline
Le soir même du jour où mon cerveau s'est remis à fonctionner, j'ai été chercher la caisse et j'ai pris la route sans savoir ce que je faisais. D'ailleurs j'aime autant vous prévenir qu'à partir de maintenant faudra pas chercher à comprendre ce que je raconte ou tenter de trouver une cohérence à ce que j'ai branlé après ça. Suivez le truc, comme je l'ai fait, c'est tout ce qu'on vous demande.
En fait ça m'étonne que j'ai pu me barrer comme ça, sans dire au revoir. Je crois pas que c'était ce que l'hôpital avait prévu, sans compter qu’y avait sans doute des trucs juridiques à régler et tout, m'enfin on peut le faire, on peut se casser comme ça, même si y a sans doute peu de gens qu’osent le faire tout simplement.
Tout le long du chemin jusqu'à la voiture, j'ai eu comme des flashs des moments que j'avais passés à l'H.P, des trucs, des paroles qui reviennent et s'évanouissent de nouveau, qui s'échappent quand on veut des précisions, et qui se blottissent dans l'inconscient pour mieux rejaillir en temps voulu.
J'ai laissé filer. De toute manière j'étais fracassé en mille morceaux, décomposé, l'esprit comme un puzzle où y manque des pièces, et vous connaissez le principe du puzzle : tu mets d'abord les coins, les bords, et petit à petit tu te rapproches du centre, t'as un bout à moitié fait qui traîne au milieu et que pour le moment tu sais pas où mettre, et y a qu'à la fin que tu découvres l'image, si t'as pas pété un câble et tout envoyé valser.
Quand j'ai grimpé dans la bagnole, Tyler s'est installée à l'avant, a envoyé valdinguer ses grolles comme elle faisait tout le temps et a posé ses pieds nus sur le tableau de bord. Et elle a commencé à tourner son visage vers moi. Je m'apprêtais à voir ce sourire si particulier qu'elle avait quand elle savait qu'on allait faire de la route. Elle adorait faire de la route, c'était toujours elle qui gérait l'autoradio, elle savait exactement quoi mettre au bon moment pour que musique et paysage s'accordent et intensifient mutuellement leurs effets.
Elle allait se tourner vers moi. Elle allait me faire ce sourire.
Mais elle a disparu d'un coup, le siège était vide, comme si elle avait jamais existé.
Je me suis pris une suée instantanée, le cœur à balle, le dos trempé, le souffle coupé.
J'ai pensé : Au secours.
Tous ses trucs traînaient partout encore, un short en jean, des lunettes de soleil, le CD des Pink Floyd où elle préparait toujours nos traces. Son aura imprégnait toute la caisse.
Alors j'ai fermé les yeux en faisant comme si j'allais pas devenir fou, et j'ai démarré comme un bourrin, parce que je savais que la seule chose à faire était de regarder droit devant moi, de me concentrer sur la route comme un acharné, de serrer le volant jusqu'à ce que j'en aie mal aux épaules, et surtout, surtout, éviter à tout prix d'appuyer sur le bouton de l’autoradio, au risque de faire jaillir la dernière musique qu'elle avait mise, et bordel je savais trop bien laquelle c'était.
J'ai roulé toute la nuit, ça m'a fait du bien, parce que je me suis retrouvé proche d’un état qui m’était devenu familier. Une semi-conscience telle que celle que doivent connaître les mollusques, une réconfortante annihilation de la pensée, sans troubles ni soubresauts, un coma blanc et salvateur. Je me rappelle le défilé hypnotique des lumières, le noir de la route avalée si vite, l'engourdissement.
Le soleil m'a réveillé. Je me rapprochais de l'Ouest, le paysage avait changé. J'étais si heureux que j'ai failli réveiller Tyler qui dormait sur le siège à côté.
Je me suis arrêté à une station-service. J'ai commandé un café, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai pas été foutu de le boire. La serveuse m'a demandé si ça allait alors j'ai éclaté en sanglots et je suis reparti vers la caisse juste avant de m'évanouir.
J'ai recommencé à rouler. L'air devenait plus chaud à mesure que j'approchais du désert. Et soudain j'ai réalisé à quel endroit j'étais en train d'aller. C'est là que j'ai vraiment commencé à flipper. J'étais tétanisé de peur et d'appréhension, et alors la haine s'est mise à monter. D'un coup j'ai enfoncé la pédale et la bagnole a bondi en avant en grognant comme une monstrueuse bestiole affamée.
Je me suis dit que j'étais complètement planté de vouloir retourner là-bas, et les restes de mon esprit disloqué se sont recroquevillés sur eux-mêmes à cette idée terrifiante. Et quelqu'un au fond de mon âme s'est affaissé contre le mur en gémissant, a entouré ses jambes avec ses bras, et s'est mis à se balancer d'avant en arrière comme un psychotique, en secouant la tête. Jamais, jamais plus il ne faudrait retourner là-bas.
Mais il y en avait un autre qui criait, qui hurlait qu'il voulait se projeter au plus profond de la souffrance, que le seul endroit où aller c'était précisément là-bas, que c'était la dernière chose qu'il restait à faire, la seule chose qui ait encore un sens. Il serrait les dents tellement fort que de la mousse commençait à apparaître au coin de ses lèvres, et son hurlement s'est mué en un rire fanatique, démentiel. Et c'est celui-là qu’enfonçait l'accélérateur, pour qu'on en finisse.
Et au loin, une voix, comme un simple frémissement, proche d'une impression sans origine définie, une voix disait qu'elle serait là-bas.
C'est alors qu'un pneu a crevé. Je roulais si vite que la caisse a fait une embardée de fou et s'est mise à tourner, putain, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et quand ça s'est arrêté j'étais tellement loin de la route que j'ai eu du mal à le croire. Mais c'était une région assez plate, et j'étais toujours vivant, apparemment. Ça a au moins eu le mérite de me calmer. J'ai allumé une clope en tremblant de partout et passé une main dans mes cheveux trempés de sueur.
Je me suis senti frustré dans mon délire, mais j'avais surtout pitié de moi. J'étais en train d'agir comme si ma vie avait encore un sens. Comme s'il y avait encore quoi que ce soit à sauver. Quelque chose qui mérite qu'on se mette dans un état pareil. À vrai dire, le seul truc encore sensé à faire était de s'asseoir par terre contre la bagnole et de se laisser crever, dévoré par les vautours. Je méritais pas mieux. Mon orgueil m'a donné envie de me foutre une balle dans la tête. Et j'étais tellement minable que j'avais même pas de flingue.
Il faisait chaud. Et y avait pas un seul putain d'arbre dans ce désert de merde. J'ai ouvert deux portières et je me suis allongé dans l'ombre. J'ai sombré dans un sommeil sans rêves.
J'ignore combien de temps j'ai pioncé, mais quand j'ai ouvert les yeux il faisait nuit. Le ciel était rempli d'étoiles. J'ai entendu des pas, et avant que j’aie pu me redresser, son visage est apparu au-dessus du mien. Je savais que c'était elle, mais je ne pouvais pas distinguer ses traits. Ses longs cheveux ont frôlé mon front. Elle a dit :
— Faut qu'on se magne le cul de changer cette putain de roue si on veut arriver avant demain soir.
J'ai demandé en me levant :
— Quelle heure il est ?
Elle a tendu une main devant elle, paume en l'air, et m'a dit :
— L'orage arrive. Ça va pas tarder à flotter.
Et elle a ouvert le coffre et entrepris de sortir la roue de secours.
— Impossible que ça flotte. Le ciel est gavé d'étoiles.
— J'espère qu'on a pas oublié de prendre le cric.
J'ai changé la roue et on est montés dans la caisse. Et au moment où on rejoignait la route, une goutte s'est écrasée sur le pare-brise. Tyler m'a lancé un regard satisfait et a commencé à trifouiller les CD. Elle a mis les Doors, je vous laisse deviner laquelle.
Je crevais d'envie de la toucher, mais j'étais paralysé par l'idée qu'elle s'évanouisse de nouveau, qu'elle m'abandonne comme la dernière fois, et j'osais même pas lui parler. Je jouissais juste de sa présence. C'était ça qui me manquait le plus finalement. Une partie de moi savait qu'elle était pas vraiment là. Mais ce n'était qu’une vague idée qui stagnait à la périphérie de ma conscience. L’impression floue qu'un truc n'était pas à sa place. Mais j'étais si heureux de pouvoir juste la contempler que j'ai eu aucun mal à l'occulter, jusqu'à la faire complètement disparaître de mon esprit.
C'est donc bercé par le rythme des musiques qui s'enchaînaient parfaitement que j'ai avalé les bornes sans y faire attention.
Et à un moment j'ai ouvert les yeux, et je faisais face à l'endroit où j'avais tant redouté d'aller. J'ai pas eu le temps de comprendre ce que je ressentais car Tyler a bondi sur son siège et a pointé d'un doigt fébrile ce nœud hors de l'espace-temps qui est devenu ma pire hantise et mon fantasme absolu, ce lieu mythique au cœur de mon esprit où se mêlent attraction et répulsion, dans un combat sanglant qui ne prendra jamais fin, et qui finira par me rendre taré. Et bordel je demande pas mieux que de même plus savoir qui je suis.
Et Tyler a gueulé :
— C’est là ! C’est là qu’il faut qu’on s'arrête ! Là-bas où ça s’avance dans le vide ! Attends attends attends faut que je mette la musique !
C'est là qu'une étrange lumière a scintillé au fond de ma conscience. Et avant même qu'elle mette la musique, une symphonie inquiétante a commencé à se jouer dans ma tête.
Mon cœur a sauté une marche et j'ai avalé ma salive.
J'ai fermé les yeux une brève seconde et je lui ai demandé :
— Qu'est-ce qu'on fait ici ?
Elle jouait la mélodie de la guitare avec sa bouche, reproduisant chaque note parfaitement.
— Qu'est-ce que tu fais là ?
— Enfin on y est, depuis le temps que j'en rêve !
— D'où est-ce que tu viens ?
Mais elle continuait à chanter, comme si elle m'entendait pas. Comme si on appartenait à deux mondes différents.
Une larme a coulé le long de ma joue et j'ai senti mon esprit se hérisser et s'acharner contre les parois de mon crâne pour s'échapper. Fuir cette horreur. Et la musique qui continuait à monter. La route qui filait de plus en plus vite. La terreur de la révélation qui croissait à mesure qu'elle se frayait un chemin jusqu'à la conscience.
J'ai crié en pleurant :
— Réponds-moi Tyler !
Mais elle a juste murmuré, le regard perdu au loin, comme elle l'avait fait dans une autre vie :
— Le soleil est en train de se coucher...
C'était fini. Je ne pouvais plus nier. Je faisais face à ce que j'avais tant redouté, esquivant l'évidence en ne posant pas de questions, alors que le défilé des musiques me rappelait dangereusement quelque chose, quelque chose de trop ignoble, que mon esprit ne pouvait que refouler désespérément.
Elle n'était pas là. Elle ne serait jamais plus là désormais. Elle n'avait fait que répéter les gestes et les paroles qu'elle avait déjà faits et dites. Elle ne m'avait jamais répondu. Et alors j'ai tourné la tête dans sa direction mais le siège était vide, comme il l'avait toujours été depuis que j'avais quitté l'hôpital.
Des vagues de pensées m'ont assailli d'un coup. La musique continuait à se déverser en moi, mais j’étais plus dans la voiture. Ça ressemblait à un bad trip, et j'ai soudain entendu les paroles des toubibs : Parfois, quand le cerveau reçoit une information qu'il ne peut tolérer car elle génère d'un coup trop de souffrance, il agit comme un système électrique et pète une durite pour éviter la surtension. C'est un moyen de survie. C'est ce qui vous est arrivé.
(Je suis en plein bad trip et Tyler doit pas être loin, faut juste que j'attende que ça passe, l'effet du truc va passer et je vais finir par rejoindre la réalité)
J'ai vu ce qui nous était arrivé ici à tous les deux.
Nous sommes navrés, Mr. Montiano, mais vous devez le comprendre : votre sœur est morte.
Est-ce que j'avais seulement quitté l'H.P ? Est-ce que j'étais en plein bad trip, en plein rêve ? Est-ce que j'avais rompu le charme, gâché la seule chance que j'avais de la revoir une dernière fois, de revivre ce moment unique et de rectifier le cours du destin, parce que j'étais incapable d'y croire assez fort ?
Shine On You Crazy Diamond a atteint son paroxysme et un spasme de douleur a incendié tout mon être, un orgasme de haine qui m'a poussé à continuer tout droit, à dépasser cet endroit maudit où flottaient encore les fantômes de ce que nous avions été, qui cherchaient à m'agripper mollement, à m'attirer avec leurs plaintes, pour que je sombre et rejoigne leur macabre cérémonie, où la même tragédie était jouée éternellement, et à ne pas céder à la tentation de regarder une dernière fois la silhouette qui se tenait au milieu de la route, loin derrière la voiture, dressée contre le ciel, et qui me regardait l'abandonner.
Découvrir la saga dont ce texte est extrait.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #13 : Un Mois et Dix Jours
La plupart des animaux qui sont ici ont subi des mauvais traitements. C’est toujours pareil : les gens les trouvent mignons quand ils sont petits, et puis un jour le tejone ou le singe niaque le gosse de la famille et on s’en débarrasse. Le problème, c’est qu’ensuite ils sont complètement inadaptés à la nature, et bien peu d’entre eux auront un jour la chance d’y retourner…
S’occuper d’animaux sauvages, Réserve Inti Wara Yassi
Plus le temps d’écrire, des journées de dingue ! Je me lève à 6h et je me prépare vite fait (c’est-à-dire que je remets mes fringues raides de crasse de la veille et mes bottes en caoutchouc merdeuses) puis je traverse le pont pour me rendre à la réserve où je prends le petit dej avec les autres volontaires. Ensuite je vais m’occuper des tejones (coatis, en français) avec ceux qui taffent avec moi. Y a tout un système de mis en place pour essayer qu’elles kiffent un peu leur life, ces pauvres bêtes.
La plupart des animaux qui sont ici ont subi des mauvais traitements (différentes espèces de singes, petits mammifères, oiseaux, tortues, et même un ours et un jaguar). C’est toujours pareil : les gens les trouvent mignons quand ils sont petits, et puis un jour le tejone ou le singe niaque le gosse de la famille et on s’en débarrasse, ou alors ils sont retirés de force à des gens qui les maltraitaient. Le problème, c’est qu’ensuite ils sont complètement inadaptés à la nature, et bien peu d’entre eux auront un jour la chance d’y retourner…
C’est le cas des tejones. Aucun d'entre eux ne sauraient survivre seul, alors ils sont condamnés à vivre dans des cages, et on les sort la journée en les attachant à un réseau de cordes avec une laisse munie d’un mousqueton pour qu’ils puissent bouger un peu dans la jungle, m’enfin, peuvent pas aller bien loin, puis beaucoup ne s’entendent pas entre eux, alors faut gérer pour qu’ils se fritent pas. Parfois ils s’entortillent dans leur laisse et l’autre jour j’ai dû en sauver un en train de s’étrangler en bataillant pour le détacher sans me faire mordre. Heureusement que j’ai un bon feeling avec eux, et que je suis très rapide dans mes gestes, parce que personne voulait se dévouer.
Mais je vais trop vite. Petite récap des dix jours qui viennent de passer.
Le lendemain de mon arrivée, j’ai dû me foutre en culotte devant le véto du centre pour qu’il me désinfecte la cuisse (le chien m’a mordu assez haut, presque sous la fesse, et maintenant j’ai une belle cicatrice). Dans l’absolu, il aurait fallu que je me fasse vacciner contre la rage, mais personne ne pouvait me le faire ici, et c’était hors de question que je retourne à Cochabamba pour aller me faire chier à l’hôpital. Donc j’ai décidé que fuck. J’ai été me chercher des fringues de seconde main et des bottes en caoutchouc dans la remise de la réserve et ensuite les autres volontaires assignés au même poste que moi m’ont expliqué la marche à suivre avec les animaux dont on a la charge : les tejones, les tyras (sorte de petits félins), les tortues. Chaque espèce a un régime spécial et il faut préparer les gamelles de fruits avec chaque portion dans une salle dédiée où s’amoncellent des tonnes de bananes, papayes, oranges, mangues, ananas, pommes et j’en passe… Après le repas des animaux, il faut les sortir et les attacher dehors pour nettoyer leur cage, ce qui est loin d'être évident, vu que tout est en bois bouffé par l’humidité et en fer dévoré par la rouille. Certains tejones sont si agressifs qu’on ne peut pas les sortir, et les tyras s’enfuiraient illico si on le faisait, alors faut essayer de nettoyer leur merde sans se faire mordre. Pas évident. Les bébés tejones donnent aussi du fil à retordre, ils sont si vifs qu’il faut s’appeler Flash Gordon pour arriver à foutre leur gamelle dans leur grande cage sans qu’ils s'échappent comme des petits enculés ou se jettent sur nous pour nous bouffer.
Mine de rien, c’est du taff tout ça, et on a pas un poil de sec. On fait une pause d’une heure le midi pour bouffer sur la grande table et on y retourne jusqu’à 18h30. Ensuite retour à Vegas et c’est la queue pour la douche (un vieux boxe en ciment avec un filet d’eau qui vient d’un tuyau relié directement à la rivière qui gronde plus bas), on essaye de rincer un peu ses fringues pleine de sueur et de boue et on les accroche sur les fils qui courent le long des moustiquaires devant chaque piaule, mais inutile de prétendre que tout ce putain de truc ne sent pas le vieux fromage et cette odeur très particulière qui émane de la sueur rance et des fringues qui ne sèchent jamais, parce que le climat est trop humide. Mais on s’habitue vite au fait de puer sa race toute la journée, surtout quand tout le monde sent pareil.
A Vegas, je partage ma piaule (une simple pièce minuscule avec un lit une place de chaque côté) avec un Anglais qui vit en Malaisie, un mec de quarante ans. Je l’avais repéré le premier matin, en me faisant la réflexion qu’il avait une gueule de fou, et quand plus tard la directrice m’a donné le nom du mec avec qui je devais partager la chambre, j’ai su que ça devait être lui. En rentrant le soir après avoir récupéré mes affaires dans l’hôtel d’avant je l’ai croisé sur le pont et je lui ai fait : C’est toi, l’Anglais. Banco. Et au final, ça m’étonne pas de moi d’être tombé sur lui. En fait, c’est un type génial. Un artiste, évidemment. Il compose des B.O. de films, et il est trompettiste aussi. C’est carrément cool de causer avec lui le soir face à une bière après une journée de taff épuisante.
Franchement, je me plais bien ici.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #12 : Un Mois
La première sensation, c’est la chaleur. Dans le bus déjà, la moiteur de l’air croissait à mesure qu’on quittait les montagnes pour s’enfoncer dans la jungle. J’ai adoré ça. J’adore quand on peut sentir le changement d’une façon physique, palpable. Et je peux vous dire que l’humidité te palpait de partout, jusqu’au slip, avec la sueur qui te dégouline entre la raie des fesses.
Première rencontre avec l’Amazonie, Villa Tunari
La première sensation, c’est la chaleur. Dans le bus déjà, la moiteur de l’air croissait à mesure qu’on quittait les montagnes pour s’enfoncer dans la jungle. J’ai adoré ça. J’adore quand on peut sentir le changement d’une façon physique, palpable. Et je peux vous dire que l’humidité te palpait de partout, jusqu’au slip, avec la sueur qui te dégouline entre la raie des fesses. J’ai d’ailleurs fini par céder et m’acheter une glace à la papaye foireuse (bien que ce soit fortement déconseillé par tous les guides de voyage) au mec qu’était monté à bord pour vendre ses trucs sa glacière à la main, et je me suis jetée dessus comme tous les passagers qui m’accompagnaient.
J’étais franchement scotchée. J’en revenais pas, merde, enfin j’étais dans la jungle ! Rien que le mot me faisait frémir. C’était à la hauteur de ce que j’avais imaginé. Une végétation de fou, des arbres immenses, des rivières, des cascades qui dévalaient les montagnes… J’étais en plein cœur d’un putain de rêve ! Je l’avais fait, nom d’un chien, j’étais là où je m’étais promis d’aller. Dans ma tête j’ai crié : Je vous encule tous ! (ouais je sais, c’est mesquin, mais j’ai toujours une petite pensée pour ceux que j’ai laissé derrière).
Quand je suis descendue du bus, j’étais toujours en nage, et en plus j’avais maintenant ce putain de sac de 18 kilos sur le dos, mais j’avais le diable dans le cul et je me suis lancée direct droit devant. J’avais lu dans mon guide que l’hôtel Las Vegas était dans mes prix. J’ai acheté un paquet de clopes à une tienda de bord de route et m’en suis allumé une, même si j’étais ratatinée de chaleur, déshydratée et écrasée par mon sac, rien à foutre, j’avais fantasmé dessus pendant les cinq heures du trajet, alors fuck off. J’ai demandé à des villageois qui traînaient là de m’indiquer l’hôtel. C’était pas compliqué, j’avais qu’à continuer le long de la grande route où le bus m’avait larguée, que je suivais depuis le début, il se trouvait juste avant le pont.
J’avoue que quand j’y suis parvenue, j’ai eu comme un choc. Premièrement du fait que c’était pas vraiment un hôtel, mais des piaules accolées les unes aux autres en longueur dans un genre de jardin… Enfin quand je dis jardin, n’allez pas vous imaginer le petit truc coquet avec de l’herbe rase et des fleurs, mais plutôt un espace tout boueux, non fermé, accessible par quelques vieilles marches en pierre, avec du linge qui séchait de partout, des chiens hargneux, trois poulets rachitiques qui pataugeaient dans leur merde, bref, un bout de brousse dirty à mort, quoi. J’ai demandé au gamin qui se trouvait là si c’était bien l’hôtel Las Vegas, et il m’a fait : Ouais, c’est ici, Vegas (bon, pour ce qui est du clinquant, on repassera). Mais il m’a dit que c’était que pour les volontaires de la réserve (mon guide s’était gouré, mais ça tombait plutôt bien), que je devais d’abord y aller et m'inscrire avant d’avoir une piaule. OK. J’ai posé mon cul deux secondes histoire de soulager mes épaules et finir cette saloperie de clope, et je suis repartie. Au point où j’en étais, autant poursuivre sur ma lancée, de toute manière j’étais en transe et je me fichais de devoir marcher encore.
Juste après Vegas, j’ai donc franchi ce pont immense, et la rivière était là, une rivière d’Amazonie, avec la jungle de chaque côté, les montagnes dévorées par les arbres au loin, et c’est à cet instant que j’ai vraiment réalisé ce qui m’arrivait. J’avais la bouche grande ouverte et dans ma tête tournait en boucle : Putain j’en reviens pas, putain de merde, ça alors, ça alors putain de bordel j’en reviens pas.
Et j’ai débarqué au refuge. Direct je me suis fait agrafer par un blond à l’air halluciné avec des cheveux bouclés à la Jim Morrison qui lui arrivaient aux épaules, un débardeur délavé à l’eau de javel, un short baggy et des bottes en caoutchouc, le regard bleu et pénétrant, le tout bien trash, comme d’ailleurs tous les gens que j’ai croisés par la suite. Chacun faisait son truc, portait des seaux de fruits, des branches, ou buvaient une bière sur la grande table en bois devant l’entrée du truc, tous plus sales les uns que les autres, et j’ai eu envie de faire partie de ça, moi aussi. Alors après la visite guidée faite par une volontaire (voilà les tejones, voilà les singes, voilà les oiseaux), j’ai été dans le bureau de la directrice et j’ai signé pour un mois sans réfléchir, comme je fais toujours quand je suis emballée par quelque chose. Je vais m'occuper des petits animaux pendant les deux premières semaines, et ensuite des singes pour les deux dernières.
Y a plus de place à Vegas pour le moment, alors la première nuit je la passe dans un autre hôtel bien plus classe (y en a trois en tout, selon les moyens de chacun. Moi je peux juste me payer le plus pourrave, évidemment). Y avait une sorte de fête et j'ai pu faire un peu connaissance avec les autres volontaires. Beaucoup d'Américains, quelques Français. On a picolé, et au retour je me suis paumée pour rentrer à ma piaule, et je me suis fait mordre à la cuisse par un chien qui défendait son territoire (à moitié bourrée dans la jungle, j’ai loupé l’embranchement pour rentrer et me suis retrouvée chez des locaux. Le chien a fait ni une ni deux).
Je viens de désinfecter comme j’ai pu. Ce salopard m’a vraiment rentré la dent dans la cuisse. Et maintenant je vais me pieuter. Demain je commence le taff direct et faudra que je déménage pour Vegas. La journée a été longue.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #11 : Trentième Jour
J’apprécie de plus en plus ce que je suis en train de vivre. J’adore cette liberté qui te fait pointer du doigt un lieu sur la carte et sauter dans un bus qui t’y amène en une journée. C’est un truc de fou, je dispose de ma vie comme je veux, tous mes caprices sont à portée de mains pour quelques pièces, je peux faire ce que je veux de moi-même !
Paraît que je suis timbrée
Me revoilà enfin seule, tranquille et soulagée dans ma piaule pourrie (une de plus, me direz-vous), attendant que l’eau soit rétablie, soi-disant vers neuf heures ce soir (ce dont je doute). Ma chambre donne sur une rue super bruyante en plein milieu de la ville. Le trajet en bus a duré sept heures pour parvenir ici, et j’ai traversé des paysages grandioses de terre rouge et humide envahie de broussaille, une putain de merveille, d’autant plus après la folie de La Paz, engorgée de touristes satisfaits de rester entre gringos qui se donnent même pas la peine de faire semblant d’essayer d’apprendre l’espagnol. M’ont tous gavée, sa mère.
C’est con à dire, mais ça me réjouit de m’apercevoir que je recherche pas désespérément la compagnie des autres, bien au contraire, et que je m’accroche pas comme une pauvre paumée à mes semblables. Faut dire que jusqu’à présent, j’ai encore croisé personne qui ait ce truc dans le regard… Je m’attendais à ce que ceux qu’ont décidé de partir au bout du monde comme moi soient davantage transcendés, et surtout transcendants, d’autant plus que la majorité d’entre eux n’en est pas à son premier trip. Mais aucun ne m’a encore fascinée, ni par son comportement, ni par son discours. Ils ont pas l’air de vraiment différer des gens ordinaires…
J’ai accompagné le couple de dreadeux dans les rues de la capitale, dans des boutiques innombrables d’artisanat. Ce couple achetait des tas de babioles qu’ils comptaient revendre en France sur des festoches dix fois plus cher, et je les ai regardés marchander comme des perdus avec les vendeurs. Je déteste le marchandage. Moi j’ai rien acheté. Pas de place dans mon sac, pas le fric pour, et puis ce qui m’intéresse, c’est les expériences, pas les objets. Je préfère garder mon pognon pour me payer des bus ou du cheval.
Des gens, j’en ai croisé beaucoup, mais le pire d’entre eux, c’est ce mec dans cet hôtel en plein centre de La Paz, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Un putain de repère de gringos, une ratière en béton sur quatre étages, sale et glauque, certes pas chère, mais putain ! La dope tournait dans tous les coins, c’était chelou au possible, ma piaule ressemblait à une cave, et les touristes avaient l’air d’y vivre comme dans un microcosme hors du monde, hors de la Bolivie. Et ce mec, là, matez un peu le tableau : un pauvre prétentiard de 22 piges qui venait de se payer une diète d’ayahuasca dans la jungle pour 800 dollars, et qui se trimballait partout avec ce petit sourire tranquille, satisfait et super énervant de celui qui a compris et accepté le monde, celui qui ne se tracasse plus pour rien parce qu’il sait où il va, lui, et qui méprise ceux qui se cherchent encore et se débattent pour trouver un sens à leur vie (comme moi). Putain, je l’aurais tarté ! Je peux pas saquer les pseudo spirituels qui te prennent de haut comme ça.
Alors ouais, je me réjouie de plus être forcée de m’intéresser à leur connerie. Pourtant à chaque fois au début je suis contente de pouvoir partager ce que je vois et ce que je vis, mais très vite leur simple contact me pourrit mon groove, et je parie que moi aussi je finis par les gaver avec ma frénésie et mon bonheur trop agressif, trop survolté. Eh merde, c’est eux qui me fatiguent à être mous et posés ! C’est à se demander pourquoi ils sont partis si ça les fait si peu vibrer ! Moi je cherche des gens aussi acharnés que moi dans leur poursuite de l’expérience absolue, et capables de me subjuguer, de me scotcher, de me faire rêver avec leur folie. Et si je trouve pas, bah tant pis, j’ai toujours la mienne pour me consoler, et elle me suffit amplement, en fait.
J’apprécie de plus en plus ce que je suis en train de vivre. J’adore cette liberté qui te fait pointer du doigt un lieu sur la carte et sauter dans un bus qui t’y amène en une journée. C’est un truc de fou, je dispose de ma vie comme je veux, tous mes caprices sont à portée de mains pour quelques pièces, je peux faire ce que je veux de moi-même ! Je suis plus attachée à une vie qui me correspond pas mais que je suis forcée de vivre parce qu’y a pas d’autre issue, si ce n’est le suicide.
Je suis enfin mon seul repère, ma seule référence, et j’éprouve une joie sans nom à balancer à tous ceux que je croise que moi, je vais là, et que j’y vais tout de suite, et que je tiens pas à ce qu’ils m’accompagnent, merci. Y a plus que moi et mon sac désormais, plus rien ne peut me retenir... Et même au milieu de ceux qui sont partis, je suis encore différente. Même au milieu de ceux-là, c’est encore moi celle qui y croit le plus. Celle qui pourrait expliquer aux autres pourquoi il se sont barrés, alors qu’ils en savent rien eux-mêmes. C’est encore moi la plus énergique, la plus survoltée. Et j’adore ça, putain !
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #10 : Vingt-Septième Jour
J’ai adoré ces journées de marche sur le sol caillouteux, presque volcanique par endroit, avec le soleil qui me tapait dessus, et ce lac où le vent dessinait comme des vagues à la surface. J’avais parfois du mal à croire que j’étais bien à presque 4000 d'altitude, sur le plus haut lac navigable du monde, qui fait fantasmer tant de gens depuis leur télé. C’est fou, nan ?
Soirée coke à Copacabana, Bolivie, Lac Titicaca
Putain, en quatre jours, y s’en est passé, des choses. Le passage de frontière s’est fait sans galères, et j’étais contente d’être accompagnée pour apprendre les formalités. Mon espagnol est toujours à chier, et ça m’aurait un peu stressée, faut avouer. Le soir même de notre arrivée dans ce village mignon comme tout (parce que gavé de touristes, donc adapté pour eux, soyons franc), à l'hôtel on a croisé d’autres gringos, des français encore une fois, plutôt cool dans l’ensemble, avec qui on a décidé de partir visiter la Isla del Sol, sans doute la plus connue des îles du lac Titicaca. Soirée de murge mémorable, et le lendemain matin des heures de bateau pour l’atteindre, mais vu qu’on allait y passer deux nuits, c’était pas gênant.
Cette île est une merveille. Et malgré l’afflux constant de touristes, elle se démerde pour avoir l’air préservé. Tu peux marcher des heures le long de ses chemins, avec des vues splendides sur le lac, sans croiser trop de monde. Je me suis encore déchaînée avec les photos. Je me demande comment font les autres pour arriver à pas mitrailler tout ce qu’ils voient. La première nuit, le coucher de soleil, visible depuis les flancs de la colline où se trouvait notre hôtel, était carrément bouleversant. J’ai adoré ces journées de marche sur le sol caillouteux, presque volcanique par endroit, avec le soleil qui me tapait dessus, et ce lac où le vent dessinait comme des vagues à la surface. J’avais parfois du mal à croire que j’étais bien à presque 4000 d'altitude, sur le plus haut lac navigable du monde, qui fait fantasmer tant de gens depuis leur télé. C’est fou, nan ?
En faisant le tour de l’île, en fin d’après-midi on est tombés sur un mec du coin dans son bateau, et vu qu’on avait pas spécialement envie de revenir sur nos pas pour encore trois heures de marche, on lui a proposé de nous ramener à Copacabana. Il s’est empressé d'accepter, ça arrangeait tout le monde cette histoire, alors banco.
Ce soir-là, on s’est mis la race dans une sorte de boite et on a tapé de la coke. Le patron d’un resto où on avait bouffé nous en avait vendu, et de toute façon je sais pas comment mais tout le monde semblait en avoir sur soi ce soir-là. Vodka après vodka, j’ai du mal à me souvenir de l’enchaînement des événements. Je sais que j’ai tapé un rail dans les chiottes avec un chevelu local, mais je sais plus pourquoi. Il m’avait fait signe en passant son pouce sous son nez et en désignant les chiottes d’un mouvement de tête, je crois. J’ai tapé plusieurs fois dans ces chiottes avec les français aussi. A un moment un bolivien m’a jeté son verre (pas le contenant, le verre) à la gueule pendant que je dansais, mais c’est qu’après que j’ai compris que ce verre m’était destiné, parce que les autres me l’ont dit et que le type s’est fait tej de la boite, et je saurais jamais pourquoi. Il m’a loupé, heureusement. J’imagine qu’il avait essayé de me draguer sans que je m’en rende compte (je danse toujours les yeux fermés, et ceux qui tentent une approche finissent par s’en aller sans même que je les aie remarqués) et que mon attitude l’avait vexé.
De retour à l’hôtel, on a évidemment sniffé tout ce qui restait des pochons de coke, et aux petites heures du jour le “couple” d’amis me racontait sa vie en mode mitraillette comme si j’étais leur psy (mais ça m’arrive souvent, je dois inspirer confiance, et puis la coke n’aide pas).
Bref. J’ai pris le bus ce matin avec un couple de dreadeux qui faisait partie du lot, et on se dirige vers la capitale de Bolivie, La Paz. Mais je crois que je commence à saturer des gens, là, et je vais pas tarder à les larguer. Dans mon guide j’ai repéré une réserve dans la jungle où on peut se proposer comme bénévole pour s'occuper d’animaux sauvages. Personne là-bas n’est au courant de mon arrivée, évidemment, vu que je l’ai trouvé en épluchant mon Lonely Planet dans le bateau. C’est la prochaine destination que je vise.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #9 : Vingt-Troisième Jour
La route jusqu’ici a été fabuleuse. Des heures et des heures à sillonner des terres austères, froides et brumeuses, parsemées de lacs aux couleurs étranges, parfois animées de troupeaux de lamas, ponctuées de quelques bicoques en adobe, au milieu de nulle part, où jamais un français ne pourrait envisager de vivre…
Les gamines qui chantent tristement, Puno, Lac Titicaca
La route jusqu’ici a été fabuleuse. Des heures et des heures à sillonner des terres austères, froides et brumeuses, parsemées de lacs aux couleurs étranges, parfois animées de troupeaux de lamas, ponctuées de quelques bicoques en adobe, au milieu de nulle part, où jamais un français ne pourrait envisager de vivre…
J’adore ces moments (des journées entières, à vrai dire) où je suis collée à la vitre du bus (je demande toujours un asiento a la ventana), seule avec le monde, à contempler le paysage toujours changeant, ces étendues immenses, imprenables, cette sensation de grandeur qu’on ne rencontre jamais en Europe, sans doute parce que les dimensions des pays elles-mêmes sont carrément plus restreintes que celles d’ici. C’est fou, mais même après dix heures de bus, je suis toujours un peu triste de devoir descendre. Cette suspension hors de tout, qui me plonge dans un état méditatif, comme si je pouvais regarder mon passé, mon présent et mon futur comme une fresque où tout se relie, me fait un bien pas croyable, et je crois que je suis comme qui dirait déjà accro.
Cette ville est moche, honnêtement. Même les abords du lac sont pas terribles. Elle respire une sorte de vice, entre les hordes de touristes qui se bourrent la gueule le soir dans les bars et les locaux à l’air invariablement louche. J’ai dû changer d'hôtel, le premier où j’ai passé la nuit n’avait pas d’eau et coûtait les yeux de la tête. Mais quand on débarque à la nuit tombée dans un bled qui craint, on a tendance à entrer dans le premier truc qui passe à sa portée. Bref, dès le lendemain matin je me suis barrée. Celui-ci est plus clean, presque joli. Mais je vais en changer encore parce que j’ai croisé des gens avec qui je peux partager une piaule, pour moitié moins.
Le premier matin j’ai été visiter en bateau ces fameuses îles Uros, faites en paille qui flotte, et où des habitants vivent pour de vrai, principalement du tourisme, en l'occurrence. Ils vendent des tissus brodés, des bijoux et des babioles en paille. Mais j’ai eu les boules dans le bateau. Des gamines qu’étaient dedans, et qui faisaient vraisemblablement partie du “tour”, se sont mises à chanter pour moi, comme des petits singes savants, concluant leur chanson triste par un “hasta la vista, baby”, que j’ai trouvé affreux. Dans le genre, amuser les gringos. Ça m'a pas du tout fait rire, moi. Je les ai prises en photo pour pas oublier. Me souvenir de cet air sombre qu’elles avaient…
D’une manière générale, j’ai détesté ce truc. Visiter les pauvres locaux, leur acheter des merdes par charité, se sentir con et plein de fric face à eux, le sourire gêné, parce que putain c’est la merde pour eux, mais qu’est-ce que je peux y faire ? Et pourtant, après avoir rencontré ce couple de français (une fille et un mec, des amis apparemment), j’y suis revenue une deuxième fois, sur ces îles, parce que pour aller voir la Isla Taquile et celle d'Amantani (de vraies îles, en dur, ce coup-ci), c’était inclus dans le tarif de passer par les Uros. Comment foutre son fric en l’air, quoi.
Bref, la seconde visite en leur compagnie était plus cool, on a passé l’aprem à crapahuter en shootant le Titicaca comme des malades (surtout moi, à vrai dire, je me découvre une passion pour la photo), et là on est de retour et y vont passer me chercher pour que je déménage dans leur hôtel. Demain on passe la frontière pour entrer en Bolivie, toujours le long du lac, où la ville de Copacabana nous attend.
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Carnet de Route #8 : Vingtième Jour
Tout le monde était sur le cul que je sois là pour un an entier, et j’ai dû expliquer que j’avais fait pousser et vendu ma weed pendant trois années consécutives pour en arriver là. Parlant de weed, les jeunes en avaient, ce qui n’a fait que renforcer le délire, la bonne humeur et l’hilarité générale !
Descente de la mort dans le Canyon del Colca
Sans déconner, cette descente dans le Canyon del Colca a été un putain de truc, qui m’a permis de comprendre quelque chose de majeur dans la vie d’un voyageur : l’intérêt de posséder deux sacs. Le gros que t’as sur le dos, et un petit que tu portes devant sur ton ventre, avec tes objets de valeurs et les quelques trucs dont t’as besoin quand tu pars pour ce genre d'expédition d’un jour ou deux. Les hôtels acceptent souvent de garder ton Quechua dans une consigne, en échange de la promesse que tu passeras une nuit chez eux à ton retour. De plus, quand tu le laisses dans la soute des bus, même s’il lui arrive une couille, y te reste au minimum tes papiers, ton appareil photo, ton fric et tes yeux pour pleurer.
Mais ça, je le savais pas avant de m’engager dans cette descente de la mort, avec mes dix-huit kilos sur le cul. J’ai dû mettre trois heures pour arriver en bas, et la route était putain d’abrupte, de la poussière, de la caillasse qui croule sous tes pieds, du vide… Sans compter l’altitude, j’en tremblais des genoux tellement c’était chaud et tellement cet enfoiré de sac pesait lourd. Parvenue en bas, je suis tombée sur deux mecs, deux français de mon âge, la vingtaine quoi, et je dois reconnaître que c’était cool de parler un peu ma langue avec des jeunes ! On était sous un arbre à fumer des clopes quand deux autres types sont passés, genre quarante ans ceux-là, qu’étaient français aussi. On s’est salués et ils ont tracé la route vers l’espèce de camping sauvage où on allait tous dormir. J’ai fait à l’un des types : Je crois que ces deux mecs sont ensemble, et il m’a juste souri d’un air mystérieux. Plus tard, j’ai compris que lui et son ami étaient en couple aussi, ce qui était assez cocasse, je trouve. La vérité, c’est que c’était canon de passer la soirée avec quatre mecs sans qu’aucun n’essaye de te la faire à l’envers, et puis cet humour gay que j’affectionne tant, sans déconner, quelle chance y avait pour que je rencontre ces deux couples de français le même jour, perdue au fond du cul d’un canyon péruvien ?
Mais je vais trop vite. Avant ça, les mecs et moi on a installé nos tentes (les leurs avaient été louées, encore du poids en moins dans le sac, la mienne je me la coltine en continu) au bord de la piscine naturelle qui longe la rivière sur un terrain à l’herbe rase et verte, parfait, quoi. On a nagé un peu, papoté, et quand je suis retournée à ma tente pour choper de quoi grailler (je suis en mode économie intensive, donc j’évite les restos, je bouffe des pommes et des petits pains ronds individuels comme ils ont ici), ma tente était démontée et ma bouffe disparue. Plus loin j’ai repéré le cochon du propriétaire en train de finir de s’enfiler mes pommes. Génial. Heureusement qu’y avait un genre de petit resto de plein air dans ce canyon, du coup j’ai fini sur une table en rondin avec les deux couples, à bouffer du ragoût de légumes et à boire du vin rouge que le micro-bar proposait.
Putain de soirée ! Trop cool de parler avec d’autres voyageurs ! Les quadras se payaient un tour du monde de six mois, les jeunes un trip Amérique Latine de trois mois. Tout le monde était sur le cul que je sois là pour un an entier, et j’ai dû expliquer que j’avais fait pousser et vendu ma weed pendant trois années consécutives pour en arriver là. Parlant de weed, les jeunes en avaient, ce qui n’a fait que renforcer le délire, la bonne humeur et l’hilarité générale !
Bref, le lendemain les jeunes et moi on devait remonter (les vieux sont partis aux aurores), et le blond a eu la bonne idée de moyenner pour moi avec un muletier qui rentrait au village afin que son animal ramène mon sac là-haut. Bon, cela dit, même sans sac, la remontée à été super rude, et j’ai encore des courbatures aujourd’hui. Mais c’était quand même une putain d’idée ! On a passé le reste de la journée ensemble à Cabanaconde, je les ai suivis dans leur hôtel (histoire d’être débarrassée de Yamil, ouf), et le soir venu on a assisté à l'élection d’une miss de village avec tous les habitants (la moche a gagné, ce qui est bizarre vu qu’y avait que deux concurrentes, mais ça devait être la fille du maire). Et le lendemain, retour vers Arequipa, mais en chemin on a fait une pause sur un mirador à flanc de montagne pour observer le vol des condors (y sont gros !) et une autre dans des sources thermales, histoire de se détendre un peu les muscles (cela dit, c’est un truc de riches, ça, et je compte pas me le payer régulièrement). On a passé une nuit dans le village d’à côté, un truc glauque, boueux, où on se caillait les miches (mais ça m’a mise en contact avec une certaine réalité de ce pays, loin d’être toute rose), et enfin le lendemain matin arrivée ici.
Finalement, Arequipa est une ville rudement mignonne, et mon hôtel possède un toit-terrasse qui la surplombe. J’ai laissé mes deux potes reprendre leur trip de leur côté, et je suis contente de me retrouver seule, en fait. J’aime les rencontres furtives, sans lendemain, où chacun est cash, on se raconte nos vies, on kiffe un moment, et suerte mon ami !
Un truc génial : j’ai acheté un sac plus petit pour le porter devant et ça va me changer la life !
© Zoë Hababou 2021 - Tous droits réservés
Leçons d’Errance : Ce que le Road Trip Solitaire change en Toi
Les circonstances te contraignent à devenir débrouillard, ça oui, parce que t’as pas le choix : le cerveau humain est ainsi fait que tant que t’es peinard dans ta zone de confort, t’es qu’un bon à rien passif et effrayé qui se noie dans un verre d’eau, alors que quand y s’agit de sauver ta peau, tu développes d’un coup des trésors d’intelligence et d'ingéniosité.
Il y a différentes sortes de voyage, depuis les petites vacances gentillettes jusqu’au tour du monde de plusieurs années, en passant par la pause sabbatique de quelques mois.
Cet article traite du vrai road trip solitaire, celui qui te cueille comme un bébé pour rendre à ta mère un warrior impossible à reconnaître. Celui que je pratique depuis plus de dix ans et que j’espère un jour transformer en voyage sans retour.
Road Trip Solitaire : Une autre vision de la vie ?
20 ANS, 18 KILOS SUR LE DOS
Quand t’en parles avec tes potes dont les yeux brillent d’envie (lorsqu’ils réalisent que putain, tu vas vraiment le faire), en fait, tu sais pas de quoi tu causes. Parce que lire Jack Kerouac et mater Into The Wild ne suffit évidemment pas à te préparer à ce qui t’attend. Les quelques blogs ou guides touristiques que t’as vaguement feuilletés non plus. Être solitaire dans l’âme, j’imagine que ça aide un peu, mais pour autant y a aucune chance non plus que ça te soit d’une quelconque utilité quand il s’agira d’improviser avec les données du terrain dont t’ignores absolument tout.
Mon conseil ? Pas de conseil. Vas-y, n’écoute personne, et encore moins la petite voix de la peur qui gémit au fond de toi.
L’organisation dépend de la façon dont tu comptes vivre le truc. L’idée, c’est que plus tu pars longtemps, moins tu prends d’affaires. Tu te démerderas pour laver tes sapes et acheter sur place les produits de première nécessité. Après, c’est clair que sur un continent comme l’Amérique du sud, où tous les climats s’entrecroisent, va te falloir un short et un polaire, au minimum. Un peu moins évident que si tu pars que pour les Tropiques ou dans l’Himalaya, quoi. La question du logement entre aussi en compte. Si comme moi tu veux te la jouer wild, une tente et un sac de couchage s’imposent, de même que des gamelles et un réchaud. Voilà comment on en arrive aux fameux 18 kilos. Nan, je le conseille à personne. Vous voulez le détail ? C’est parti :
Sac Quechua de 80 litres (absolument ridicule)
Tente une place légère (ouais, mes couilles)
Sac de couchage confort -10 degrés (efficace à condition d’avoir un tapis de sol. Ah, merde, j’en ai pas)
Lot de gamelles : casserole, poêle, assiette, tasse, couverts, gourde (le tout en fer blanc, mais ça prend une putain de place)
Moustiquaire (m’en suis jamais servie, je l’ai larguée dans un hôtel)
Manteau de ski (WTF ?)
Serviette de plage énorme (mais pourquoi personne m’a dit que la microfibre existait, putain ?)
En fringues, que dalle : Deux jeans, un legging, un short, trois débardeurs, une chemise, un polaire, trois paires de chaussettes, dix culottes, deux soutifs, chaussures de randonnée
Trousse à pharmacie monstrueuse (merci bien les conseils aux voyageurs débiles)
Trousse de toilette (Dieu bénisse je connais déjà le shampoing solide et le savon d’Alep)
Appareil photo Canon compact (ah, enfin quelque chose d’essentiel !)
Guides de voyage Lonely Planet (sont gros)
On dirait pas comme ça, mais c’est beaucoup trop, et ça pèse un âne mort, sans compter qu’il me manque des trucs essentiels. On va y revenir.
Direct à la sortie de l’avion t’attend un putain de choc.
Débarquer dans un bled dont tu parles pas la langue, apprendre à jongler illico avec les taxis, les hôtels et les bus (en essayant de pas te faire enfler avec une monnaie qu’est pas la tienne), organiser ton itinéraire la veille pour le lendemain en décortiquant ton foutu guide (ce que je conseille, ne réserve rien, ne te projette pas, avance au jour le jour, à la limite en regardant une semaine dans le futur, maximum), et ben mon neveu, rien qu’avec ça t’as mûri de dix ans en l’espace de 24h.
Et tu sais quoi ? Ça te rend putain de fier !
HIT THE ROAD, JACK
Le changement n’arrive pas immédiatement, cela dit.
Les circonstances te contraignent à devenir débrouillard, ça oui, parce que t’as pas le choix : le cerveau humain est ainsi fait que tant que t’es peinard dans ta zone de confort, t’es qu’un bon à rien passif et effrayé qui se noie dans un verre d’eau, alors que quand y s’agit de sauver ta peau, tu développes d’un coup des trésors d’intelligence et d'ingéniosité.
Même si t’es pas autant en danger que tu te l’imagines quand tu débarques dans un bled très différent du tien (et nettement plus pauvre), il n’empêche que tu dois tout le temps prendre des décisions très rapides, et que dans ces cas-là l’intuition devient ton seul recours : monter dans ce taxi plutôt que dans celui-là, faire confiance à ce guide, accepter de l’aide de ce mec, ou au contraire tracer droit devant en espérant être invisible.
Le voyage éveille en toi une sorte d’intelligence instinctive, qui décrypte les messages codés d’une expression de visage, d’une inflexion de voix, si bien que t’es vraiment dans le pur présent, les sens aiguisés, aware comme jamais. En état d’hyperconscience, en fait.
C’est ce que je kiffe avec le trip solitaire. Partir entre amis ou en couple te prive de ce truc-là. T’es moins attentif, parce qu’au fond t’as amené ta zone de confort avec toi. Et tu sais quoi ? Tu ne vas jamais la quitter. Tant que tes potes ou ton mec te tiennent la main, réfléchissent avec toi ou déconnent et rigolent pendant les longues heures de bus, tu peux dire adieu à l’immersion. T’auras un contact bien moins franc avec les locaux et avec les autres voyageurs. Tu vas rester dans ta bulle, la même que celle de la maison. Tes proches te rappelleront toujours qui t’es censé être, sans possibilité de surprise ou d’évolution.
Et tu sauras jamais de quoi t’aurais été capable seul, ni si t’aurais pu devenir quelqu’un d’entièrement différent.
COWBOY SOLITAIRE OU TROUPEAU DE MOUTONS ?
Des gens, tu vas en croiser beaucoup, et sache qu’il te sera toujours possible de te fondre dans une meute si t’y tiens vraiment. Pas mal de voyageurs sont avides de nouvelles rencontres et j’ai vu des gens partis seuls désormais à la colle avec d’autres.
Et je dis pas, c’est parfois cool de squatter un moment avec eux, sans compter que tu vas apprendre de leur expérience (notamment qu’il est indispensable d’avoir un petit sac en plus du gros, qu’on porte devant comme un bébé kangourou, ce qui permet de garder avec toi et de protéger tes trucs les plus précieux plutôt que de les larguer en soute dans le bus, et aussi de laisser ton Quechua à l’hôtel quand tu veux te faire un trek de quelques jours qui nécessite que quelques affaires qui rentrent dans le petit sac. Et aussi, qu’il existe ces putains de serviettes microfibres que tout le monde a sauf toi !).
Mais en vrai, c’est carrément bon de larguer le troupeau pour reprendre ta route solitaire.
Quand tu pars suffisamment longtemps, il se passe quelque chose avec le concept même de voyage. Tu connais ce proverbe qui dit que le chemin compte davantage que la destination ? C’est de ça qu’il est question.
Après plusieurs mois, le trip se transforme en errance. Et c’est là que tu pénètres dans la réalité de l’expérience.
FUSION
Le phénomène de fusion est celui qui se rapproche le plus de ce lent processus, peut-être encore davantage que celui d’immersion. Déjà, tu fusionnes avec ton sac (ouais, même celui de 18 kilos, il finit par faire partie de toi). Ensuite, ces pauvres fringues que tu portes jour après jour en viennent à retrouver leur fonction primordiale, comme disait Tyler Durden : de simples couches qui te protègent du froid ou du soleil et du regard libidineux de ce putain de chauffeur de taxi.
Mais tout ça, ça reste superficiel. Nan, le truc vraiment mystique, c’est ce qui se produit entre toi et la route.
Entre toi et le monde.
Arrive un moment où le voyage et toi n’êtes plus qu’une seule et même chose.
Tu peux plus dire qui court sur la peau de l’autre, qui pénètre au sein des territoires, qui avale les kilomètres sans sourciller.
Est-ce la Terre qui s’ouvre en deux pour toi, ou est-ce que c’est toi qui l’autorise à te pénétrer ? Est-ce que cette route sans fin t’éloigne de celui que tu étais, ou est-ce qu’elle t’y ramène ? Qui contemple l’autre ? Le chant de la jungle n’est-il pas en définitive celui des battements de ton propre cœur ?
Voilà ce que je veux dire quand je parle de l’ignorance. De toutes ces jolies choses qu’on se raconte, qu’on s’imagine, qu’on évoque avant de partir. Cette chose que tes potes restés à la maison ne comprendront jamais, et qui faisait pourtant déjà briller cette lueur dans leur regard, comme s’ils contemplaient le souvenir de quelqu’un qu’ils auraient déjà perdu.
Nan, tu ne seras plus jamais le même. Parce que désormais, ton âme appartient au monde entier, et que tu pourras pas la ramener en totalité avec toi dans l’avion.
ON THE ROAD AGAIN
Ce sera ton unique obsession, tiens-toi le pour dit. Même si parfois t’auras l’impression que tout ça n’a été qu’un rêve, que tu seras effrayé par la façon dont c’est facile pour toi de te reglisser dans le triste quotidien amer que les autres n’ont jamais quitté, comme si t’étais jamais parti, tu porteras à jamais cette soif de l’Inconnu qui coïncide avec celle du moment présent.
Seul l’Inconnu possède cette force qui te happe, celle qui t’immerge dans un présent définitif, où la contemplation silencieuse a pris la place de la pensée. Certains appellent ça le sublime. Peu importe le nom qu’on lui donne.
Ton regard porte en lui la marque de tout ce qu’il a embrassé, et la seule manière de guérir de cette étrange mélancolie est de larguer à nouveau les amarres.
Le truc cool, c’est que les kilos sur ton dos vont diminuer. Second trip, 12 kilos. Troisième trip, plus que 10, et c’était encore trop. On peut se passer d’un nombre faramineux de choses, et le minimalisme aide pas mal dans ce genre de cas. De toute façon y a de fortes chances que quand tu rentres tu n’aies plus aucun goût pour ces choses qui incitent tant de gens à sacrifier la totalité de leur salaire.
Si tu veux repartir, il te faut de la thune, donc la consommation décérébrée s’arrête d’elle-même et en vient finalement à te révulser.
Le fait d’avoir vécu avec si peu sur toi t’apprend que t’as pas besoin de te définir en fonction de ce que tu possèdes. Même sans ta bibliothèque remplie, tes fringues de bombasse et ton super PC, tu es encore toi, mais un toi plus vrai, plus profond, épuré de ce qui l’encombre.
Un toi réduit au strict minimum, infiniment plus riche que celui qui se camoufle derrière ces choses qui sont censées prouver aux autres sa valeur.
Le fait de porter sur ton dos tes affaires symbolise le poids physique et mental qu’elles ont sur toi. Leur emprise, la façon dont en réalité, elles t’écrasent. Alors, sans même y penser, tu t’en défais.
Désormais t’as qu’un livre sur toi, celui que t’es en train de lire, et que tu remettras en circulation au prochain book exchange d’un hôtel ou d’un bar. Tes liens avec tes proches aussi passent à l’essentiel. Fini de radoter au téléphone ou d’envoyer des messages à tire-larigot sans avoir rien à dire. Quand t’appelles ta mère après trois mois de silence (lors de mon premier trip, y avait pas de smartphone et pas de wifi), votre conversation taille dans le vif.
Bref, tes valeurs s’en trouvent profondément modifiées.
LONESOME COWBOY
L’errance est un enseignement sans maître, un voyage sans destination.
Et une voie sans retour.
Peu de choses dans la vie sont en mesure de révéler à l’Homme les pouvoirs enfouis en lui, si ce n’est les évènements les plus tragiques. Mais le road trip solitaire en fait partie, et il est la source d’une joie profonde, d’un rayonnement qui s’étend sur l’identité entière de celui qui s’y livre.
C’est une sorte de rite initiatique qu’on décide pour soi, à des années-lumière de ceux mis en place par la société (études, mariage, enfants). Un apprentissage à la dure déguisé en quête qui dynamite tout ce qu’on croyait savoir sur soi et met en éveil nos forces inconnues, quelque chose qui t’endurcit tout en te rendant plus souple, plus flexible.
Les heures d’attente dans les terminaux d’autobus t’enseignent la patience. La pratique d’une nouvelle langue assouplit ton cerveau. Les décisions prises à toute vitesse aiguisent ton instinct. La rencontre de climats violents et les désagréments qui vont avec obligent ton corps à s’adapter. La découverte de coutumes différentes, de façons autres de voir l’existence chamboulent tout ce que ta culture t’a appris, tout ce que tu considérais comme normal ou essentiel, renversant ton conditionnement et t’offrant un regard sur le monde, celui des autres et celui dont tu viens, totalement différent, bien plus conscient, bien plus détaché.
L’errance fait de toi un voyageur du monde, quelqu’un qui n’appartient plus à aucune culture, et plus à personne, si ce n’est lui-même.
Le passé ayant déjà cessé d’exister, le futur n’étant rien d’autre qu’une ligne noire qui se déroule à mesure que tu la suis, à l’image de cette destinée que tu découvres tout en la vivant. Les synchronicités s’enchaînent, les briques de l’expérience s’alignent, l’espace mental dégagé des automatismes et des attentes offre à ta vie l’ampleur nécessaire pour que la magie y revienne.
Débarrassée de ses chaînes, ta conscience s’étend et révèle son pouvoir quantique, celui qui laisse une empreinte sur la matière, qui créée à partir de ses rêves l’expérience de vie que tu désires, en appelant à toi les vibrations dont toi-même tu résonnes.
Si la liberté du Desperado a jamais possédé un visage, ça ne peut être que celui de cette route qui file vers l’Inconnu, tout en le ramenant mystérieusement à lui-même.